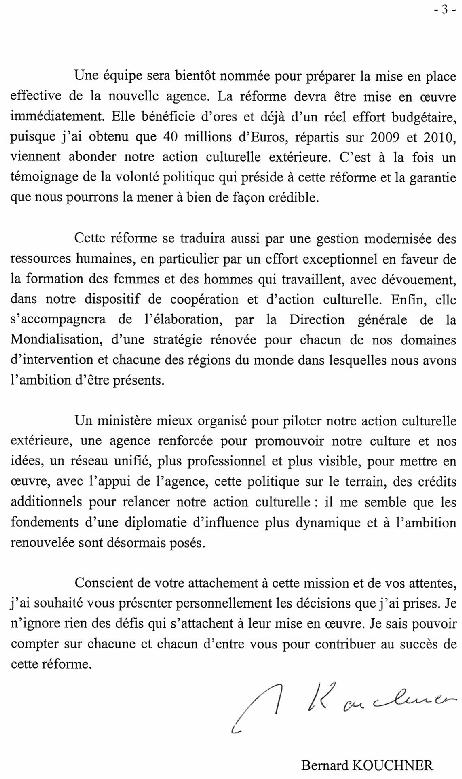TREIZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 14 octobre 2009.
AVIS
PR�SENT�
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES �TRANG�RES
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2010 (n� 1946),
TOME II
ACTION EXT�RIEURE DE L’�TAT
Rayonnement culturel et scientifique
par M. Fran�ois ROCHEBLOINE,
D�put�
Voir le num�ro 1967 (annexe n� 1).
INTRODUCTION 5
I – LES CR�DITS DE L’ACTION CULTURELLE EXT�RIEURE EN 2010 : UN ABONDEMENT EXCEPTIONNEL BIENVENU POUR �VITER LA RUPTURE 7
A − DES CR�DITS DONT LE SUIVI N’EST PAS FACILIT� PAR LES DOCUMENTS BUDG�TAIRES 7
1) Des comparaisons annuelles d�taill�es rendues inutilement difficiles 7
2) Une r�flexion souhaitable sur la nomenclature des programmes qui suppose des choix dans l’application de la LOLF 8
B – POUR LE RAYONNEMENT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE, DES CR�DITS EXCEPTIONNELS COMME SYMPT�ME D’UNE DOTATION INITIALE INSUFFISANTE 10
1) Un contexte budg�taire particuli�rement contraint 10
2) Des moyens d’intervention suppl�mentaires en 2009 et 2010 � clarifier 13
C – POUR L’ENSEIGNEMENT FRAN�AIS � L’�TRANGER, DES CR�DITS TROP ACCAPAR�S PAR LA MESURE DE GRATUIT� EN FAVEUR DE NOS RESSORTISSANTS 15
1) L’AEFE peine � �quilibrer son budget 15
2) Le plan de d�veloppement du r�seau est ob�r� par la mesure de prise en charge de la scolarit� des enfants fran�ais � l’�tranger 19
II – LA R�FORME DU R�SEAU CULTUREL : RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS 29
A – LA FRANCE RAYONNE PAR SA CULTURE VIA DES MOYENS QUE LE MINIST�RE S’EFFORCE DE MIEUX COORDONNER 29
1) Le point de d�part : le r�seau et ses trois types de structures 29
2) Les Alliances fran�aises, fer de lance de la promotion de notre langue 31
3) CulturesFrance, embl�matique metteur en sc�ne des saisons culturelles 34
4) Le Louvre Abou Dabi, exemple des nouvelles expressions de notre diplomatie culturelle 40
B – L’ACH�VEMENT DE LA R�FORME DE NOTRE � DIPLOMATIE D’INFLUENCE � ATTENDRA 42
1) Un rapprochement d�j� engag� sur le terrain entre les services de coop�ration et d’action culturelle et les �tablissements du r�seau 42
2) Une administration centrale fra�chement r�organis�e avec la cr�ation de la direction g�n�rale de la mondialisation 44
3) La transformation programm�e de CulturesFrance et de CampusFrance 46
4) Quelle place dans la r�forme pour les instituts fran�ais de recherche � l’�tranger ? 48
5) Quel avenir pour le r�seau culturel � l’horizon de trois ans ? 49
Annexe 1 : Auditions du Rapporteur 79
Annexe 2 : Lettre du ministre des Affaires �trang�res et europ�ennes aux agents du r�seau culturel 81
Mesdames, Messieurs,
Un contexte budg�taire difficile n’est souvent pas le plus appropri� pour mener une ambitieuse r�forme de structure. La transformation de notre r�seau culturel � l’�tranger en outil de diplomatie d’influence, � la fois pour ne pas �tre marginalis� dans la mondialisation et pour en tirer parti, n’est pas chose ais�e lorsque s’applique une trajectoire triennale de r�duction des emplois et des moyens d’intervention.
C’est donc faire preuve de courage que de pers�v�rer dans la voie de la r�forme � l’heure o� l’attentisme frileux serait plus facile. C’est aussi faire montre de sagesse que de savoir prendre le temps de la r�flexion et de la concertation avant de lancer une r�forme de notre r�seau culturel qui devrait faire date.
Le pr�sent projet de budget, dans le champ du programme Rayonnement culturel et scientifique de la mission Action ext�rieure de l’�tat, �pouse les contours et l’esprit de cette r�forme… qui laisse n�anmoins un go�t d’inachev� : la lettre du ministre aux agents du r�seau culturel, annex�e au pr�sent rapport, renvoie � un horizon de trois ans le v�ritable – et d�sormais hypoth�tique – changement de portage de notre diplomatie d’influence.
Pour autant, la r�organisation de l’administration centrale et du r�seau, qui constitue le � premier �tage � de la r�forme, se poursuit et b�n�ficiera, en 2009 et 2010, d’un abondement exceptionnel destin� � faciliter sa mise en œuvre. Il faut saluer cet effort au sein d’un budget qui demeure particuli�rement sobre et soucieux d’optimiser l’effet de levier des fonds disponibles.
Un seul regret majeur, d�s lors, pour votre Rapporteur, qui sera, il faut l’esp�rer, bient�t corrig� par voie d’amendement : que le moratoire d�cid� � propos de la prise en charge de la scolarit� des �l�ves fran�ais dans le r�seau des lyc�es fran�ais � l’�tranger n’ait pas – ou pas encore – d�bouch� sur un v�ritable encadrement de cette d�pense devenue d�j� trop lourde, sur le plan budg�taire comme sur le terrain des principes.
Heureux d’avoir pu �changer avec de nombreuses parties prenantes au rayonnement de la France, de son enseignement et de sa culture dans le monde (1), et reconnaissant aux services du minist�re d’avoir fait diligence dans les r�ponses � son questionnaire budg�taire, votre Rapporteur veut aussi rendre hommage aux personnels qui ont pr�par� et accompagn� les d�placements que, dans le cadre de la mission d’information qu’il pr�side, il a effectu�s en Allemagne, au Chili et en Argentine.
Il regrette d’autant plus de n’avoir pu autant qu’il e�t �t� souhaitable, faute de disponibilit� suffisante de part et d’autre, s’entretenir avec le cabinet du ministre, notamment � propos des choix finaux de la r�forme du r�seau culturel ou de certaines orientations politiques du projet de budget.
I – LES CR�DITS DE L’ACTION CULTURELLE EXT�RIEURE EN 2010 : UN ABONDEMENT EXCEPTIONNEL BIENVENU POUR �VITER LA RUPTURE
A − Des cr�dits dont le suivi n’est pas facilit� par les documents budg�taires
1) Des comparaisons annuelles d�taill�es rendues inutilement difficiles
En pr�ambule, votre Rapporteur souhaite faire part d’une forme de d�ception � la lecture des documents budg�taires qu’il utilise directement, en l’esp�ce le programme annuel de performances (PAP) du programme Rayonnement culturel et scientifique de la mission Action ext�rieure de l’�tat.
En effet, il constate que les comparaisons budg�taires sont rendues difficiles d’un exercice � l’autre par les nombreux changements de nomenclature op�r�es au niveau de pr�vision et d’ex�cution le plus fin, c’est-�-dire celui des sous-actions. Ainsi, les montants indiqu�s dans le PAP pour 2010 ne sont pas toujours comparables � ceux figurant dans le PAP pour 2009.
Certes, depuis la pleine entr�e en vigueur de la loi organique du 1er ao�t 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la justification au premier euro des cr�dits demand�s pour l’exercice � venir suppose l’absence de raisonnement selon le sch�ma � socle / mesures nouvelles � qui pr�valait sous l’empire de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 : un budget ne se b�tit plus, en th�orie, � partir d’une reconduction globale de l’existant puis d’une adaptation � la marge.
Dont acte. Mais au regard de ce principe th�orique, votre Rapporteur voudrait soulever trois remarques pratiques :
− premi�rement, selon les informations glan�es aupr�s des gestionnaires au fil de ses auditions ou de ses d�placements, votre Rapporteur constate que le raisonnement en termes de socle et de mesures nouvelles peine � dispara�tre ;
− deuxi�mement, l’explication possible de tels changements dans le d�tail de la nomenclature, � savoir la souplesse laiss�e aux gestionnaires dans l’ex�cution de leurs cr�dits au sein d’enveloppes fongibles, est tout simplement contredite par les faits (l� encore d’apr�s des t�moignages de gestionnaires) ;
− troisi�mement, et sans vouloir en aucune mani�re intenter un quelconque proc�s d’intentions, jamais la justification au premier euro au sens de la LOLF, dont on peut rappeler qu’il s’agit � l’origine d’une initiative parlementaire, n’a �t� con�ue comme devant rendre impossible pour le Parlement la comparaison de deux exercices budg�taires entre eux. � tout le moins les changements de nomenclature dans les sous-actions devraient-ils �tre explicit�s dans le PAP.
Comme l’indiquait le Premier pr�sident de la Cour des comptes � l’occasion de la publication des rapports de la Cour sur la certification des comptes ainsi que sur les r�sultats et la gestion budg�taire de 2007 : � La notion de budget nous para�t dangereusement s’effriter : la disparition des chapitres et articles et leur remplacement par les missions et programmes s’est accompagn�e d’une moindre pr�cision du suivi budg�taire […]. On ne peut �videmment se satisfaire de cette d�gradation de l’information budg�taire l� o� la LOLF souhaitait plus de transparence. Il est donc n�cessaire de mettre rapidement � niveau les syst�mes d’information pour b�n�ficier de tous les avantages de la nouvelle nomenclature sans perdre la pr�cision et la fiabilit� de l’information n�cessaires au suivi de la loi de finances. �
Votre Rapporteur ne peut que souscrire � cette affirmation et souhaiter, dans l’attente du complet d�ploiement des syst�mes d’information ad hoc, une plus grande pr�cision du volet � justification au premier euro � du projet annuel de performances.
D’ailleurs, la partie du PAP consacr�e aux op�rateurs comprend cette comparaison relativement fine d’un exercice � l’autre, ce qui prouve qu’elle a bien sa place dans les documents budg�taires et ce qui semble le degr� minimum de l’information budg�taire n�cessaire au Parlement.
2) Une r�flexion souhaitable sur la nomenclature des programmes qui suppose des choix dans l’application de la LOLF
Le second souhait que votre Rapporteur tient � faire figurer en pr�ambule de cet avis budg�taire a trait � la nomenclature des cr�dits du minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes.
En effet, et l� encore depuis les d�buts de la gestion � en mode LOLF � de ces cr�dits, les moyens de l’action culturelle ext�rieure sont �clat�s entre le programme 185 Rayonnement culturel et scientifique de la mission Action ext�rieure de l’�tat, qui fait l’objet du pr�sent avis, et ceux du programme 209 Solidarit� � l’�gard des pays en d�veloppement de la mission interminist�rielle Aide publique au d�veloppement, qu’analyse notre coll�gue Henriette Martinez (2).
Le crit�re de r�partition des cr�dits de coop�ration et d’action culturelle ext�rieure entre ces deux programmes tient au classement des �tats du monde entre pays d�velopp�s et pays en d�veloppement. D’ailleurs, le changement de cat�gorie de l’Arabie saoudite en 2010, d�sormais incluse parmi les pays d�velopp�s, entra�nera une l�g�re modification de p�rim�tre, �voqu�e dans le PAP.
Or la c�sure n’est pas telle entre ces deux cat�gories que les cr�dits d’action culturelle doivent �tre g�r�s de fa�on totalement diff�rente. Une seule grande direction du Quai d’Orsay, la direction g�n�rale de la Mondialisation, du d�veloppement et des partenariats, est responsable du pilotage de l’ensemble de ces cr�dits, et s’appuie sur un � tableau de bord � qui est construit � l’�chelle de la direction tout enti�re (cf. infra page 44).
On se prive par ailleurs de comparaisons utiles en maintenant ces cr�dits ayant un objet similaire dans des missions diff�rentes, et l’on prive �galement le gestionnaire qu’est le directeur g�n�ral de la Mondialisation de la fongibilit� de ses cr�dits entre diverses r�gions du monde, alors qu’il ne serait que davantage � responsabilis� � s’il pouvait effectuer de tels arbitrages entre zones du globe. Tel est bien l’esprit de la LOLF.
Votre Rapporteur est d’autant plus convaincu de ce raisonnement que le choix n’a pas �t� fait, lors de la mise en œuvre de la LOLF au Quai d’Orsay, d’une organisation par zones g�ographiques, qui e�t abouti � des � budgets-pays �. D�s lors, le crit�re g�ographique de la r�partition des cr�dits de l’action culturelle perd de sa pertinence.
C’est pourquoi votre Rapporteur estime souhaitable que, dans le cadre de la r�flexion sur l’application de la LOLF au minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes, soit �tudi�e la possibilit� de donner une coh�rence nouvelle � la diplomatie d’influence que mat�rialisent les cr�dits de la coop�ration et de l’action culturelle.
Une telle nomenclature permettrait, par exemple, un suivi exhaustif des 40 millions d’euros suppl�mentaires pour l’action culturelle obtenus, selon les propos tenus par le ministre des Affaires �trang�res et europ�ennes lors de son audition devant la commission des Affaires �trang�res le 13 octobre dernier, � parit� dans le cadre des exercices 2009 et 2010. Car en l’�tat, ces cr�dits sont �clat�s non seulement entre deux programmes, mais surtout entre deux missions budg�taires.
Selon les informations recueillies par votre Rapporteur, une telle r�forme, qui avait �t� propos�e par le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes pour une inscription dans le pr�sent projet de loi de finances, pourrait �tre envisag�e � l’issue de la p�riode 2009-2011 couverte par le � budget triennal � d�finitivement vot� en f�vrier dernier (3). Votre Rapporteur pr�cise toutefois d�s � pr�sent qu’il n’est pas favorable � une modification de la maquette de plus grande ampleur qui comporterait, par exemple, la cr�ation d’un vaste � programme support � pour l’ensemble du minist�re ; ce serait contraire � l’esprit de la LOLF qui promeut la � budg�tisation � co�t complet �, consistant � rendre visible la conduite d’une politique publique donn�e, cr�dits de personnel et de fonctionnement inclus.
B – Pour le Rayonnement culturel et scientifique, des cr�dits exceptionnels comme sympt�me d’une dotation initiale insuffisante
1) Un contexte budg�taire particuli�rement contraint
• Le programme Rayonnement culturel et scientifique recouvre deux grands domaines au sein de la mission Action ext�rieure de l’�tat :
– il met en œuvre la coop�ration avec les �tats membres de l’Union europ�enne et les grands pays industriels du monde d�velopp�, c’est-�-dire tous ceux qui ne sont pas �ligibles � l’aide publique au d�veloppement telle que d�finie par le Comit� d’aide au d�veloppement de l’OCDE ;
– il vise � assurer le service d’enseignement public � l’�tranger dans l’ensemble du monde, conform�ment aux missions que le code de l’�ducation a fix�es � l’Agence pour l’enseignement fran�ais � l’�tranger (AEFE).
Comme l’an dernier, le programme Rayonnement culturel et scientifique regroupe quatre actions. Leur montant total repr�sente, dans le pr�sent projet de loi de finances, en cr�dits de paiement, 22,7 % du total des cr�dits de la mission Action ext�rieure de l’�tat, tandis qu’ils en repr�sentaient 23,6 % en loi de finances initiale pour 2009.
Le tableau suivant retrace, par action, l’�volution des cr�dits du programme d’une ann�e sur l’autre :
COMPARAISON PAR ACTION DES CR�DITS DU PROGRAMME (en AE et CP, en milliers d’euros) | ||||
Actions |
LFI 2008 |
LFI 2009 |
PLF 2010 |
�volution |
71 937 |
65 872 |
60 658 |
– 7,9 % | |
Langue et culture fran�aise, diversit� linguistique et culturelle |
70 707 |
61 203 |
61 674 |
0,8 % |
�changes scientifiques, techniques et universitaires |
55 462 |
53 076 |
54 767 |
3,2 % |
Service public d’enseignement � l’�tranger |
287 875 |
412 671 (*) |
420 820 |
2 % |
Total |
485 981 |
592 822 (*) |
597 919 |
0,9 % |
(*) Le ressaut observ� entre 2008 et 2009 est d� � l’obligation faite � l’Agence pour l’enseignement fran�ais � l’�tranger, en application du d�cret n� 2007-1796 du 19 d�cembre 2007, de financer sur son budget, � compter du 1er janvier 2009, la part patronale des cotisations de pensions civiles des personnels qui lui sont d�tach�s. Source : lois de finances vot�es et PAP 2010 du programme Rayonnement culturel et scientifique. | ||||
On peut noter que la subvention � l’AEFE, qui repr�sentait 59,2 % des cr�dits du programme en loi de finances initiale pour 2008 et 69,6 % en loi de finances initiale pour 2009, en mobiliserait 70,4 % en 2010.
On remarque surtout la diminution des moyens consacr�s au pilotage et � l’animation du r�seau, � hauteur de 5 millions d’euros, essentiellement due � la baisse des cr�dits de personnel, comme le montrent les tableaux suivants qui font appara�tre la r�partition des cr�dits par nature de d�penses :
�VOLUTION DES CR�DITS DU PROGRAMME RAYONNEMENT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE (en AE et CP, en millions d’euros) | ||||||||||
Actions |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 6 |
Total |
Pr�visions FDC et ADP (*) | |||||
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
2009 |
2010 | |
1 – Animation du r�seau |
36,34 |
28,07 |
29,53 |
32,59 |
ε |
– |
65,87 |
60,66 |
– |
– |
2 – Langue et culture fran�aise, diversit� linguistique et culturelle |
37,45 |
41,06 |
– |
– |
23,75 |
20,62 |
61,2 |
61,67 |
0,15 |
0,42 |
4 – �changes scientifiques, techniques et universitaires |
13,91 |
20,04 |
– |
– |
39,16 |
34,73 |
53,08 |
54,77 |
0,6 |
– |
5 – Service public d’enseignement � l’�tranger |
– |
– |
412,52 |
420,82 |
0,15 |
– |
412,67 |
420,82 |
– |
– |
Total |
87,71 |
89,16 |
442,05 |
453,41 |
63,06 |
55,35 |
592,82 |
597,92 |
0,75 |
0,42 |
(*) Fonds de concours et attributions de produits. Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | ||||||||||
Les 8,3 millions d’euros de r�duction des cr�dits de personnel sont partiellement compens�s par une augmentation des moyens de fonctionnement de 3,06 millions d’euros. Cependant, la r�serve de pr�caution (4) �tant beaucoup plus �lev�e sur le titre 3 (5 % des cr�dits vot�s) que sur le titre 2 (0,5 %), les cr�dits r�ellement disponibles pour l’animation du r�seau seront vraisemblablement en diminution encore plus forte en 2010 par rapport � 2009.
• S’agissant des emplois affect�s au programme, exprim�s en �quivalents temps plein travaill� (ETPT), 2010 devrait marquer une stabilisation (+ 1 ETPT) apr�s la baisse sensible enregistr�e en 2009 (− 45 ETPT).
Le plafond d’emplois de l’ensemble du minist�re s’�tablira � 15 564 en 2010, soit une baisse de 255 ETPT par rapport � 2009 (− 2 %). Le minist�re respecte ainsi les engagements pris dans le cadre de la loi pr�cit�e de programmation des finances publiques pour les ann�es 2009-2012, d’une diminution de son plafond d’emplois de 700 ETPT (− 4,4 %) sur la p�riode.
Quant au tableau des emplois pour le programme, il devrait �voluer comme suit :
�VOLUTION ENTRE 2009 ET 2010 DU PLAFOND DES EMPLOIS AUTORIS�S EN LOI DE FINANCES POUR LE PROGRAMME RAYONNEMENT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE (en ETPT) | |||||
Titulaires + CDI |
Titulaires + CDI |
CDD + volontaires internationaux |
Recrut�s locaux |
Total | |
LFI 2009 |
132 |
92 |
774 |
237 |
1 235 |
PLF 2010 |
139 |
85 |
780 |
232 |
1 236 |
Variation |
+ 7 |
− 7 |
+ 6 |
− 5 |
+ 1 |
Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | |||||
La stagnation du nombre d’ETPT pour le programme s’explique par deux mouvements inverses : 30 transferts internes au minist�re et 29 suppressions dans le cadre de la deuxi�me ann�e de mise en œuvre de la RGPP.
Les transferts internes au b�n�fice du programme Rayonnement culturel et scientifique se d�composent en 17 ETPT suppl�mentaires au titre de la cr�ation de la DGM et 13 ETPT provenant du programme Solidarit� � l’�gard des pays en d�veloppement au titre du changement de cat�gorie de l’Arabie Saoudite, qui quitte dans les documents budg�taires le groupe des pays en d�veloppement.
Compte tenu de ces �volutions, les d�penses de personnel pour le programme devraient passer de 87,7 millions d’euros en 2009 � 89,16 millions d’euros en 2010, soit une hausse de 1,7 %.
En 2011, la r�duction du plafond d’emplois du programme pr�vue dans le cadre de la RGPP concernera 24 ETPT ce qui portera l’effort sur trois ans �
– 90 ETPT.
• De fa�on plus d�taill�e, en isolant les cr�dits de personnel et en faisant appara�tre une nomenclature par sous-actions − ce qui, soit dit en passant, s’�loigne beaucoup de la budg�tisation � co�t complet pr�vue par la LOLF −, l’�volution est la suivante :
COMPARAISON PAR SOUS-ACTION DES CR�DITS DU PROGRAMME (en AE et CP, en millions d’euros) | |||
LFI 2009 |
PLF 2010 |
Variation | |
Programme 185 |
592,82 |
597,92 |
0,9% |
Titre 2 |
87,7 |
89,16 |
1,7 % |
Hors titre 2 |
505,12 |
508,76 |
0,7 % |
1 − Animation du r�seau (*) |
29,53 |
32,59 |
10,3 % |
Sous-action animation du r�seau* |
2,43 |
2,5 |
3,2 % |
Sous-action fonctionnement des EAF/CEF* |
18,47 |
16,6 |
− 10,1 % |
Sous-action soutien aux actions de coop�ration* |
8,64 |
13,49 |
56,1 % |
2 − Coop�ration culturelle, linguistique, scientifique, universitaire et technique (*) |
62,91 |
55,35 |
− 12 % |
Langue et culture fran�aise, diversit� linguistique et culturelle (*) |
23,75 |
20,62 |
− 13,2 % |
�changes scientifiques, techniques et universitaires (*) |
39,16 |
34,73 |
− 11,3 % |
3 − AEFE (*) |
412,67 |
420,82 |
2 % |
(*) hors titre 2. Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | |||
La diminution des moyens d’intervention, d�j� importante entre 2008 et 2009, se poursuit au sein de l’action 2 Coop�ration culturelle, linguistique, scientifique, universitaire et technique. Globalement, les cr�dits du programme consacr�s, hors subvention � l’AEFE, � la diplomatie publique d’influence, s’�tabliront � 88 millions d’euros en 2010, en baisse de 4,9 % par rapport � 2009.
Or sans � rallonge � obtenue � titre exceptionnel et non reconductible, la situation e�t �t� plus tendue encore.
2) Des moyens d’intervention suppl�mentaires en 2009 et 2010 � clarifier
Comme votre Rapporteur l’a indiqu� plus haut, le ministre des Affaires �trang�res et europ�ennes a affirm�, au cours de son audition devant la commission des Affaires �trang�res le 13 octobre dernier, avoir obtenu du Premier ministre, sur deux ans, 40 millions d’euros pour accompagner la r�forme de l’action culturelle ext�rieure, � raison de 20 millions d’euros en 2009 puis de 20 millions d’euros en 2010.
Pour 2009, en r�ponse � votre Rapporteur, le ministre a pr�cis� la r�partition de ces moyens entre les programmes Rayonnement culturel et scientifique et Solidarit� � l’�gard des pays en d�veloppement : 6,5 millions d’euros pour le premier et 13,5 millions d’euros pour le second. Pour 2010, le PAP fait �tat de 8,26 millions d’euros sur le programme 185 et de 11,74 millions d’euros sur le programme 209.
Dans le cadre du programme Rayonnement culturel et scientifique, il est pr�vu que ces cr�dits suppl�mentaires b�n�ficient en priorit� aux postes diplomatiques, le reste des cr�dits ayant vocation � accompagner la mise en place de la future agence culturelle ; en fonction du degr� d’avancement de la cr�ation de la nouvelle agence, ces fonds pourront �tre allou�s en tout ou partie � l’actuel op�rateur CulturesFrance.
Dans les postes, ces cr�dits devraient principalement �tre utilis�s pour engager la modernisation des outils de promotion culturelle et audiovisuelle, mais aussi pour restructurer le r�seau d’�tablissements culturels − par exemple en Allemagne ou en Italie − ou pour soutenir des �v�nements − telle l’ann�e France-Russie. Parmi les exemples d’actions qui pourront �tre financ�es, citons l’installation de dispositifs de r�ception et de diffusion, dans les conditions du direct, de contenus num�riques libres de droit, la mise � disposition d’un syst�me de pr�ts de livres num�riques, la cr�ation d’un portail Internet pour les ann�es crois�es France-Russie, ou encore l’�quipement de salles de cours avec un � kit � d’enseignement num�rique.
En administration centrale, l’accent sera mis sur le soutien � l’exportation des industries culturelles fran�aises (cin�ma, musique, livre, t�l�vision), la mise � disposition du r�seau d’outils de promotion efficaces, et sur des �v�nements de communication propres � assurer une plus grande visibilit� internationale aux artistes et � notre savoir-faire technique. Par ailleurs, des formations dans les domaines du num�rique, de l’industrie culturelle et artistique et de la gestion seront mises en place pour favoriser la restructuration et la modernisation de notre r�seau � l’�tranger.
Si la r�partition entre les postes et l’administration centrale est pr�vue � l’euro pr�s dans le PAP pour 2010 (6,4 millions d’euros et 1,86 million d’euros respectivement), pour 2009 les cr�dits ne sont pas encore venus abonder le programme 185. Ce sera chose faite une fois vot�e la loi de finances rectificative de fin d’ann�e. Dans l’intervalle, afin de permettre la mise en place de cr�dits aupr�s des SCAC et des centres culturels, qui ne peuvent attendre la fin d’ann�e, des red�ploiements ont �t� effectu�s gr�ce au report, jusqu’au collectif budg�taire de fin d’ann�e, de certains projets initialement pr�vus sur le programme 185.
Ainsi, en tenant compte des 6,5 millions d’euros suppl�mentaires encore attendus pour 2009, et hors application de la r�serve de pr�caution, le montant des cr�dits inscrits sur le programme 185 s’�l�verait � un total de 599, 32 millions d’euros. D�s lors, l’�volution du montant global du programme entre 2009 et 2010 serait une baisse de 0,2 %.
Cela �tant, votre Rapporteur veut saluer l’obtention de ces cr�dits suppl�mentaires, saluer �galement leur utilisation pr�visionnelle et rappeler qu’en application de la loi de programmation des finances publiques pour les ann�es 2009-2012, le montant des cr�dits du programme e�t d� ne s’�tablir qu’� 577,4 millions d’euros en 2010.
Ce motif de satisfaction est toutefois temp�r� par le constat d’une situation budg�taire particuli�rement tendue � l’AEFE et pour le r�seau d’enseignement fran�ais � l’�tranger en g�n�ral.
C – Pour l’enseignement fran�ais � l’�tranger, des cr�dits trop accapar�s par la mesure de gratuit� en faveur de nos ressortissants
1) L’AEFE peine � �quilibrer son budget
Le budget de l’Agence pour l’enseignement fran�ais � l’�tranger englobe les services centraux et 35 groupements d’�tablissements en gestion directe. Le budget ainsi agr�g� d�gage une capacit� d’autofinancement de 17,2 millions d’euros, insuffisante pour couvrir les investissements. L’�quilibre est obtenu par un pr�l�vement sur le fonds de roulement d’un montant de 9,64 millions d’euros.
• La dotation de l’�tat est inscrite depuis 2007 sur deux programmes de la mission Action ext�rieure de l’�tat. L’action Enseignement fran�ais � l’�tranger du programme 185 est dot�e en 2009 de 415 millions d’euros, ce qui repr�sente plus des deux tiers du programme pilot� par la direction g�n�rale de la Mondialisation.
Ce montant est en forte croissance par rapport � 2008 (+ 44 %), du fait de la mise en œuvre du d�cret du 19 d�cembre 2007 relatif aux pensions civiles. En effet, l’agence paie depuis le 1er janvier 2009 la contribution pour pensions civiles pour l’ensemble de ses personnels titulaires � l’�tranger. Cette mesure, qui met fin � l’exon�ration dont b�n�ficiait l’enseignement � l’�tranger depuis 1984, s’inscrit dans une politique globale d’int�gration des contributions pour pensions dans les budgets des acteurs publics. Ainsi, une enveloppe de 120 millions d’euros a �t� pr�vue pour financer, partiellement, une contribution �gale � 60,72 % de la masse indiciaire brute. Le reste doit �tre couvert par l’Agence elle-m�me.
Quant � l’action Acc�s des �l�ves fran�ais au r�seau du programme 151 Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires, elle est dot�e en 2009 d’un montant de 86,1 millions d’euros pour financer � la fois les bourses aux �l�ves fran�ais et la prise en charge des frais de scolarit� des lyc�ens fran�ais qui s’est �tendue aux classes de seconde en janvier 2009 pour les �l�ves du rythme sud et en septembre 2009 pour ceux du rythme nord.
• La participation des �tablissements, d’un montant de 130,6 millions d’euros en 2009 contre 108 millions d’euros en 2008, int�gre plusieurs �l�ments :
− la participation des �tablissements � la r�mun�ration des personnels r�sidents. L’agence adresse chaque ann�e aux �tablissements du r�seau, �tablissements en gestion directe et �tablissements conventionn�s, une facture de remboursement d’une partie des salaires des personnels r�sidents mis � leur disposition. Le taux de participation, qui tient compte de la capacit� contributive de chaque �tablissement, fait l’objet d’une n�gociation ;
− la contribution de 6 % des frais de scolarit� � compter du 1er septembre 2009. Cette contribution d’un montant attendu de 10 millions d’euros en 2009 est assise sur les frais de scolarit�. Elle permettra � l’agence de couvrir son d�ficit de fonctionnement et de maintenir un investissement immobilier � la mesure des besoins des �tablissements.
• Les emplois r�mun�r�s par l’agence se composent de deux contingents : les emplois sous plafond dont le nombre est inscrit dans le PAP pour 2009 � hauteur de 6 399 et les emplois hors plafond, enti�rement financ�s sur ressources propres, au nombre de 335, soit un total de 6 734 emplois (1 254 expatri�s, 5 348 r�sidents et 132 personnels du si�ge). � ce total s’ajoutent 3 850 emplois de recrut�s locaux dans les �tablissements en gestion directe.
Le tableau suivant d�crit, plus largement, l’�volution des personnels travaillant dans les �tablissements du r�seau de l’Agence, qu’ils soient en gestion directe ou conventionn�s :
�VOLUTION DES EFFECTIFS | |||||
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 | ||
Expatri�s |
1 285 |
1 263 |
1 271 |
1 277 | |
�volution annuelle |
− 0,1% |
− 1,7% |
0,6% |
0,5 % | |
Enseignants |
997 |
963 |
960 |
972 (*) | |
Non enseignants |
288 |
300 |
311 |
305 | |
R�sidents |
4 969 |
5 024 |
5 086 |
5 162 | |
�volution annuelle |
1,5% |
1,1% |
1,2% |
1,5 % | |
Enseignants |
4 876 |
4 940 |
5 006 |
5 084 | |
Non enseignants |
93 |
84 |
80 |
78 | |
Recrut�s locaux |
11 708 |
12 277 |
15 937 |
14 591 | |
�volution annuelle |
− 13,6% |
4,9% |
29,8% |
– 8,4 % | |
Enseignants |
5 324 |
5 814 |
6 963 |
9 013 | |
Non enseignants |
6 384 |
6 463 |
8 974 |
5 578 | |
TOTAUX |
17 962 |
18 564 |
22 294 |
21 030 | |
�volution annuelle |
− 9 % |
3,4 % |
20,1 % |
– 5,7 % | |
Enseignants |
11 197 |
11 717 |
12 929 |
15 069 | |
Non enseignants |
6 765 |
6 847 |
9 365 |
5 961 | |
(*) Sur ce total, seuls 600 enseignants du second degr� exercent r�ellement des fonctions devant �l�ves et 18 dans le premier degr�. Les 354 autres personnels expatri�s mentionn�s dans cette cat�gorie sont issus du corps des professeurs des �coles ou des professeurs certifi�s, mais occupent des fonctions d’encadrement, de coordination et de direction : directeurs d’�cole, conseillers p�dagogiques, faisant fonction de chef d’�tablissement, CPE, inspecteur de l’�ducation nationale en r�sidence, etc. Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | |||||
Appara�t ici notamment l’augmentation du nombre d’enseignants ayant le statut de recrut�s locaux, et r�mun�r�s par cons�quent par les �tablissements eux-m�mes, ce qui p�se sur les �colages.
• Les autres d�penses de fonctionnement de l’AEFE sont les suivantes : d�penses de voyage et frais de r�ception pour 7,15 millions d’euros, aides aux �tablissements du r�seau et autres subventions pour 14,6 millions d’euros, stables dans un contexte de forte croissance des effectifs, et dotations aux amortissements et aux provisions qui passent de 2,9 millions d’euros � 6,2 millions d’euros entre 2008 et 2009.
• Les d�penses d’investissement se r�partissent entre les services centraux (1,2 million d’euros) et les �tablissements (19,1 millions d’euros). Le tableau de programmation immobili�re fait appara�tre :
− les op�rations nouvelles pour 8,2 millions d’euros. Il s’agit, avec un financement par emprunt, de 3,5 millions d’euros pour l’�tablissement d’Ankara, et avec un financement sur les fonds de l’agence, de 4,7 millions d’euros au total pour les �tablissements de Barcelone, Munich et Sofia ;
− les op�rations pluriannuelles d�j� engag�es avec financement par emprunt. Il s’agit de Dakar et d’Ho Chi Minh Ville pour un total de 10,9 millions d’euros.
En outre, est inscrit en programmation immobili�re le projet immobilier d’Alger. La remise en dotation de cet �tablissement n’ayant pas encore �t� officialis�e, le projet ne peut pas encore se concr�tiser sur le terrain. L’op�ration sera en principe financ�e par un emprunt de 5,8 millions d’euros.
• L’�quilibre du budget des services centraux de l’AEFE se r�alise par un r�sultat pr�visionnel d�ficitaire, en 2009, de 2,1 millions d’euros, et un pr�l�vement sur le fonds de roulement de l’agence qu’un tr�s important effort de r�duction du d�ficit de fonctionnement permet de ramener � 1,89 million d’euros (contre 12,52 millions d’euros en 2008). Le budget primitif 2009 des services centraux repr�sente un total de 648,81 millions d’euros.
Quant au budget agr�g� des �tablissements en gestion directe, il s’�l�ve en 2009 � 282,18 millions d’euros, dont 84,74 millions d’euros de d�penses de personnel, 172,83 millions d’euros de d�penses de fonctionnement et 24,6 millions d’euros de d�penses d’investissement. Un effort important a �t� r�alis� pour contenir les d�penses et aboutir � un compte de r�sultat exc�dentaire de 6,54 millions d’euros avec une capacit� d’autofinancement de 13,08 millions d’euros.
D�s lors, le budget global agr�g�, services centraux plus total des �tablissements en gestion directe, pr�sente pour 2009 :
− un compte de r�sultat pr�visionnel d’un montant de 885,84 millions d’euros avec un r�sultat d’exploitation positif de 4,44 millions d’euros ;
− une capacit� d’autofinancement de 17,19 millions d’euros et des d�penses d’investissement inscrites au tableau de financement pr�visionnel pour 45,14 millions d’euros.
Le montant total du budget agr�g� de l’AEFE s’�l�ve ainsi � 930,99 millions d’euros et l’�quilibre global est assur� par un pr�l�vement cumul� sur les fonds de roulement de 9,64 millions d’euros.
• Les perspectives budg�taires pour 2010, alors que le budget primitif de l’agence est en cours d’�laboration, s’�tablissent sur le fondement d’une subvention de l’�tat de 536,2 millions d’euros. Cette somme est r�partie entre le programme 185 pour 420 millions d’euros et le programme 151 pour 106,2 millions d’euros. L’Agence recevra �galement, comme en 2009, 4 millions d’euros pour financer le transfert de la gestion des bourses � majors �.
Les besoins de financement de l’agence en termes de masse salariale ou d’immobilier sont partiellement couverts du fait de l’augmentation de la subvention du programme 185 de 10,82 millions d’euros. Le minist�re pr�sente cet abondement comme suit :
– 10 millions d’euros afin de tenir compte de l’augmentation r�guli�re et importante des charges de pensions civiles. Cette d�pense est tr�s dynamique puisque 120 millions d’euros avaient �t� pr�vus � cet effet en loi de finances initiale pour 2009 et que la pr�vision d’ex�cution pour cette ann�e est en fait de 126,48 millions d’euros. Selon les informations contenues dans le PAP, le co�t des pensions pourrait repr�senter 143 millions en 2010 ;
– 820 000 euros correspondant � la compensation des exon�rations de cotisations sociales sur les heures suppl�mentaires.
Le calendrier budg�taire de l’agence pr�voit la pr�sentation au Conseil d’administration du projet de budget pour l’exercice 2010 lors de sa s�ance du mois de novembre prochain au plus tard. Votre Rapporteur, membre du Conseil, sera particuli�rement vigilant sur la soutenabilit� de ce budget. Par l’amendement qu’il d�posera au pr�sent projet de loi de finances, il entend �galement soulager la tension sur le fonds de roulement de l’Agence, qui ne peut continuer � se r�duire d’ann�e en ann�e.
• L’historique du fonds de roulement de l’agence est le suivant :
�VOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT DE L’AEFE DEPUIS 2005 (en millions d’euros) | |||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 (*) |
Fonds de roulement |
130,56 |
122,51 |
130,63 |
142,1 |
97,84 |
(*) Apr�s d�cision modificative n�1. Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | |||||
En distinguant, au sein de ce fonds de roulement global, entre les services centraux et les �tablissements en gestion directe, le tableau est le suivant, pour l’exercice 2009 et apr�s une premi�re d�cision modificative :
D�COMPOSITION DU FONDS DE ROULEMENT DE L’AEFE EN 2009 (en millions d’euros) | |||
|
Services centraux |
�tablissements |
Total |
Montant du fonds de roulement |
18,99 |
78,85 |
97,84 |
soit, en nombre de jours : |
11 jours |
110 jours |
40 jours |
Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | |||
Le fonds de roulement des �tablissements permet de faire face aux �ch�ances de fonctionnement courant (d�penses de personnel, achats, etc.), de m�me qu’il correspond � des provisions importantes, notamment au titre des travaux en lien avec la programmation immobili�re de l’agence. La situation actuelle correspond pour les �tablissements � l’�tiage absolument n�cessaire en termes de liquidit� et de bonne gestion.
L’agence maintient, � l’�chelon des services centraux, un niveau de fonds de roulement qui, une fois �t�es les op�rations immobili�res, correspond � un seuil minimal de l’ordre de 20 millions d’euros lui permettant de faire face � ses �ch�ances. Tout d�veloppement suppl�mentaire de la politique immobili�re de l’agence devrait n�cessiter des apports suppl�mentaires de l’�tat, sans lesquels il sera difficile de maintenir un niveau de fonds de roulement minimal.
2) Le plan de d�veloppement du r�seau est ob�r� par la mesure de prise en charge de la scolarit� des enfants fran�ais � l’�tranger
Le r�seau d’enseignement fran�ais � l’�tranger compte 461 �tablissements scolaires r�partis dans plus de 130 pays et appartenant � trois cat�gories distinctes (homologu�s, conventionn�s et en gestion directe). L’an dernier, le r�seau comptait 452 �tablissements.
Les 77 �tablissements en gestion directe sont des services d�concentr�s de l’AEFE. Les 166 �tablissements conventionn�s sont des �tablissements g�r�s par des associations de droit priv� fran�ais ou �tranger qui ont pass� avec l’AEFE un accord portant notamment sur les conditions d’affectation et de r�mun�ration des agents titulaires, sur l’attribution de subventions et sur les relations avec l’agence. Ces deux cat�gories d’�tablissements per�oivent des subventions vers�es par l’agence. Cette derni�re assure �galement la r�mun�ration des personnels titulaires gr�ce, d’une part, � la subvention qui lui est allou�e par l’�tat, et d’autre part aux remont�es que les �tablissements effectuent d’une partie des droits de scolarit� acquitt�s par les familles.
Les 212 �tablissements simplement homologu�s n’ayant pas pass� de convention avec l’agence ne b�n�ficient pas d’aide directe. Ils sont n�anmoins, lorsqu’ils le souhaitent, associ�s aux actions de formation continue organis�es par l’agence et b�n�ficient du conseil p�dagogique des inspecteurs de l’�ducation nationale d�tach�s � l’�tranger.
L’Agence accompagne �galement le d�veloppement du r�seau en signant des accords de partenariat qui permettent un pilotage souple, diversifi� et au plus proche de la situation particuli�re des �tablissements. Ce statut interm�diaire entre l’homologation et le conventionnement concerne 6 �tablissements : le lyc�e franco-isra�lien de Tel-Aviv, le lyc�e Th�odore Monod d’Abou Dabi, la section fran�aise de l’�cole europ�enne de Taipei, l’�cole internationale fran�aise de Bali, l’�cole fran�aise de Tachkent et l’Interkulturelle Schule de Br�me.
La tutelle qu’exercent les ambassades est elle aussi fonction de la nature de l’�tablissement. Les postes sont �troitement associ�s par l’agence aux d�cisions concernant les �tablissements en gestion directe. S’agissant des �tablissements conventionn�s, l’ambassadeur ou son conseiller de coop�ration et d’action culturelle sont souvent membres de droit des conseils de gestion.
Le nombre total d’enfants fran�ais dans le r�seau des �tablissements en gestion directe ou conventionn�s �volue comme suit : 78 640 �l�ves en 2007-2008 et 82 221 �l�ves en 2008-2009. Quant au nombre d’�l�ves �trangers, il �tait de 89 332 en 2007-2008 et de 91 371 en 2008-2009. Le r�seau continue donc � s’�tendre, en nombre d’�tablissement comme de par le nombre d’�l�ves accueillis.
Le r�seau � respire � �galement, puisque chaque ann�e interviennent des ouvertures, des fermetures et des changements de statut. Au titre des entr�es r�centes dans le r�seau, citons notamment le Centre d’appui � la r�ouverture des �tablissements d’enseignement fran�ais en C�te d’Ivoire, mis en place le 1er septembre 2008 afin de soutenir notamment la r�ouverture du lyc�e fran�ais Blaise Pascal d’Abidjan � la rentr�e 2008, avec un statut d’�tablissement homologu�. Ce dernier a accueilli 950 �l�ves � la rentr�e 2008 et 1 200 �l�ves � la rentr�e 2009.
Parmi les sorties du r�seau :
– le Coll�ge fran�ais de Palma de Majorque, l’�cole fran�aise de Thessalonique et l’�cole fran�aise de Manama ont �t� d�conventionn�s le 1er septembre 2008 dans le cadre d’un passage de relais � la Mission la�que fran�aise. Ces �tablissements restent homologu�s par l’�ducation nationale ;
– l’�cole fran�aise de Taipei a �t� d�conventionn�e au 1er septembre 2008. Un accord de partenariat avec l’AEFE a �t� conclu par cet �tablissement ;
– le Centre pour l’enseignement fran�ais en Afghanistan (CEFA) de Kaboul est g�r� par le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes � partir du 1er septembre 2008. Il n’y a plus d’�l�ves de nationalit� fran�aise dans cet �tablissement ;
– le lyc�e fran�ais de Djeddah a �t� d�conventionn� au 1er septembre 2009 dans le cadre d’un passage de relais � la Mission la�que fran�aise. Il demeure homologu� par le minist�re de l’�ducation nationale ;
– l’�cole fran�aise de Tachkent a �t� d�conventionn�e au 1er septembre 2009, un accord de partenariat avec l’AEFE prenant le relais.
S’agissant des changements de statut :
– le lyc�e fran�ais Charles de Gaulle d’Ankara est pass� du conventionnement � la gestion directe au 1er janvier 2008 ;
– le lyc�e fran�ais Alexandre Yersin de Hanoi a connu le m�me changement au 1er janvier 2009.
Enfin, on enregistre une fermeture r�cente, celle de l’annexe de l’�cole fran�aise Arthur Rimbaud de Limassol � Chypre, au 1er septembre 2008, en raison d’effectifs insuffisants.
En 2010, le lyc�e fran�ais au Kowe�t devrait �tre d�conventionn� � la rentr�e dans le cadre d’un passage de relais � la Mission la�que fran�aise.
L’�volution du r�seau est caract�ris�e par une augmentation du nombre d’�tablissements homologu�s, une l�g�re baisse du nombre d’�tablissements conventionn�s et le d�veloppement depuis 2008 des accords de partenariat. Les d�conventionnements s’inscrivent soit dans le cadre d’un passage de relais � la Mission la�que fran�aise, soit dans le cadre d’un accord de partenariat avec l’AEFE. D’un point de vue budg�taire, ces d�conventionnements et ces accords de partenariat visent � concilier le souci de rationalisation et de r�partition des moyens dont dispose l’Agence avec les besoins qui �manent des �tablissements du r�seau.
b) Quelles suites pour les �tats g�n�raux de l’enseignement fran�ais � l’�tranger ?
Comme l’a souhait� le Pr�sident de la R�publique dans sa lettre de mission adress�e en juillet 2007 au ministre des Affaires �trang�res et europ�ennes, l’�laboration d’un plan de d�veloppement de l’enseignement fran�ais � l’�tranger a donn� lieu, depuis janvier 2008, � une large concertation entre les diff�rents acteurs concern�s (parents d’�l�ves, personnels enseignants, parlementaires, entreprises, administrations, partenaires �trangers), d’abord au sein d’une commission pr�sid�e par M. Yves Aubin de la Messuzi�re, qui a remis son rapport au ministre en juillet 2008, puis � l’occasion d’� �tats g�n�raux �, r�unis � Paris le 2 octobre 2008, et enfin, entre novembre 2008 et f�vrier 2009, dans les 130 pays de notre pr�sence scolaire dans le monde.
116 postes diplomatiques ont r�pondu � la demande du minist�re de proc�der � une concertation, qui a �t� tr�s appr�ci�e par l’ensemble des acteurs et partenaires locaux et a permis de clarifier les positions de chacun. Les �changes ont port� sur une analyse point par point des trente recommandations formul�es dans le rapport. Ces � �tats g�n�raux � ont avant tout d�montr� l’attachement, tant de la communaut� scolaire �largie que des partenaires �trangers, aux �tablissements scolaires fran�ais. Le respect des valeurs et des normes �ducatives fran�aises, garantes de l’unit� et de la coh�rence du r�seau, a fait ainsi l’objet d’un large consensus. L’ensemble des orientations propos�es par la commission a suscit� un int�r�t marqu�. Les personnes consult�es ont insist� sur le fait que le financement crois� et �quilibr� des parents et de l’�tat devait �tre maintenu pour assurer l’existence d’un enseignement fran�ais de qualit�. Les d�bats ont �galement montr� l’importance d’une r�flexion de fond � conduire sur les moyens de conforter la mixit� culturelle, indispensable � nos �tablissements et � la strat�gie d’influence de la France.
�labor� sur la base de ces avis et observations, ainsi que des trente recommandations du rapport, le plan de d�veloppement est d�sormais en cours de finalisation.
c) Un plan de d�veloppement du r�seau dont le volet immobilier est crucial
• En lien avec son minist�re de tutelle, l’AEFE doit � pr�sent �laborer un plan d’orientation strat�gique qu’elle soumettra � son Conseil d’administration � l’automne 2009. Ce plan d’orientation strat�gique devra ensuite aboutir � la production d’un contrat d’objectifs et de performance d’ici � la fin de l’ann�e.
S’il salue la qualit� du fonctionnement de l’AEFE avec son statut actuel, ainsi que les bonnes relations de l’Agence avec sa tutelle comme, par ailleurs, avec le minist�re de l’�ducation nationale, votre Rapporteur estime indispensable que soit mis au point, apr�s plusieurs ann�es de promesses, le contrat d’objectifs et de performance (ou de moyens) dont chaque op�rateur devrait disposer pour optimiser sa gestion. � dire vrai, un contrat de moyens semble bien pr�f�rable, du point de vue budg�taire, � un contrat de performance…
Parall�lement, une mission d’audit constitu�e � la demande du Premier ministre dans le cadre de la RGPP et de la r�vision g�n�rale du fonctionnement des op�rateurs, proc�de de juin � octobre 2009 � l’analyse de la situation de l’AEFE. L’objectif est en particulier d’�tablir un diagnostic et des propositions de r�formes sur les deux missions de l’agence – scolarisation des �l�ves fran�ais et des �l�ves �trangers – dans le contexte nouveau de la prise en charge de la scolarit� des enfants fran�ais, sur les marges de progression de l’autofinancement de l’AEFE par rapport � ses principaux concurrents, sur l’attribution des bourses scolaires, ainsi que sur les perspectives d’�volution du r�seau de l’agence.
Votre Rapporteur sera �videmment tr�s attentif aux r�sultats de cet audit ; il estime que l’Agence aurait besoin de moyens re�us de l’�tat lui permettant de faire face � l’augmentation des effectifs du r�seau (+ 4 200 �l�ves fran�ais � la rentr�e 2007-2008, + 5 600 � la rentr�e 2008-2009), afin de moins solliciter les parents d’�l�ves. Cette remarque vaut d’autant plus que ce sont, de fa�on croissante, les familles �trang�res sur qui repose l’augmentation des �colages. Ces moyens suppl�mentaires, non exclusifs des efforts de bonne gestion de l’Agence, serviraient non seulement � compenser � leur juste co�t les d�penses obligatoires nouvelles – telle la prise en charge des pensions civiles – mais aussi � honorer l’engagement de d�veloppement du r�seau figurant dans la lettre de mission du ministre des Affaires �trang�res et europ�ennes. Cela passe notamment par une mise � niveau de l’immobilier du r�seau.
• Depuis 2005, l’AEFE prend en charge les op�rations immobili�res pour les biens qui lui sont progressivement remis en dotation par l’�tat. Il s’agit de r�nover le patrimoine existant et d’accompagner le d�veloppement du r�seau (pr�s de 20 000 �l�ves suppl�mentaires en quatre ans).
Les op�rations engag�es depuis 2005 repr�sentent un montant total d’environ 200 millions d’euros. Les financements n�cessaires ont pu �tre r�unis du fait d’une importante participation de l’Agence, le compl�ment n�cessaire �tant assur� par des emprunts dont le remboursement, � la charge des �tablissements b�n�ficiaires et donc des parents d’�l�ves, a suppos� une hausse sensible des droits de scolarit�.
Cette politique ambitieuse n’a �t� rendue possible que par une adaptation du rythme des remises en dotation. En effet, en quatre ans, seuls une douzaine d’�tablissements sur les 138 sites recens�s ont �t� transf�r�s � l’Agence.
Le d�cret n� 2008-1248 du 1er d�cembre 2008 relatif � l’utilisation des immeubles domaniaux a remplac� la proc�dure d’attribution � titre de dotation au profit des �tablissements publics par un nouveau r�gime de conventions d’utilisation par lesquelles l’�tat met � la disposition des �tablissements publics des immeubles domaniaux. La mise en place de cette nouvelle r�glementation pourrait conduire, dans un d�lai rapproch�, � un transfert � l’AEFE de la gestion de la totalit� des �tablissements scolaires fran�ais � l’�tranger.
Cette hypoth�se avait �t� examin�e en 2006 dans le cadre de l’audit de modernisation sur la comp�tence immobili�re de l’AEFE (rapport Auti�-Kahn). Le besoin de financement de l’Agence avait �t� �valu� � environ 240 millions d’euros pendant les premi�res ann�es de gestion, se d�composant en 100 millions d’euros pour le financement de projets de r�novation du patrimoine existant et en 140 millions d’euros pour le financement des projets de construction neuve. Les besoins annuels �taient estim�s � 50 millions d’euros les premi�res ann�es, puis � 30 millions d’euros par an.
L’exp�rience acquise depuis cet audit permet d’avancer que cette estimation est sous-�valu�e. � titre indicatif, les travaux de r�novation des �tablissements de Barcelone, Bruxelles, Lisbonne, Valence et Vienne ont repr�sent� une d�pense de plus de 20 millions d’euros alors qu’ils ne concernent que cinq sites sur les 81 recens�s. Enfin, s’agissant des dotations pour amortissement, l’�valuation du patrimoine qui serait transf�r� � l’Agence est d’environ 700 millions d’euros. L’obligation d’amortir ces biens conduira � une dotation budg�taire aux amortissements d’au moins 14 millions d’euros par an.
Des mesures d’accompagnement, pour permettre � l’Agence d’assumer la nouvelle charge qui lui est confi�e en mati�re d’investissement, seront donc n�cessaires. Il s’agit d’un transfert de moyens financiers au profit de l’Agence de 30 � 50 millions d’euros, au moins les premi�res ann�es, et de la garantie de loyers nuls sur les biens transf�r�s. Sans ces mesures, l’Agence se verra transf�rer la charge d’un patrimoine v�tuste qu’elle ne pourra remettre � niveau, ce qui la placera, sur le plan des responsabilit�s, dans une situation d’une grande fragilit�, et sur le plan de l’image, en situation de faiblesse vis-�-vis des �tablissements anglo-saxons qui disposent g�n�ralement d’installations performantes et entretenues.
On comprend, dans ce contexte, que le bouleversement repr�sent� par la mesure pr�sidentielle de prise en charge complique singuli�rement la t�che de l’Agence.
d) Bourses et prise en charge : une solution � trouver � br�ve �ch�ance
• Les tableaux suivants illustrent la progression du nombre de boursiers au sein du r�seau de l’AEFE et leur r�partition g�ographique :
�VOLUTION DU NOMBRE DE BOURSIERS DANS LE R�SEAU DE L’AEFE (montants en millions d’euros) | ||||||
Rythme nord 2008/2009 |
Rythme sud 2009 |
Total |
Rythme sud 2009 |
Rythme nord 2009/2010 |
Total | |
Nombre de boursiers |
18 355 |
1 502 |
19 857 |
1 502 |
16 345 (p) |
17 847 (p) |
R�partition des boursiers |
92,5 % |
7,5 % |
100 % |
8,4 % |
91,60% |
100 % |
Montant accord� |
49,59 |
6,01 |
55,6 (*) |
6,01 |
50,24 (p) |
56,25 (*) (p) |
R�partition du montant |
89,2 % |
10,8 % |
100 % |
10,7 % |
89,30% |
100 % |
(*) Montant qui n’inclut pas les bourses parascolaires (p) : provisoire Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | ||||||
La dotation de l’AEFE inscrite dans le projet de loi de finances pour 2009 s’�tablissait � 86,1 millions d’euros. Elle a �t� successivement ramen�e en loi de finances initiale � 85,6 millions d’euros et, apr�s application de la r�serve de pr�caution, � 81,82 millions d’euros. Les perspectives pour la fin de l’ann�e budg�taire 2009 s’av�rent d�licates sous l’effet combin� de :
– l’augmentation particuli�rement soutenue des frais de scolarit� ;
– la parit� entre monnaies moins favorable � l’euro (or les bourses scolaires sont garanties aux familles dans la monnaie d’appel des frais de scolarit�) ;
– l’accroissement sensible du nombre de demandes, du fait de l’attractivit� du r�seau, du retour dans leur pays d’origine de nombreuses familles binationales, et du contexte de crise internationale concourant � la paup�risation d’une partie de la communaut� fran�aise.
Votre Rapporteur relaie donc la demande des gestionnaires pour que soit obtenu le d�gel, d�s que possible, de la totalit� des cr�dits mis en r�serve et restant disponibles.
• La dotation demand�e dans le pr�sent projet de loi de finances devrait atteindre 106,2 millions d’euros, soit une progression de 23 % par rapport � 2009. Cette augmentation est �videmment justifi�e en grande partie par la mise en œuvre sur l’ensemble des classes de lyc�e de la r�forme lanc�e en 2007 par le Pr�sident de la R�publique.
�VOLUTION DES PRISES EN CHARGE ACCORD�ES DE 2007 � 2009 (*) (montants en euros) | |||||
Classes concern�es |
Nombres de familles |
Nombre de b�n�ficiaires |
Montant total accord� |
Co�t moyen | |
Rythme nord 2007/2008 |
Terminale |
2 053 |
2 097 |
7 280 799 |
3 472 |
Rythme sud 2008 |
Terminale et premi�re |
245 |
254 |
1 024 428 |
4 033 |
Rythme nord 2008/2009 |
Terminale et premi�re |
4 811 |
5 045 |
18 901 888 |
3 747 |
Rythme sud 2009 |
Terminale, premi�re et seconde |
433 |
480 |
2 228 804 |
4 643 |
Rythme nord 2009/2010 |
Terminale, premi�re et seconde |
7 283 |
8 112 |
33 991 452 |
4 190 |
(*) Ces cr�dits sont inscrits sur le programme 151 Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires, et par cons�quent comment�s dans l’avis budg�taire de Mme Genevi�ve Colot, doc. AN n� 1970, tome I. Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | |||||
L’augmentation est �galement li�e � une hausse tr�s importante du co�t des bourses scolaires, pass� de 47 millions d’euros en 2007 � 59 millions d’euros en 2009 (en incluant les bourses parascolaires), et �valu� � 70 millions d’euros en 2010. Face � cette situation, des mesures d’encadrement de la d�pense ont �t� d�cid�es cet �t� et seront mises en place pour �viter la d�rive des co�ts d�s la rentr�e scolaire 2010 (en mars pour le rythme sud, en septembre pour le rythme nord) :
– les dossiers d�pos�s hors d�lai seront ipso facto irrecevables ;
– la part du revenu disponible des familles affect�e aux frais de scolarit� progressera de 5 %, rehaussant d’autant le seuil d’�ligibilit� aux bourses ;
– pour les fratries, les droits � bourse seront calcul�s en excluant le montant des frais couverts par la mesure de gratuit�, ce qui l� encore rar�fiera l’�ligibilit� aux bourses. Par ce biais, certaines familles dont tous les enfants �taient pris en charge � 100 % perdront ce statut, � niveau de revenu pourtant inchang�. Ce cas de figure concret a �t� expos� � votre Rapporteur par une m�re de famille de Santiago du Chili ;
– le montant de la prise en charge sera retenu sur la base des tarifs en vigueur lors du lancement de la r�forme pr�sidentielle, c’est-�-dire � la rentr�e 2007, dans les lyc�es homologu�s. Il s’agit � tr�s juste titre de supprimer l’effet d’aubaine qui confinait � l’enrichissement sans cause pour les lyc�es homologu�s augmentant de fa�on �hont�e les �colages aux frais du contribuable ;
– un plus grand contr�le sera exerc� sur les bourses parascolaires.
Ces mesures sont, pour certaines, logiques sinon bienvenues, et pour d’autres, symptomatiques d’une d�rive qu’il est indispensable d’endiguer.
e) Un amendement pour l’�quit�
Lors de son audition devant la commission des Affaires �trang�res le 13 octobre dernier, le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes d�clarait, en r�ponse � votre Rapporteur : � En ce qui concerne l’enseignement fran�ais � l’�tranger, le moratoire qui a �t� d�cid� va permettre de faire le point sur la situation et de trouver la meilleure solution pour l’avenir, en corrigeant les injustices. Nous devons notamment veiller � ce que la gratuit� offerte aux Fran�ais ne p�nalise pas les �l�ves �trangers. Nous pourrons sans doute vous pr�senter notre bilan au milieu de l’ann�e 2010. �
C’est admettre qu’il y a des injustices dans le syst�me existant, et qu’il y a p�nalisation des �l�ves �trangers. Le bilan est connu ; point n’est besoin d’attendre la mi-2010. Amendons le pr�sent projet de loi de finances. C’est ce que vous proposera votre Rapporteur de la fa�on suivante : au nom de consid�rations �l�mentaires d’�quit� – entre familles expatri�es mais aussi entre contribuables m�tropolitains et ressortissants expatri�s –, l’amendement qu’il d�posera consistera � diminuer de 10 millions d’euros les cr�dits de l’action Acc�s des �l�ves fran�ais au r�seau AEFE du programme Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires, dot�e de 106,2 millions d’euros pour 2010, en augmentation de plus de 20 millions d’euros par rapport � la loi de finances initiale pour 2009.
Cette diminution correspond � la mise en œuvre imm�diate, par l’AEFE et sa tutelle, d’un plafonnement des revenus pris en compte pour rendre les familles �ligibles � la prise en charge. Ce plafond est � fixer par voie r�glementaire en fonction des revenus bruts des familles, selon un bar�me variable par pays de r�sidence, sur le m�me mod�le que celui appliqu� au calcul des bourses ordinaires. Une telle proposition est raisonnable, �quitable et applicable pour l’ann�e budg�taire 2010 en rythme sud comme en rythme nord.
Contrairement � ce que pr�voyait l’amendement adopt� l’an dernier par la commission unanime, avant qu’il ne soit rejet� en s�ance publique, il n’est pas propos� de plafonner le montant des frais de scolarit� eux-m�mes ; en effet, il ne serait pas juste de priver d’une prise en charge totale les familles qui, sur crit�res de revenus, pouvaient y pr�tendre avant la mise en place de la mesure pr�sidentielle. En outre, la � cristallisation � de la prise en charge au niveau de 2007, �voqu�e plus haut, a d�j� �t� d�cid�e par l’AEFE.
Par ailleurs, le m�me amendement proposera d’augmenter du m�me montant les cr�dits de l’AEFE, afin de conforter le programme immobilier de l’Agence qui, depuis qu’elle a repris de l’�tat la comp�tence immobili�re pour le r�seau des lyc�es fran�ais, se trouve confront�e � un r�el manque de moyens dans ce domaine.
II – LA R�FORME DU R�SEAU CULTUREL :
RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS
A – La France rayonne par sa culture via des moyens que le minist�re s’efforce de mieux coordonner
1) Le point de d�part : le r�seau et ses trois types de structures
Le r�seau culturel est constitu� de trois type de structures : d’une part les services de coop�ration et d’action culturelle (SCAC) qui sont directement int�gr�s aux ambassades, et d’autre part, les instituts et les centres culturels, �tablissements culturels � autonomie financi�re (EAF) ainsi que les Alliances fran�aises, ces derni�res �tant des �tablissements de droit local qui, soutenus par le minist�re, participent activement au rayonnement culturel de la France.
• Les services de coop�ration et d’action culturelle (SCAC) suivent g�n�ralement l’�volution de l’ambassade � laquelle ils appartiennent. Leur importance (en termes de ressources humaines et budg�taires) peut �voluer alors m�me que l’ambassade est maintenue. Par ailleurs, la constitution − par exemple dans le cadre d’ambassades � gestion simplifi�e − d’un p�le unique r�gional implique la disparition des SCAC. C’est le cas en Am�rique centrale o� un seul p�le au Costa Rica couvre les six pays de la zone.
Les SCAC utilisent les moyens qui leur sont d�l�gu�s par le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes dans le cadre de l’ex�cution d’une programmation.
• Les �tablissements � autonomie financi�re sont les op�rateurs privil�gi�s des actions mises en œuvre dans leur domaine de comp�tence. Ils connaissent depuis quelques ann�es une �volution en profondeur que motive avant tout le souci de donner aux missions qu’ils exercent le maximum d’efficacit� et d’impact. Un certain nombre d’entre eux, particuli�rement en Europe, ont �t� ferm�s ou le seront dans un avenir proche :
− soit au profit de la cr�ation d’un consulat d’influence regroupant l’essentiel de leurs fonctions (S�ville, Bilbao) ;
− soit au profit d’EAF sis dans le m�me pays (Berlin, Ankara ou Dakar) ;
− soit au profit d’autres formules plus adapt�es. Plusieurs Instituts fran�ais ont ainsi �t� ferm�s en Allemagne, des charg�s de mission �tant en corollaire institu�s aupr�s des pr�sidences de Land. En Italie, le centre culturel de Turin devrait �voluer vers une double structure : d�l�gation culturelle et Alliance fran�aise � laquelle serait confi�e l’organisation des cours de langue.
D’autre part, partout o� les EAF ne constituent pas un p�le majeur d’influence, du fait de la richesse du tissu culturel ou scientifique local, leur format est modifi� par l’externalisation de leurs activit�s au sein de structures du pays d’accueil. Enfin, lorsque les activit�s d’un EAF ne sont pas compl�mentaires d’Alliances fran�aises locales (les v�ritables � doublons � sont cependant assez rares) une r�flexion est men�e en vue de faire dispara�tre l’un des deux �tablissements : � Nairobi ou � Lagos, l’EAF dispara�t au profit de l’Alliance, tandis qu’� Dakar, se produit une �volution en faveur de l’Institut.
En revanche, particuli�rement dans les pays en voie de d�veloppement et dans les pays �mergents, les instituts culturels ont vocation � rester les p�les majeurs qu’ils sont d�j�, m�me si une partie assez importante de leurs missions s’effectue � hors les murs �. Ils se concentrent essentiellement sur la promotion de l’enseignement sup�rieur, la mise en œuvre de la diversit� culturelle, l’ing�nierie culturelle, le d�bat d’id�es, les cours de fran�ais sp�cialis�s et autres sujets � forte valeur ajout�e.
Dans tous les cas de figure, l’�volution des EAF doit tenir compte de ce que repr�sente pour les partenaires la pr�sence ancienne et souvent fortement symbolique d’�tablissements consid�r�s comme faisant partie du patrimoine local : lorsque l’Institut fran�ais de Vienne a esquiss� l’abandon des seuls cours de fran�ais non sp�cialis�s, il s’est heurt� � des contestations auxquelles ont particip� les plus hautes autorit�s autrichiennes.
Afin d’am�liorer la visibilit� de l’action fran�aise � l’�tranger et de rationaliser le dispositif fran�ais, le Conseil de modernisation des politiques publiques a recommand� la fusion des �tablissements � autonomie financi�re et des services de coop�ration et d’action culturelle en des �tablissements dot�s de la plus large autonomie de gestion (cf. infra).
Parall�lement, dans le cadre de la r�forme annonc�e par le ministre, un plan de red�ploiement du r�seau des centres culturels et instituts est propos�. Il s’appuie sur des crit�res �conomiques et de visibilit� des �tablissements culturels en r�ponse aux arbitrages budg�taires connus. Enfin, la mise en place d’�tablissements culturels europ�ens, avec nos partenaires de l’Union europ�enne, est �galement encourag�e. � cet �gard, il convient de souligner que la collaboration avec les Allemands est beaucoup plus pouss�e qu’avec les Britanniques, les Espagnols ou les Italiens. Il existe ainsi des �tablissements culturels franco-allemands � Ramallah, et bient�t � Moscou.
Le tableau ci-dessous retrace les montants des budgets r�alis�s en 2008 et pr�visionnels pour 2009 ainsi que le total des charges de fonctionnement et de la dotation vers�e par le minist�re pour chacune de ces structures. L’autofinancement est d�fini par le ratio entre les recettes propres et les d�penses de fonctionnement des �tablissements, exprim� en pourcentage. La notion d’autofinancement � avec expatri�s � prend en compte, dans les charges de fonctionnement, le co�t des personnels expatri�s affect�s dans les �tablissements.
AUTOFINANCEMENT DES �TABLISSEMENTS � AUTONOMIE FINANCI�RE (en millions d’euros) | ||||||
Programme 185 |
Programme 209 |
R�seau des 130 instituts | ||||
2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
2008 |
2009 | |
Budget |
81,74 |
78,86 |
83,86 |
89,82 |
165,6 |
168,69 |
Charges de fonctionnement |
75,65 |
77,01 |
77,81 |
86,61 |
153,47 |
163,62 |
Recettes propres |
55,81 |
52,32 |
39,86 |
43,7 |
95,67 |
96,02 |
Autofinancement |
74 % |
68 % |
51 % |
50 % |
61 % |
58 % |
Autofinancement avec expatri�s |
59 % |
55 % |
39 % |
40 % |
48 % |
46 % |
Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | ||||||
Ce tableau fait appara�tre un taux d’autofinancement hors expatri�s tr�s proche de l’objectif de 60 %. La prise en compte des r�mun�rations des expatri�s ram�ne la valeur cible de cet indicateur � 50 %. La r�duction de la masse salariale des agents expatri�s affect�s dans ces �tablissements ainsi que celle des agents de recrutement global (42 % du budget) est l’une des principales pistes suivies pour augmenter l’autofinancement des instituts et des centres culturels.
L’augmentation des recettes propres constitue �galement une priorit� : par l’autofinancement des cours d’abord ; par une recherche syst�matique de co-financements �galement.
• Le r�seau fran�ais s’appuie �galement sur des structures de droit local que constituent les Alliances fran�aises. Le r�seau des Alliances conna�t une extension significative dans certains pays comme la Chine ou la Russie.
2) Les Alliances fran�aises, fer de lance de la promotion de notre langue
a) Mieux s’appuyer sur les Alliances fran�aises
• Les 1 007 alliances fran�aises, r�parties dans 136 pays, et dont les statuts sont reconnus par la Fondation Alliance fran�aise cr��e en 2007 pour jouer le r�le de � t�te de r�seau �, sont des associations de droit local. 783 d’entre elles enseignent le fran�ais, 486 sont soutenues par le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes − auquel elles sont li�es par des conventions de partenariat −, et 225 sont dirig�es par des agents expatri�s fran�ais ou des volontaires internationaux. Les alliances fran�aises disposent des moyens financiers et humains suivants :
− environ 8 500 administrateurs b�n�voles, environ 9 000 enseignants recrut�s localement pour quelque 492 461 �tudiants, 228 cadres expatri�s et 96 volontaires internationaux mis � leur disposition par le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. Le co�t pour l’�tat de la r�mun�ration des expatri�s et des volontaires s’�tablit � 27,8 millions d’euros ;
− des recettes propres totales provenant essentiellement des activit�s de cours pour environ 100 millions d’euros, des subventions apport�es par les ambassades de 7,8 millions d’euros en 2008, un soutien apport� par le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes aux projets immobiliers pour 1 million d’euros en 2008, et des subventions publiques locales ainsi que des financements priv�s pour environ 6 millions d’euros.
Le taux d’autofinancement des Alliances fran�aises soutenues par la France �tait de 77 % en 2007, taux tenant compte du co�t des agents mis � la disposition des Alliances par le Quai d’Orsay.
Les Alliances fran�aises sur lesquelles s’appuie le minist�re forment avec les centres et instituts culturels fran�ais � l’�tranger un r�seau unique o� chaque �l�ment concourt � quatre missions fondamentales : le d�veloppement de l’enseignement et de l’usage de la langue fran�aise, le soutien � la diffusion de la culture fran�aise et au dialogue entre les cultures, le d�bat d’id�es � partir du d�veloppement de m�diath�ques sur la France contemporaine et la promotion des �tudes sup�rieures en France. Le pilotage de l’action de ces Alliances fran�aises se fait par la mise � disposition d’agents qui restent sous l’autorit� des ambassadeurs et par la mise en place de conventions de partenariat pr�cisant les objectifs et les moyens accord�s � ces associations.
Les Alliances fran�aises aid�es par la France se situent principalement dans les zones g�ographiques o� les �tablissements culturels fran�ais � autonomie financi�re sont peu nombreux (Am�riques, Asie et Oc�anie). Dans certains pays, elles ont connu ces derni�res ann�es un d�veloppement remarquable. C’est le cas notamment de la Russie et de la Chine, o� le D�partement a, depuis quelques ann�es, souhait� et soutenu leur cr�ation. Dans les pays o� les alliances fran�aises sont implant�es depuis de tr�s nombreuses ann�es, elles ont �galement enregistr� une progression notable de leurs activit�s, ainsi qu’une diversification de leurs missions (Inde, Br�sil, P�rou, Venezuela par exemple).
Il est des cas o� l’Alliance fran�aise s’est substitu�e � des services existants du minist�re. En 2008, cela s’est produit � Buenos Aires avec la suppression du poste d’attach� de coop�ration pour le fran�ais, l’action linguistique �tant transf�r�e � l’Alliance fran�aise. Toujours � compter de 2008, au P�rou, en �quateur, en Bolivie, au Kenya ou en Am�rique centrale, les Alliances assurent des fonctions jusqu’ici confi�es aux attach�s culturels. Et � Chisinau en Moldavie, l’ambassade confie � l’Alliance des missions de coop�ration en mati�re de gouvernance et de mise en œuvre des r�gles de l’�tat de droit. Pour l’avenir, la fermeture de l’Institut fran�ais d’�cosse et la cr�ation d’une Alliance fran�aise sont envisag�es.
Les Alliances fran�aises reprennent aussi l’action d’information sur les �tudes en France, confi�e � l’op�rateur Campus France � Paris. Ainsi, la cellule d’information est souvent situ�e dans les locaux des Alliances qui assurent dans certains cas la gestion du personnel d�di�.
Ces transferts d’activit� vers les Alliances fran�aises renforcent la coh�rence de l’action culturelle et linguistique des postes. Ils permettent �galement d’optimiser les moyens humains et financiers mis en œuvre par ce minist�re. Il devra toutefois �tre tenu compte, dans tout nouvel effort de rationalisation de notre r�seau, des missions �largies qui ont �t� confi�es � ces alliances fran�aises.
�VOLUTION DE LA SUBVENTION (en millions d’euros) | ||
2008 |
2009 | |
Alliances fran�aises (via ambassades) |
7,8 |
6,66 |
Immobilier alliances fran�aises |
1 |
− |
Fondation Alliance Fran�aise |
0,82 |
0,8 |
D�l�gations G�n�rales |
1,92 |
2,02 |
Total |
11,54 |
9,48 |
Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | ||
Il est pr�vu pour 2010 d’accorder aux Alliances fran�aises une subvention totale de 9,58 millions d’euros.
• Le tableau suivant retrace l’�volution du nombre de personnes inscrites aux cours de fran�ais dans les centres culturels et dans les Alliances fran�aises entre 2007 et 2008 :
�VOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES AUX COURS DE FRAN�AIS (dans une Alliance fran�aise [AF] ou un centre culturel [CCF]) | |||
2007 |
2008 | ||
Programme 185 |
Nombre d’inscriptions en AF |
144 480 |
146 151 |
Nombre d’inscriptions en CCF |
102 902 |
109 315 | |
Total pour P 185 |
247 382 |
255 466 | |
Programme 209 |
Nombre d’inscriptions en AF |
510 510 |
523 452 |
Nombre d’inscriptions en CCF |
181 596 |
193 016 | |
Total pour P 209 |
692 106 |
716 468 | |
Ensemble du r�seau |
Nombre d’inscriptions en AF |
654990 |
669 603 |
Nombre d’inscriptions en CCF |
284 498 |
302 331 | |
TOTAL |
939 488 |
971 934 | |
Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | |||
L’analyse synth�tique de ces r�sultats fait appara�tre que le nombre de personnes inscrites aux cours de fran�ais dans les �tablissements culturels (centres culturels et Alliances) a augment� globalement de pr�s de 3,5 % entre 2007 et 2008. L’objectif de 5 % d’augmentation fix� pour 2008 a �t� atteint par les instituts et les centres culturels (+ 6,3 %) ; l’augmentation des inscrits dans les Alliances reste en revanche en dessous de cet objectif (+ 2,2 %).
• Dans le cadre de la RGPP, le D�partement m�ne actuellement une r�flexion de fond sur l’�volution de son r�seau et de ses op�rateurs.
Le relev� d’observations provisoires de la Cour des comptes remis au D�partement en juin 2009 rel�ve que la vitalit� de l’Alliance fran�aise et son caract�re de � quasi-service public � sont un atout pour la pr�sence culturelle fran�aise � l’�tranger. Il souligne la n�cessit� pour le minist�re de mieux d�finir sa strat�gie d’ensemble vis-�-vis de la Fondation Alliance fran�aise et des cercles locaux. Il demande notamment que la Fondation s’attache � contr�ler plus rigoureusement les conditions d’obtention du label � Alliance fran�aise �, que soient mieux distingu�es les responsabilit�s de la Fondation et celles des postes, et qu’il soit mis fin aux circuits de financement atypiques li�s � la fonction de d�l�gu� g�n�ral.
Au cours de l’ann�e 2009, le D�partement s’attachera donc � clarifier les fonctions et responsabilit�s de chacun tout en associant �troitement la Fondation Alliance fran�aise aux d�cisions la concernant.
b) Ne pas abandonner la promotion du fran�ais
Les moyens budg�taires, hors titre 2, affect�s � la politique de rayonnement de la langue fran�aise sont les suivants au cours des trois derni�res ann�es : 13,82 millions d’euros en 2007 (apr�s r�serve l�gale), 14,2 millions d’euros en 2008 et 10,97 millions d’euros en 2009. Conform�ment � la trajectoire arr�t�e lors de l’�tablissement du projet du premier � triennium budg�taire �, les cr�dits pour 2010 devraient diminuer de 12,8 %.
2009 voit s’achever le plan triennal de relance du fran�ais (2007-2009), qui comportait cinq initiatives ambitieuses dont trois concernent les pays relevant du programme 185 : la promotion du fran�ais et du plurilinguisme, le programme d’utilisation renforc�e des technologies de l’information et de la communication au service de l’enseignement pour l’apprentissage de la langue fran�aise (hors pays francophones) ainsi que la formation des professeurs et les �changes scolaires.
Votre Rapporteur souhaite que la politique de promotion du fran�ais ne soit pas r�duite � la portion congrue dans l’action des postes. En parall�le, il appelle � maintenir l’effort en faveur de la francophonie dans le cadre du programme 209 Solidarit� � l’�gard des pays en d�veloppement.
3) CulturesFrance, embl�matique metteur en sc�ne des saisons culturelles
a) L’op�rateur met en œuvre un contrat d’objectifs et de moyens
• CulturesFrance, en liaison avec les institutions culturelles fran�aises et avec le r�seau culturel fran�ais � l’�tranger, exerce une mission d’op�rateur au service des �changes culturels internationaux et de l’aide au d�veloppement culturel. Elle est notamment charg�e de :
− la promotion � l’�tranger de la cr�ation contemporaine fran�aise dans les domaines des arts visuels, des arts de la sc�ne, de l’architecture, du patrimoine, y compris cin�matographique, de l’�crit et de l’ing�nierie culturelle ;
− l’organisation de saisons culturelles en France et � l’�tranger (cf. infra) ;
− la conception, la production et la diffusion de produits culturels adapt�s aux publics �trangers ;
− la mise en œuvre de la politique d’aide au d�veloppement dans le secteur de la culture � travers des actions de formation, des �changes avec les cultures du monde, l’accueil des artistes et des auteurs ;
− la mise en œuvre de projets contribuant � l’�mergence d’une Europe de la culture ;
− la mobilisation de nouveaux partenaires ext�rieurs � l’�tat (collectivit�s locales, fondations et grands m�c�nes).
En 2009, son p�rim�tre d’action a �t� �largi puisque lui a �t� confi�e la diffusion du cin�ma et du documentaire, le fonds d’Alembert (promotion du d�bat d’id�es) et le programme d’aide � la publication.
• CulturesFrance entretient avec les postes des �changes r�guliers dans le cadre de l’exercice annuel de programmation culturelle et artistique. Le processus de programmation a �t� revu fin 2008 et se d�compose d�sormais de la fa�on suivante :
− mise en ligne sur le site Internet de CulturesFrance au printemps et � l’automne d’appels � projets � destination des postes et de tous porteurs de projets ;
− organisation pendant l’�t� de rencontres entre le r�seau et CulturesFrance qui permettent d’expliciter, de commenter et de discuter des projets avec les postes ;
− organisation pendant l’�t� et en septembre-octobre des r�unions r�gionales de programmation � l’issue desquelles les postes sont en mesure d’�laborer avec CulturesFrance et le D�partement une programmation qui doit �galement satisfaire aux exigences d’une coh�rence r�gionale. Aux c�t�s des conseillers de coop�ration et d’action culturelle et des attach�s culturels, le r�le des directeurs d’�tablissements culturels est particuli�rement important � l’occasion de ces r�unions.
Ind�pendamment des appels � projets, les postes peuvent � tout moment solliciter CulturesFrance et b�n�ficier de l’expertise des charg�s de mission sectoriels de l’Agence � l’occasion du montage de leurs projets.
• CulturesFrance est l’op�rateur commun du minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes et du minist�re de la Culture et de la communication. Un contrat d’objectifs et de moyens a �t� sign� le 2 mai 2007 entre l’op�rateur et ses deux tutelles pour une dur�e de trois ans. Ce contrat comporte 22 indicateurs portant sur les objectifs op�rationnels de l’association et la qualit� de sa gestion. Lors de la derni�re restitution, sur les 22 indicateurs, 21 ont �t� jug�s satisfaisants.
Lors du Conseil d’administration du 3 juillet 2009, le climat positif des relations entre l’op�rateur et sa tutelle a �t� soulign�. Les objectifs strat�giques annuels fix�s ont �t� globalement atteints, notamment une politique de r�duction des frais de fonctionnement et de la masse salariale.
• Dans le budget primitif de l’ann�e 2009, l’agence, qui a encore aujourd’hui un statut d’association, dispose de 28 millions d’euros. Ses tutelles, le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes et le minist�re de la Culture et de la communication, contribuent � son budget respectivement � hauteur de 77 % (soit la m�me proportion qu’en 2008) et de 6,7 % (8,6 % en 2008).
Le tableau suivant, extrait du PAP, retrace l’�volution du budget de CulturesFrance :
�VOLUTION DU BUDGET PR�VISIONNEL DE CULTURESFRANCE (en millions d’euros) | |||||
D�penses |
Ex�cution 2008 |
Budget pr�visionnel 2009 |
Recettes |
Ex�cution 2008 |
Budget pr�visionnel 2009 |
Personnel |
5 596 |
5 927 |
Ressources de l’�tat |
19 213 |
18 506 |
Fonctionnement |
28 523 |
25 538 |
Subventions de l’�tat |
19 213 |
18 506 |
Intervention |
Ressources fiscales |
||||
Autres subventions |
959 |
1 115 | |||
Ressources propres et autres |
14 798 |
14 188 | |||
Total des d�penses |
34 119 |
34 465 |
Total des recettes |
34 970 |
33 809 |
R�sultat : b�n�fice |
851 |
R�sultat : perte |
656 | ||
Total : �quilibre du compte de r�sultat |
34 970 |
34 465 |
Total : �quilibre du compte de r�sultat |
34 970 |
34 465 |
Source : projet annuel de performances du programme 185 pour 2010. | |||||
Toujours selon le PAP, les emplois de l’op�rateur �voluent comme suit :
�VOLUTION DU TABLEAU DES EMPLOIS DE CULTURESFRANCE | |||
R�alisation 2008 (*) |
Budget pr�visionnel 2009 |
Pr�vision 2010 | |
Emplois (ETP) r�mun�r�s par l’op�rateur |
96 |
99 |
99 |
dont emplois sous plafond op�rateurs |
88 |
93 |
93 |
dont emplois hors plafond op�rateurs |
8 |
6 |
6 |
Autres emplois (ETPT) en fonction dans l’op�rateur |
16 |
13 |
13 |
dont emplois r�mun�r�s par l’�tat sur le programme |
7 |
7 |
6 |
dont emplois r�mun�r�s par l’�tat via un autre programme de rattachement |
6 |
6 |
7 |
dont emplois r�mun�r�s par d’autres collectivit�s ou organismes |
3 |
0 |
0 |
(*) Les emplois r�mun�r�s par les op�rateurs sont pr�sent�s � titre indicatif pour 2008 selon les modalit�s pr�vues pour 2009. Source : projet annuel de performances du programme 185 pour 2010. | |||
b) Les Saisons culturelles remportent de beaux succ�s
• Le temps est venu de dresser le bilan d�finitif de la Saison culturelle europ�enne :
Bilan de la Saison culturelle europ�enne (1er juillet-31 d�cembre 2008)
Plus de 300 manifestations exceptionnelles, pr�sent�es partout en France et dans les grandes capitales de l’Europe, ont jalonn� cette saison, volet culturel de la Pr�sidence fran�aise du Conseil de l’Union europ�enne. Pour la premi�re fois, chacun des 27 pays a contribu� � fa�onner la programmation d’un �v�nement culturel in�dit et de grande ampleur, permettant ainsi de pr�senter la culture europ�enne dans toute sa diversit�.
Un foisonnement culturel qui s’est notamment traduit par :
• 235 artistes contemporains europ�ens, plasticiens et photographes, dont le travail a �t� pr�sent� en France, ainsi que 70 ateliers europ�ens d’architecture et de design ;
• 135 compagnies europ�ennes de th��tre, danse et arts de la rue invit�es sur les sc�nes fran�aises ;
• 52 orchestres et ensembles classiques europ�ens invit�s en France, ainsi que 80 groupes rock, pop ou �lectro ;
• 250 films projet�s dans plus de 50 villes et 15 festivals, en pr�sence de 27 r�alisateurs ;
• 105 rencontres avec 27 �crivains europ�ens dans 80 villes ;
• 27 Le�ons d’Histoire ;
• 53 grandes expositions ;
Un succ�s public avec par exemple :
• 10 000 visiteurs pour la � Nuit de l’Europe � dans le cadre de Nuit blanche le 4 octobre ;
• 15 000 �l�ves de coll�ges et de lyc�es impliqu�s dans 10 projets phares comme � La semaine de l’Europe � l’�cole �, � Pariscience � ou � 10 mois d’�cole et d’op�ra � ;
• 15 000 visiteurs par mois en 6 mois sur le site cr�� par l’INA pour l’occasion : � L’Europe des cultures �.
Plus encore que la force du nombre, c’est la diversit� et la qualit� des cr�ations artistiques propos�es qui auront marqu� ces six mois.
• La Saison a en effet permis � des artistes jeunes ou �mergents, venus de toute l’Europe, de se faire conna�tre pour la premi�re fois du public fran�ais : du dramaturge su�dois Janas Hassen Khemiri (Festival d’Avignon) � la com�dienne irlandaise Olwenn Fou�r� (Th��tre des Bouffes du Nord), de l’ensemble baroque slovaque � Solamente naturali � (Op�ra de Saint-�tienne) au plasticien chypriote Th�odoulos Gregoriou (Mus�e du Louvre), de l’�crivain allemand Daniel Kehlman (Universit� de Bourgogne) aux photographes n�erlandais d’Exyst (rame du Thalys pellicul�e circulant de Paris � Rotterdam).
• Elle a �t� l’occasion de d�couvrir ou de retrouver des grandes figures et institutions qui se sont engag�es dans des collaborations exceptionnelles : Akram Khan et Juliette Binoche, Aldo Ciccolini et l’Orchestre de Luxembourg, Marc Minkowski et l’ensemble Sinfonia Varsovia, Maria de Medeiros et Emmanuel Demarcy-Mota.
• Partout en France, les grands rendez-vous artistiques se sont ainsi mis � l’heure europ�enne au second semestre 2008 : le Festival d’Avignon et le Festival d’Automne, � Musica � et � Marsatac �, la Technoparade et � Nuit blanche �, les Rencontres d’Arles de la photographie et la Biennale internationale du design de Saint-�tienne, les Transmusicales de Rennes et le Mois europ�en de la photographie.
• Plusieurs manifestations exceptionnelles ont symbolis� cette initiative : l’exposition � L’Art en Europe � au Domaine de Pommery depuis le 1er juillet, les bals du 14 juillet aux couleurs de l’Europe � Paris, Lyon et Bordeaux, l’illumination de la Grand Place de Bruxelles par le plasticien Yann Kersal� � l’automne, le grand rassemblement � Hip-Hop Europe � au Palais de Chaillot le 1er novembre, � Dans la nuit, des images � sous la nef du Grand Palais du 17 au 31 d�cembre.
• Au-del� de ce semestre, la tourn�e europ�enne de la Com�die-Fran�aise en 2009 s’est poursuivie dans 10 pays d’Europe centrale et orientale, le prix Nobel de litt�rature Imre Ketresz �tait pr�sent le 15 janvier au Th��tre de l’Od�on en conclusion du Tour de France des �crivains europ�ens, les 27 cr�ations graphiques qui ont habill� les a�roports parisiens durant l’�t� ont �t� expos�es au Luxembourg et en R�publique tch�que.
La Saison culturelle europ�enne continue d’exister virtuellement � travers son site Internet www.ue2008.fr/saison-culturelle-europeenne qui restera en ligne deux ans.
Comit�s de pilotage (r�union mensuelle, g�om�trie variable)
Commission europ�enne ; Pr�sidence de la R�publique ; Premier ministre ; SGPFUE ; MAEE (DGCID, DCE, cabinet) ; Secr�tariat d’�tat aux affaires europ�ennes (cabinet) ; MCC/DAEI ; MINEDUC ; MSJS ; CulturesFrance ; Commissariat g�n�ral.
• Commissariat
Pr�sident : M. Renaud Donnedieu de Vabres, Ambassadeur charg� de la dimension culturelle de la pr�sidence fran�aise de l’Union europ�enne
Commissaire g�n�ral : M. Laurent Burin des Roziers (MAEE)
Commissaire adjointe : Mme Carole Scipion (MINEDUC)
• Minist�res et SGPFUE : 4 216 400 euros, dont 2 359 000 euros pour le SGPFUE, 274 400 euros pour le MAEE et 1 183 000 euros pour le minist�re de la Culture cumul�s sur deux exercices (2007/2008) + 100 000 euros pour le minist�re de la Sant� et des sports et 300 000 euros pour le minist�re de l’�ducation nationale
• Soci�t�s d’artistes et partenaires com. : 39 000 euros, dont 9 000 euros pour la SACD, 25 000 euros pour la SACEM et 5 000 euros pour Arte
• Postes diplomatiques / Ambassades UE � Paris : 30 000 euros, dont 15 000 euros pour l’Ambassade des Pays-Bas et 15 000 euros pour l’Ambassade d’Allemagne
• CulturesFrance : 357 500 euros, dont 249 500 euros au titre de la convention collectivit�s territoriales et 108 000 euros pour le d�partement artistique
• M�c�nat : 1 325 000 euros (Total, Dexia, Thalys, Suez Electrabel, Suez, France Telecom, Fondation Orange, Fondation Lagard�re, Caisse des d�p�ts et consignations, RET, Air France, GDF, Leventis)
• �changes marchandises : 6 000 euros, dont 5 000 euros pour Absat et 1 000 euros pour Arte.
• D’autres saisons sont en cours ; d’autres encore � venir.
− L’ann�e de la France au Br�sil – � Fran�a.Br 2009 � (21 avril-15 novembre 2009)
L’Ann�e du Br�sil en France, en 2005, avait connu un vif succ�s. D�sireux de poursuivre les partenariats nou�s � cette occasion, les deux Pr�sidents de la R�publique ont d�cid� d’organiser un grand �v�nement retour, une Ann�e de la France au Br�sil, � Fran�a.br 2009 �, couvrant tous les domaines de nos relations.
La France est d�j� tr�s pr�sente au Br�sil. L’Ann�e ne vise donc pas � la faire d�couvrir aux Br�siliens. Elle a surtout pour ambition de compl�ter et d’affiner cette connaissance en valorisant nos capacit�s de cr�ation et d’innovation dans des secteurs o� le Br�sil ne nous attend pas toujours : la France aujourd’hui (cr�ation contemporaine, recherche et innovation) ; la France diverse (pluralit� des cultures, diversit� r�gionale) ; la France ouverte (d�bat d’id�es, ouverture sur le monde).
Sur 1 500 projets �tudi�s, 700 ont �t� labellis�s par les deux commissariats. Organis� dans les principales villes br�siliennes, cet ensemble de manifestations couvre tous les champs : culture, sciences, recherche, �conomie, commerce, technologie, environnement, sport. Fran�a.Br 2009 a �t� lanc�e officiellement par le Pr�sident de la R�publique les 22 et 23 d�cembre 2008, � l’occasion de son d�placement au Br�sil pour le sommet Union europ�enne-Br�sil et ouverte � Rio de Janeiro, le 21 avril dernier, en pr�sence de Mme Christine Albanel, alors ministre de la Culture et de la communication. Le budget global de la saison s’�tablit � 10,17 millions d’euros.
− La saison de la Turquie en France (1er juillet 2009-31 mars 2010)
Faisant �cho au succ�s du � Printemps fran�ais � organis� dans diff�rentes villes turques en 2006, cette saison se donne pour mission, avec plus de 400 �v�nements culturels, �conomiques et intellectuels � travers toute la France (auto-financ�s pour la moiti�) et une tr�s forte implication des collectivit�s territoriales, d’encourager les �changes entre les institutions culturelles et artistiques et les organisations non gouvernementales turques et fran�aises. Sa programmation vise � souligner la volont� de changement et d’ouverture d’une Turquie aux aspects multiples.
La saison a �t� lanc�e officiellement le 30 juin dernier lors d’une conf�rence de presse dans les salons du minist�re de la Culture et de la communication, en pr�sence de M. Ertugrul G�nay, ministre turc de la Culture et du tourisme et de M. Fr�d�ric Mitterrand, ministre fran�ais de la Culture et de la communication. Le budget global de la saison s’�l�ve � 3,75 millions d’euros.
− � Bonjour India � (d�cembre 2009-janvier 2010)
Bonjour India constitue une premi�re tentative de mise en œuvre de manifestations de courte dur�e sur le mod�le des � Printemps fran�ais en Asie �. � l’initiative du poste et soutenu par CulturesFrance, cet �v�nement concentrera sur deux mois une trentaine d’�v�nements phares dans les domaines culturel, scientifique, �conomique et �ducatif. Elle se fera en partenariat avec les collectivit�s territoriales et des entreprises fran�aises. � ce jour, le budget global est de 3,5 millions d’euros.
− L’ann�e France-Russie 2010
L’ann�e France-Russie 2010, est le plus grand rendez-vous de ce type depuis les ann�es crois�es France-Chine. Pendant pr�s d’un an, dans les grandes villes et en r�gions, la France vivra � l’heure russe et la Russie � l’heure fran�aise. Parmi les moments phares de la France en Russie on peut d�j� retenir la tourn�e de la Com�die-Fran�aise � Moscou, Saint-P�tersbourg et dans l’Oural, l’exposition des collections du mus�e Picasso de Paris � Moscou et Saint-P�tersbourg, la venue du ballet de l’Op�ra de Paris � Novossibirsk, la place d’invit�e d’honneur faite � la France au forum �conomique de Saint-P�tersbourg et la soir�e gratuite donn�e, lors de la f�te de Moscou le 4 septembre, sur une partie de la place Rouge avec le DJ fran�ais Laurent Garnier. Le budget global est � ce jour de 6,29 millions d’euros.
− L’ann�e du Mexique en France, enfin, est annonc�e pour 2011 et actuellement en phase pr�paratoire (constitution des commissariats).
4) Le Louvre Abou Dabi, exemple des nouvelles expressions de notre diplomatie culturelle
Aux actions � traditionnelles � de la diplomatie culturelle, s’ajoutent aujourd’hui des missions li�es � l’apparition de nouveaux enjeux, � l’�chelle du monde :
− promouvoir et vendre notre expertise culturelle et artistique (patrimoine, architecture, mus�ographie, action culturelle en faveur du public, archives, biblioth�que, etc.). Face � une demande mondiale d’expertise particuli�rement forte dans le domaine culturel et artistique, la France demeure encore une r�f�rence. Il n’en demeure pas moins qu’elle se heurte � une tr�s forte concurrence, souvent plus rapide et plus efficace � r�pondre aux attentes des pays demandeurs. Il s’agit par cons�quent de dynamiser notre capacit� de prospection et de proposition en mati�re d’expertise. En cela le r�seau culturel est notre principal atout.
− renforcer la pr�sence de nos industries culturelles dans les pays � march� dynamique et dans les pays �mergents. Les industries culturelles contribuent en effet � la relance de l’�conomie et � la modernisation de l’offre culturelle fran�aise. Pour parvenir � cet objectif, notre action culturelle va s’appuyer de plus en plus sur l’industrie num�rique dont les ressources sont consid�rables y compris par voie de t�l�chargement : musique, cin�ma, patrimoine, librairies en ligne, etc.
Plus encore que les ann�es pr�c�dentes, les postes seront encourag�s � d�multiplier les financements publics en produisant un effet de levier gr�ce au d�veloppement du � r�seautage � et des actions de m�c�nat.
Par ailleurs, dans la perspective d’un recours croissant au num�rique pour augmenter l’impact de notre politique culturelle, une subvention exceptionnelle devrait �tre accord�e aux postes afin qu’ils puissent effectuer les investissements qui leur permettront de prendre le virage des technologies num�riques.
Dans le domaine culturel, l’exercice de programmation pour 2010 tiendra compte des contraintes budg�taires en s’effor�ant de maintenir un effort important pour les pays dits � prescripteurs � : �tats-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, grands pays �mergents (Chine, Inde, Br�sil) et �mirats Arabes Unis o� une politique tr�s ambitieuse de d�veloppement culturel est mise en œuvre.
Le Louvre Abou Dabi, un projet de mus�e universel
Les �mirats Arabes Unis ont pour ambition de devenir � la fois le cœur de la r�gion du Golfe pour l’enseignement sup�rieur et la culture et le lieu de rencontre et d’�changes entre les civilisations, au carrefour des continents.
Dans ce cadre, l’�mirat d’Abou Dabi a lanc� sur l’�le de Saadiyat de la capitale �mirienne, un projet de district culturel, d’envergure mondiale. Apr�s s’�tre tourn� une premi�re fois vers l’expertise fran�aise en mati�re d’enseignement sup�rieur, avec l’installation � l’automne 2006 d’une antenne de la Sorbonne, Abou Dabi a choisi la France et le Louvre pour l’aider � r�aliser et � d�velopper un projet de mus�e universel.
L’accord culturel d’�tat � �tat qu’on sign� la France et les �mirats Arabes Unis (5) a donc pour objet la r�alisation d’un mus�e universel, qui contribuera au dialogue, � la compr�hension mutuelle et � l’amiti� des deux pays et, plus largement, des deux civilisations. Ce mus�e r�pondra aux crit�res de qualit� les plus exigeants, qu’il s’agisse de la pertinence de son discours scientifique et culturel, de sa conception architecturale, confi�e � Jean Nouvel, et de sa r�alisation technique. Les pr�sentations mus�ographiques du mus�e rassembleront des objets repr�sentatifs du patrimoine artistique conserv� en France. Afin de porter le message universel et humaniste voulu par les deux pays, tout en mettant l’accent sur la p�riode classique, elles seront ouvertes � toutes les techniques, � toutes les civilisations et � toutes les �poques, y compris la p�riode contemporaine.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux et garantir la qualit� du projet � toutes ses �tapes et dans tous ses aspects, la France a propos� � Abou Dabi une aide globale.
L’expertise fran�aise aidera Abou Dabi � s’assurer que la conception et la r�alisation du b�timent seront conformes aux standards de conservation, de pr�sentation des œuvres et d’accueil du public des grands mus�es internationaux. Les conservateurs et historiens d’art fran�ais, qui seront charg�s d’�laborer le projet scientifique et culturel du mus�e, aideront Abou Dabi � traduire en langage artistique et mus�ographique un discours d’ouverture et de tol�rance. Pour une p�riode de dix ans � compter de l’ouverture du mus�e, dans l’attente de la constitution de la collection du mus�e d’Abou Dabi, des œuvres issues des collections du Louvre, des autres mus�es nationaux fran�ais et des mus�es de France qui souhaiteront participer au projet serviront de support � ce discours. La France s’engage donc sur cette p�riode � pr�ter plusieurs centaines d’œuvres, pour des dur�es au plus �gales � deux ans et par rotation. Pour accompagner la formation de la collection �mirienne, des experts fran�ais proposeront une strat�gie d’acquisition et des conseils de d�ontologie en la mati�re. Pour une dur�e de quinze ans � compter de l’ouverture du mus�e, la programmation d’expositions temporaires sera con�ue et mise en œuvre par la France.
Enfin, la France conseillera Abou Dabi pour la mise en place de la future structure de gestion du mus�e, participera � la formation de ses cadres et accompagnera pendant une dur�e de vingt ans le fonctionnement du mus�e, afin de lui permettre de conforter sa place dans le paysage des institutions mus�ales internationales.
L’accord repr�sente un montant de l’ordre de 1 milliard d’euros sur trente ans, qui b�n�ficieront au mus�e du Louvre et aux autres mus�es de France pour des projets scientifiques nouveaux, sans diminution de leurs moyens budg�taires actuels.
Marque de confiance in�dite et signe de l’ambition commune des deux pays, le mus�e d’Abou Dabi joindra � son nom celui du plus beau et plus grand mus�e du monde, le Louvre. Ce geste sans pr�c�dent n’est rendu possible que gr�ce � la coop�ration globale ainsi con�ue par la France et les �mirats.
B – L’ach�vement de la r�forme de notre � diplomatie d’influence � attendra
1) Un rapprochement d�j� engag� sur le terrain entre les services de coop�ration et d’action culturelle et les �tablissements du r�seau
• La carte des implantations culturelles en Europe fait l’objet d’�volutions ces derni�res ann�es, afin de contribuer � la r�sorption des doublons institutionnels, principalement entre Alliances fran�aises et �tablissements culturels, voire entre �tablissements eux-m�mes (au Luxembourg par exemple). C’est ce que retrace le tableau suivant :
�VOLUTION DU R�SEAU CULTUREL EN EUROPE | ||
Ouverture |
Fermeture | |
2004 |
Sarrebruck, Porto et Graz | |
2005 |
Gand et G�nes | |
2006 |
Saragosse |
Cologne, Dresde, S�ville |
2007 |
Bilbao | |
2008 |
Rostock | |
2009 |
Br�me, D�sseldorf, Francfort, Hambourg, Leipzig, Mayence, Munich, Stuttgart (transform�s en antennes de Berlin). | |
Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | ||
Ces fermetures ne sont donc jamais des � fermetures s�ches �. Par ailleurs, votre Rapporteur rappelle que les fermetures d’�tablissements culturels ne se traduisent pas imm�diatement par des �conomies budg�taires importantes. En effet, � court terme, la fermeture d’un �tablissement implique des licenciements entra�nant le versement d’indemnit�s.
Quant � la carte des implantations culturelles hors d’Europe, elle continue � �voluer �galement :
�VOLUTION DU R�SEAU CULTUREL HORS D’EUROPE | ||
Ouverture |
Fermeture | |
2005 |
Abuja |
Nairobi |
2006 |
Lagos | |
2007 |
Yogyakarta |
|
2008 |
Erbil (antenne de Bagdad) |
|
2009 |
Saint-Louis du S�n�gal (transform� en antenne de Dakar). Istanbul, Izmir (transform�s en antenne d’Ankara) | |
Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | ||
Par ailleurs, afin de renforcer l’attractivit� de la France aupr�s des �tudiants �trangers, faisant suite � l’exp�rience men�e en Chine, 30 centres pour les �tudes en France (CEF), plates-formes de services pour l’accueil et l’orientation des �tudiants, ont �t� ouverts depuis 2005. Au total, ces 30 pays repr�sentent plus de 75 % des demandes de visas de long s�jour pour �tudes (VLSE).
• La r�forme de notre dispositif culturel � l’�tranger d�j� en cours en application des d�cisions de 2008 du Conseil de modernisation des politiques publiques, l’instance de pilotage de la RGPP, s’est traduite en 2009 pour certains de nos postes diplomatiques par le rapprochement, au sein d’une structure unique par pays, des services de coop�ration et d’action culturelle et des instituts ou centres culturels.
Ainsi pour l’Allemagne et la Turquie, la mise en œuvre de ce regroupement a entra�n� la fermeture des �tablissements situ�s en province, devenant des antennes de l’�tablissement situ� dans la capitale. Le nombre d’�tablissements � autonomie financi�re a ainsi �t� ramen� � 50 relevant du programme 185.
Le � chantier culturel � de l’ambassade de Berlin, poste pilote de la RGPP
La diminution des cr�dits d’action culturelle de 25 % en 2007 et 2008 puis de 15 % en 2009 a conduit le poste � r�clamer l’absence de nouvelle baisse pour 2010, faute de quoi les moyens manqueraient pour entretenir ne serait-ce qu’un minimum de coop�ration avec les L�nder, comp�tents dans ce domaine.
De 24 instituts culturels en 1997, le total est tomb� � 11 aujourd’hui (dont un de taille tr�s modeste) ; la derni�re fermeture en date est celle de Rostock l’an dernier. L’attach�e culturelle en poste � Hanovre n’est pas remplac�e, l’�tablissement de Francfort fusionne avec l’institut de recherche de G�ttingen et des �conomies ont �t� demand�es � toutes les structures. Or les questions de coop�ration culturelle rev�tent une dimension historique importante et sont un symbole de la relation franco-allemande.
D’ailleurs d’autres �tats d�veloppent leur coop�ration dans ce domaine ; c’est ainsi que le plus grand Institut Cervant�s d’Europe vient d’ouvrir � Francfort.
Les dix instituts restants ont �t� regroup�s pour leur gestion, dans la droite ligne des pr�conisations issues de la RGPP, en un unique �tablissement � autonomie financi�re. La clart� de ce dispositif, son pilotage et la dimension du fonds de roulement disponible sont les atouts les plus manifestes de cette r�forme. L’autofinancement de cette politique atteint 60 % et l’effet de levier des fonds publics dans ce domaine est de 2,5 !
Les �tablissements ont d�sormais un urgent besoin de � pr�visibilit� � � moyen et long termes des moyens leur �tant allou�s ; car rien n’est pire que de s’engager dans un projet de coop�ration puis de devoir s’en retirer faute de moyens.
La fusion des SCAC et des �tablissements � autonomie financi�re s’inspire d’un mod�le d�j� en œuvre dans le r�seau au sein d’un nombre limit� de pays : les centres culturels et de coop�ration, qui regroupent les fonctions relevant des SCAC et celles relevant des EAF avec un budget unique dans le cadre de l’autonomie financi�re. C’est le cas notamment � Tunis, Mexico, Ath�nes, Sofia et au Caire. Une exp�rimentation dans 13 autres postes a �t� mise en place en 2009.
Mais cette r�forme ne s’inscrit pas dans une coh�rence parfaite avec celle qui est actuellement en cours en vue de la cr�ation d’une agence culturelle ext�rieure, notamment � cause d’un certain nombre d’obstacles juridiques, comptables, mais aussi � cause des choix d’ampleur que suppose cette r�forme pour l’architecture m�me du minist�re (cf. infra).
2) Une administration centrale fra�chement r�organis�e avec la cr�ation de la direction g�n�rale de la mondialisation
• Au niveau de l’administration centrale, le d�cret du 16 mars 2009 portant cr�ation de la direction g�n�rale de la mondialisation, du d�veloppement et des partenariats (DGM), par fusion de l’ancienne DGCID, de la direction des affaires �conomiques et des services �conomiques de la direction des Nations unies, a permis de cr�er un cadre institutionnel � m�me de renforcer l’action du minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes en mati�re de pilotage strat�gique et d’exercice de la tutelle des op�rateurs.
Il s’agit de l’une des plus importantes r�formes du minist�re depuis la fusion des minist�res des Affaires �trang�res et de la Coop�ration en 1998. Au-del� de la construction du nouvel organigramme et du d�m�nagement des services sur le site de la rue de la Convention, un v�ritable projet global, portant sur les objectifs et les m�thodes de travail, a �t� mis en place.
L’organisation du Quai d’Orsay s’adapte ainsi � la nouvelle donne internationale et � la multiplication des acteurs : davantage d’anticipation, davantage d’interminist�riel et d’europ�en, davantage de r�activit� et d’interdisciplinarit�. Mais surtout davantage d’ouverture vers l’ext�rieur, via des partenariats renforc�s avec les ONG, les universit�s et centres de recherche, les collectivit�s territoriales, le secteur priv� et, bien s�r tous les partenaires �trangers de la France. Avec la DGM, direction strat�ge et pilote de la diplomatie d’influence et de solidarit�, est poursuivi l’objectif d’une relation nouvelle avec les op�rateurs du minist�re que sont l’AEFE, CulturesFrance ou Campus France, gr�ce � un partage des t�ches plus clair et op�rationnel.
• Pour relever ses nombreux d�fis, la DGM s’est fix� pour priorit� de s’impr�gner d’une culture de r�sultat. L’�valuation, le contr�le de gestion et l’audit constituent, au sein de la Mission des programmes du Service des programmes et du r�seau, les trois volets d’une d�marche globale de performance qui vise � renforcer le pilotage strat�gique et la prise de d�cision � l’administration centrale, dans le r�seau et chez les op�rateurs ayant sign� un contrat d’objectifs et de moyens.
L’architecture du volet � performance � du PAP 2009 avait ainsi �t� revue pour tenir compte de la lettre de mission du Pr�sident de la R�publique et du Premier ministre au ministre des Affaires �trang�res et europ�ennes :


La maquette 2010 n’a donc �t� modifi�e qu’� la marge. Par exemple, l’indicateur � Nombre de visites sur le site de l’ADIT (6) d�di� � la base de connaissances produite par les services scientifiques � a �t� affin�. Celui-ci est devenu un sous-indicateur et le � co�t moyen d’une visite � vient compl�ter cette mesure afin d’obtenir l’indicateur suivant : � Fr�quentation et efficience du site de l’ADIT d�di� � la base de connaissances produite par les services scientifiques �, plus ax� sur la performance.
Si cet effort est tr�s louable, votre Rapporteur n’en demeure pas moins convaincu, comme l’ann�e derni�re, qu’il est beaucoup trop r�ducteur, sinon inappropri�, de faire de cet indicateur le seul qui permette, au sein du programme 185, de mesurer l’atteinte de l’objectif � Relever les d�fis de la mondialisation �.
Pour le reste, il faut saluer le souci manifest� dans le PAP de commenter et de justifier les valeurs retenues pour les pr�visions et les cibles affich�es pour 2010 et 2011 (page 103 du PAP par exemple, � propos du nombre d’�l�ves inscrits dans les cursus francophones).
Le contr�le de gestion, ou plus exactement le pilotage par les indicateurs, est en phase d’extension dans le r�seau : 50 services de coop�ration et d’action culturelle, repr�sentant pr�s de 54 % des cr�dits d�l�gu�s, participent actuellement � cet exercice, dont 24 pour le programme 185. Les postes remplissent chaque semestre un tableau de bord, qui a pour ambition d’am�liorer le pilotage en interne et de cr�er un syst�me de remont�e d’informations au D�partement. Les r�sultats sont ensuite diffus�s dans les services notamment � l’aide d’une base de donn�es. Un effort de communication et de p�dagogie est �galement men� aupr�s des personnels du r�seau afin de donner chair au concept de gestion par la performance.
La formation des agents du r�seau culturel sera justement l’un des r�les d�volus � la future agence culturelle dont la cr�ation a �t� plusieurs fois report�e. La premi�re �tape de cette cr�ation est contenue dans un projet de loi en instance d’examen au S�nat qui comprend notamment la transformation de CulturesFrance et de Campus France.
3) La transformation programm�e de CulturesFrance et de CampusFrance
a) De CulturesFrance au nouvel op�rateur culturel : un processus pr�vu de longue date
Le projet de loi d�pos� au S�nat le 22 juillet dernier pr�cise les contours juridiques et les missions de la future agence culturelle. Celle-ci se substituerait � l’association CulturesFrance dont elle reprendrait de plein droit et en pleine propri�t� les biens, droits et obligations et aurait le statut d’EPIC pour l’action culturelle ext�rieure. C’est le d�cret relatif � son organisation administrative, financi�re et comptable qui pr�cisera les modalit�s de la tutelle de l’�tablissement ainsi que son organisation et ses relations avec les postes diplomatiques et avec le r�seau culturel.
Le financement de cette agence culturelle proviendra � la fois des pouvoirs publics et des ressources propres de l’�tablissement. La cr�ation d’un �tablissement public doit justement permettre une recherche plus efficace de financements ext�rieurs et de co-financements.
La premi�re �tape de l’�volution de CulturesFrance vers une agence culturelle a �t� r�alis�e d�but 2009, avec le transfert des cr�dits du livre et de l’audiovisuel. La cr�ation de l’�tablissement public conduira � doter l’op�rateur de comp�tences compl�mentaires : programmes de fran�ais, formation des agents expatri�s et recrut�s locaux, qui doivent en faire l’instrument privil�gi� de la relance de notre action culturelle � l’�tranger.
b) Le nouvel op�rateur de la mobilit� : un sch�ma intangible ?
• Le m�me projet de loi pr�voit la cr�ation d’un �tablissement public � caract�re industriel et commercial charg� de d�velopper l’expertise et la mobilit� internationales. La mission de cet �tablissement sera de contribuer au renforcement de l’attractivit� et au rayonnement de la France, notamment � travers la promotion de la mobilit� internationale des �tudiants, boursiers ou non, le d�veloppement des partenariats universitaires et de l’expertise fran�aise. L’�tablissement sera issu de la fusion de l’association � Egide �, charg�e de la gestion des programmes de mobilit� internationale de l’�tat, et de deux groupements d’int�r�t public : � France coop�ration internationale �, charg� de l’appui aux op�rateurs nationaux et de la promotion de l’expertise fran�aise, et � Campus France �, charg� de la promotion de l’enseignement sup�rieur fran�ais. Le texte organise le transfert des activit�s pr�c�demment exerc�es par ces trois entit�s vers le nouvel op�rateur, ainsi que le transfert au nouvel �tablissement des diff�rentes cat�gories de personnels des trois entit�s dissoutes.
Cet �tablissement public sera charg� de promouvoir l’expertise fran�aise � l’�tranger, de concourir au d�veloppement de la mobilit� internationale et de faire conna�tre le syst�me d’enseignement sup�rieur et de formation professionnelle fran�ais � l’�tranger. Le nouveau directeur g�n�ral du GIP FCI nomm� par le conseil d’administration du 16 juin 2009, est mandat� par le ministre pour mettre en place cet op�rateur dans un souci de rationalisation et de maintien de la qualit� et du soutien � l’attractivit�. Un contrat d’objectifs et de moyens sera n�goci� entre le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes, les autres minist�res concern�s et le nouvel op�rateur.
• C’est pour votre Rapporteur l’occasion de faire un bref point de situation de Campus France, dont le budget 2009 s’�l�ve � 6,26 millions d’euros, financ�s � hauteur de 4 millions par des subventions de l’�tat et de pr�s de 2 millions d’euros par des ressources propres (prestations de service et produits des adh�sions des membres). La subvention du minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes s’�l�ve � 1,17 million d’euros en 2009.
En 2009, l’Agence CampusFrance forme une �quipe de 35 agents dont 22 agents contractuels non titulaires, 5 fonctionnaires d�tach�s sur contrat et 8 fonctionnaires mis � disposition, dont un par le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes.
Les priorit�s actuelles de l’action de CampusFrance : sont le renforcement de son action en Europe, l’int�gration de l’Afrique suite � la fusion du r�seau des centres pour les �tudes en France (CEF) et des bureaux de l’ancien EduFrance, l’am�lioration de l’accueil des �tudiants �trangers au sein des Espaces CampusFrance, ainsi que la refonte de son site Internet � mondial � et des sites � locaux � � destination de l’�tudiant, � professionnel � � destination des adh�rents et partenaires.
En rappelant que la convention constitutive du GIP CampusFrance pr�cisait que l’agence, cr��e � titre temporaire pour trois ans, avait pour objectif de pr�figurer l’int�gration de ses activit�s avec celles, d’une part, de l’association Egide et, d’autre part, du CNOUS, pour la partie qui concerne les �tudiants �trangers, autour d’un champ de missions nouveau, dans le cadre juridique ad�quat et dans le respect des �quilibres financiers de ces op�rateurs, votre Rapporteur note que telle n’a pas �t� l’orientation retenue dans le projet de loi d�pos� au S�nat ; les d�bats sur ce projet devront donc clarifier cette situation.
4) Quelle place dans la r�forme pour les instituts fran�ais de recherche � l’�tranger ?
L’ensemble des 27 instituts fran�ais de recherche � l’�tranger (IFRE) constitue un r�seau unique s’�tendant � toutes les parties du monde. Les cinq instituts install�s en Europe, ainsi que ceux de Tokyo, Hong Kong et J�rusalem rel�vent du programme Rayonnement culturel et scientifique, les autres du programme Solidarit� � l’�gard des pays en d�veloppement.
LES INSTITUTS FRAN�AIS DE RECHERCHE � L’�TRANGER (en milliers d’euros) | ||||||||
Pays |
Ville |
�tablissement |
Montant budget 2008 |
Dotation globale 2008 |
Dotation fonct 2008 uniquement |
Montant budget 2009 |
Dotation globale 2009 |
Dotation fonct 2009 uniquement |
Allemagne |
Berlin |
CRSS – Centre franco-allemand de la recherche en sciences sociales (Marc Bloch) |
946,5 |
196,6 |
150 |
1 042,3 |
307,3 |
127,5 |
Allemagne |
G�ttingen |
MHFA – Mission historique fran�aise de G�ttingen |
330,3 |
190 |
190 |
0 |
0 |
0 |
Chine |
Hong- |
CEFC – Centre d’�tudes fran�aises sur la Chine contemporaine |
507,5 |
255,6 |
191,4 |
513,2 |
255,3 |
200 |
Grande-Bretagne |
Oxford |
MFO – Maison fran�aise d’Oxford |
537,3 |
310,4 |
248,6 |
460,3 |
231,5 |
224,5 |
Isra�l |
J�rusalem |
CRFJ – Centre de recherche fran�ais de J�rusalem |
254 815 |
185 |
125 |
294,8 |
209,9 |
125 |
Japon |
Tokyo |
MFJ – Maison franco-japonaise |
631,7 |
372 |
360 |
665,1 |
308 |
306 |
R�p tch�que |
Prague |
CEFRES – Centre fran�ais de recherches en sciences sociales |
354,2 |
217 |
185,3 |
334,7 |
225,9 |
185,3 |
Russie (Cr�ation 2007) |
Moscou |
CFRM – Centre franco-russe en sciences sociales de Moscou |
284,7 |
203 |
50 |
260,4 |
192,5 |
42,5 |
Total pour le prg 185 |
3 847,1 |
1 929,7 |
1 500,3 |
3 570,7 |
1 730,4 |
1 210,8 | ||
Total pour l’ensemble des IFRE |
13 012,3 |
7 352,1 |
6 598,9 |
12 746 |
7 348,2 |
5 872,8 | ||
Source : minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. | ||||||||
L’aide globale apport�e � ces instituts est en l�g�re diminution cette ann�e. Elle s’�levait � 7,352 millions d’euros en 2008 et � 7,348 millions d’euros en 2009. Cette aide comprend :
– la dotation de fonctionnement vers�e par le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes et programm�e chaque ann�e par les postes ;
– les cr�dits d’intervention allou�s par le m�me minist�re, qui permettent d’accueillir des boursiers fran�ais ou europ�ens, de promouvoir le d�bat d’id�es par la tenue de s�minaires et colloques, et de financer des programmes sp�cifiques de recherche, soit sur demande du poste, soit sur demande du D�partement ;
– diverses sources de cofinancement provenant du minist�re de l’Enseignement sup�rieur et de la recherche, du CNRS et de partenaires locaux publics ou priv�s.
Il convient de souligner la part importante que repr�sentent, pour le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes, les salaires des personnels expatri�s (81 ETP). Si l’on n’enregistre qu’une diminution marginale de l’aide globale apport�e � ces instituts entre 2008 et 2009, on note pour la m�me p�riode une baisse de l’ordre de 11 % de la dotation de fonctionnement. Cette diminution est en grande partie compens�e par une augmentation des apports ext�rieurs.
L’aide pr�vue en 2010 d�pendra des arbitrages que les postes feront dans le cadre de leurs programmations respectives. D’ores et d�j�, � compter de l’exercice 2010, le financement des bourses d’aide � la recherche pour les doctorants ne sera plus assur� par le minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes. Il deviendra � l’�vidence n�cessaire de d�velopper les partenariats actuels et d’en cr�er de nouveaux afin d’augmenter la part des cofinancements.
D’une fa�on plus g�n�rale, les modalit�s d’�volution de ces 27 instituts sont actuellement � l’�tude et li�es au p�rim�tre de la future agence culturelle. Sans attendre cette r�forme, la Mission historique de G�ttingen a �t�, en 2009, transform�e en institut fran�ais d’histoire en Allemagne, par fusion avec l’institut culturel et convention avec l’universit� de Francfort. Sans en �tre le cœur, ce sujet sera l’un des aspects � suivre lors de la mise en place d�finitive de la r�forme, c’est-�-dire dans quelques ann�es encore, semble-t-il.
5) Quel avenir pour le r�seau culturel � l’horizon de trois ans ?
� bien des �gards, la r�forme annonc�e du r�seau culturel et de son pilotage a pris cette ann�e des allures de feuilleton, dont les �pisodes sont les suivants :
– sur fond de pol�mique quant � la nette diminution en 2009 des moyens d’intervention des postes en mati�re culturelle, le ministre des Affaires �trang�res et europ�ennes a, au mois de mars, annonc� en conf�rence de presse, parmi d’autres chantiers de modernisation du minist�re, une ambitieuse r�forme de l’action culturelle ext�rieure. On pouvait lire dans la plaquette de pr�sentation, � propos de la cr�ation d’une grande agence culturelle : � Une �quipe de pr�figuration compos�e de parlementaires et de personnalit�s de la culture pr�cisera d’ici juillet 2009 les contours de cette agence et le calendrier de sa mise en marche. Sa cr�ation sera propos�e au Parlement dans le cadre d’un projet de loi � ;
– l’�quipe de pr�figuration a, semble-t-il, propos� plusieurs sch�mas au ministre, qui devait annoncer sa d�cision au Palais des Congr�s, � l’occasion des Journ�es du r�seau, le rendez-vous annuel des acteurs de l’action culturelle et de la coop�ration. Or l’annonce a �t� celle d’un report de la d�cision, afin de prendre le temps de la concertation au sein du r�seau ;
– c’est dans ce contexte qu’a �t� d�pos� au S�nat, le jour de son adoption par le Conseil des ministres du 22 juillet, un projet de loi relatif � l’action ext�rieure de l’�tat (7) qui cr�e la cat�gorie des � �tablissements publics contribuant � l’action ext�rieure de la France �, forme particuli�re d’EPIC, et institue les deux premiers d’entre eux. Il s’agit tout d’abord de l’�tablissement public pour l’expertise et la mobilit� internationales, successeur de l’association Egide et des GIP Campus France et France coop�ration internationale. Il s’agit ensuite de l’�tablissement public pour l’action culturelle ext�rieure, successeur de CulturesFrance ;
– le 28 ao�t dernier, dans son discours de cl�ture de la Conf�rence des ambassadeurs, le ministre a confirm� avoir confi� cette mission de consultation � Mme Delphine Borione, nouvelle directrice de la politique culturelle et du fran�ais � la DGM. Il a pr�cis� avoir confi� � M. Dominique de Combles de Nayves, fin connaisseur du minist�re et membre actif de la Commission du Livre blanc en 2007-2008, une expertise des questions techniques pos�es par la r�organisation envisag�e. Le questionnaire �tait le suivant :
QUESTIONNAIRE AUX POSTES SUR LA R�ORGANISATION DU R�SEAU CULTUREL
I – Cons�quences statutaires et fiscales, dans votre pays de r�sidence, d’un �ventuel rattachement des �tablissements � autonomie financi�re – centres culturels et instituts fran�ais – � un �tablissement public dont le si�ge serait � Paris
1 – La convention de Vienne (art. 1) fait r�f�rence � la notion de mission diplomatique. Cette notion s’applique-t-elle actuellement aux EAF de votre pays de r�sidence et s’appliquerait-elle dans l’hypoth�se de leur rattachement � l’EPIC ?
2 – Quel serait le statut juridique et fiscal de la repr�sentation locale de cet EPIC en comparaison de celui accord� actuellement � des �tablissements rattach�s � d’autres �tablissements publics fran�ais (exemples : agence AFD, lyc�e en gestion directe, Ubifrance…) ?
* � quelle imposition les activit�s commerciales des CCF et des IF de votre pays de r�sidence (cours, certifications, CEF, caf�t�ria, ticketing...) sont-elles aujourd’hui assujetties ? Quelles modifications entra�nerait un rattachement de ces �tablissements � un EPIC?
* Quelles seraient les cons�quences fiscales sur le chiffre d’affaires de la repr�sentation locale, notamment vis-�-vis des recettes externes (m�c�nat, sponsoring…) ?
* Quelles seraient les cons�quences r�glementaires et fiscales d’un transfert de propri�t� notamment en mati�re de taxe fonci�re ?
3 – Quels pouvoirs et comp�tences convient-il que l’ambassadeur d�tienne vis-�-vis de la repr�sentation locale au regard de la programmation des activit�s (programmes et budgets) ?
II – Cons�quences en mati�re de gestion des ressources humaines, dans votre pays de r�sidence, d’un �ventuel rattachement des �tablissements � autonomie financi�re – centres culturels et instituts fran�ais – � un �tablissement public dont le si�ge serait � Paris
A – Personnels expatri�s
1 – Au sein d’une �ventuelle repr�sentation locale de l’EPIC, quel serait le statut juridique et fiscal des personnels expatri�s ? S’ils sont envoy�s par la MAEE ? S’ils sont envoy�s par l’�tablissement public ?
2 – La transformation du statut de l’�tablissement aurait-elle des cons�quences en mati�re d’obtention des visas et permis de travail des personnels envoy�s par le MAE ? Par l’�tablissement public ?
3 – Quels pouvoirs et comp�tences convient-il que l’ambassadeur d�tienne vis-�-vis de la repr�sentation locale au regard de la carri�re des cadres (nomination, �valuation) ?
B – Personnels locaux
1 – Quelles seraient les modalit�s de transfert des agents de droit local d’un SCAC ou d’un EAF vers la repr�sentation locale de l’EPIC ? Cette �volution pourrait-elle reposer sur une continuit� juridique des contrats des int�ress�s ou n�cessiterait-elle une mesure de licenciement de l’ancienne entit� ?
2 – Ce transfert aurait-il des cons�quences pour la fiscalit� pesant sur les agents ?
3 – � quels montants seraient approximativement susceptibles de s’�lever les co�ts induits par le basculement dans l’EPIC des agents de droit local ?
4 – Ce transfert aurait-il des cons�quences sp�cifiques pour les ADL de nationalit� fran�aise (pr�f�rence nationale accrue hors ambassade pour les recrutements, visas, permis de travail) ?
III – Retour d’exp�rience
Quels enseignements retirez-vous de la mise en place des antennes d’UBIFRANCE dans votre pays de r�sidence, en particulier en ce qui concerne la bonne coordination de l’action publique sous votre autorit� ?
Quelles sont les conditions de fonctionnement des op�rateurs linguistiques et culturels de nos partenaires europ�ens ?
IV – Pour les pays o� n’existent pas de centres culturels ou d’instituts fran�ais, sous quelle forme envisagez-vous une repr�sentation de l’EPIC ?
Interrog� par votre Rapporteur � propos du r�sultat de la consultation des postes au cours de son audition par la commission des Affaires �trang�res le 13 octobre dernier, le ministre a indiqu� avoir re�u le rapport de M. de Combles de Nayves trois jours auparavant. Il a �galement d�clar� : � Quant � l’inqui�tude qu’inspirerait la r�forme, elle m’a conduit � envoyer un questionnaire � nos 16 000 agents : nous n’avons eu que 450 r�ponses, dont dix de la part d’ambassadeurs… L’anxi�t� n’est donc peut-�tre pas si grande. �
Quel est le nœud du probl�me ? Non pas tant la transformation de CulturesFrance en EPIC, qui est une r�forme attendue depuis maintenant plusieurs ann�es. Mais l’articulation qui sera instaur�e entre cet EPIC et le r�seau des SCAC, EAF et autres centres et instituts culturels de par le monde. Un article du Monde (8) a expos�, dans la foul�e de l’atermoiement de juillet, la th�se des crispations engendr�es par ce choix d�licat : le r�seau culturel lato sensu doit-il demeurer en l’�tat, �troitement d�pendant de l’administration centrale qu’est la DGM, ou bien doit-il d�pendre en premier ressort de la future agence culturelle ?
Tel �tait donc l’enjeu des annonces minist�rielles attendues d’un jour � l’autre. Par lettre en date du 27 octobre (9) adress�e � l’ensemble des agents du r�seau culturel, le ministre a indiqu� : � Je souhaite qu’apr�s une p�riode de trois ans de mise en œuvre de ce nouveau dispositif [la fusion des centres culturels et des SCAC, sous un nom qui serait le m�me que celui de l’agence parisienne], un rendez-vous soit pris pour �valuer son fonctionnement et envisager le rattachement administratif du r�seau � l’agence. Je suis personnellement favorable � cette �volution, qui n’est toutefois, compte tenu de ses cons�quences administratives et financi�res, envisageable qu’� terme. �
Le ministre a donc d�cid�, comme en juillet dernier… de ne pas trancher. Voil� qui ouvre de nouvelles perspectives � la mission d’information de la commission des Affaires �trang�res sur le rayonnement de la France par l’enseignement et la culture.
Votre Rapporteur serait tent� de faire d�pendre son avis sur le vote des cr�dits du programme Rayonnement culturel et scientifique du sort qui sera r�serv� � l’amendement d’�quit� qu’il propose pour encadrer enfin la co�teuse prise en charge de la scolarit� des �l�ves fran�ais inscrits dans les lyc�es fran�ais � l’�tranger. Ce g�n�reux engagement pr�sidentiel s’est r�v�l�, en pratique, trop lourd d’effets pervers pour ne pas �tre limit� d�sormais.
Ce sujet est en effet embl�matique de la conduite d’une r�forme, et c’est pour cette raison qu’il acquiert une telle valeur symbolique : oui, le r�seau des lyc�es fran�ais de par le monde est capable de s’adapter au changement, � condition que ce changement soit compr�hensible par tous et compatible avec les principes fondateurs de l’enseignement fran�ais � l’�tranger.
De m�me, la r�forme de notre r�seau culturel sera accept�e et r�ussie si elle est convaincante aux yeux des agents qui seront charg�s de la mettre en œuvre, et ce m�me si elle est exigeante. Exigeante, elle le sera certainement si elle est anim�e de la grande ambition que peu de pays peuvent se permettre d’afficher pour leur langue, leur culture, leur patrimoine et leurs valeurs.
De ce point de vue, le nouvel atermoiement minist�riel du 27 octobre, pour prudent qu’il soit, n’est pas forc�ment gage de l’audace que r�clame la r�forme. En outre, les moyens de fonctionnement d�gag�s dans le pr�sent projet de loi de finances sont tout justes suffisants pour nourrir l’ambition proclam�e ; les moyens humains dont notre r�seau est riche peuvent et doivent les d�multiplier. C’est ce pari que votre Rapporteur veut formuler ; rendez-vous est pris pour la mission d’information sur le rayonnement de la France par l’enseignement et la culture, qui ach�vera ses travaux dans quelques mois, et qui, peut-�tre, demandera au Gouvernement de h�ter la r�forme qu’il fait miroiter depuis maintenant un certain temps.
Au cours de sa r�union du 13 octobre 2009, la commission a entendu M. Bernard Kouchner, ministre des affaires �trang�res et europ�ennes, sur les cr�dits de la mission � Action ext�rieure de l’Etat � pour 2010.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Monsieur le ministre, nous avons le plaisir de vous recevoir � nouveau, pour une audition cette fois exclusivement consacr�e au budget 2010 de votre minist�re et � la r�forme du r�seau diplomatique.
Cette ann�e, les cr�dits de la mission � Action ext�rieure de l’�tat � seront examin�s en s�ance publique, et non plus en commission �largie.
MM. Jacques Myard et Jean-Michel Boucheron. Tr�s bien !
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Cet examen aura lieu le mardi 3 novembre prochain � 9 heures 30, apr�s la pr�sentation de ces cr�dits en commission par les rapporteurs, Genevi�ve Colot et Fran�ois Rochebloine, le mercredi 28 octobre dans la matin�e.
Monsieur le ministre, je vous laisse la parole.
M. Bernard Kouchner, ministre des affaires �trang�res et europ�ennes. La mission � Action ext�rieure de l’�tat � recouvre quatre �l�ments. Premi�rement, les moyens du r�seau diplomatique, consulaire et de l’action culturelle dans les pays d�velopp�s. Deuxi�mement, les contributions internationales de la France au syst�me des Nations unies et aux organisations europ�ennes. Troisi�mement, les cr�dits en faveur des Fran�ais � l’�tranger – bourses, action sociale – et ceux de l’Agence pour l’enseignement fran�ais � l’�tranger (AEFE). Enfin, les moyens de notre diplomatie d’influence � destination des pays de l’OCDE, le reste des cr�dits de coop�ration culturelle relevant de la mission interminist�rielle �Aide publique au d�veloppement �. Les cr�dits de cette mission seront examin�s en commission �largie le 10 novembre.
Je commencerai par un motif de satisfaction : le projet de budget pour 2010 du minist�re des affaires �trang�res et europ�ennes est en augmentation. Avec 4,9 milliards d’euros, contre 4,6 en 2009, il est en progression de 11 % en cr�dits d’engagement et de 7 % en cr�dits de paiement. Dans un contexte budg�taire tr�s difficile, nous nous sommes efforc�s de concilier la rigueur et les grandes priorit�s diplomatiques, en n’ob�rant en rien les capacit�s d’action de la France � l’�tranger.
Ce budget volontariste est � la fois un budget d’engagement et un budget de r�forme.
C’est tout d’abord un budget d’engagement, dont la progression refl�te les priorit�s de notre diplomatie, qui demeure universelle.
Premi�re priorit� : le soutien au multilat�ralisme et au syst�me onusien. Les contributions aux organisations internationales s’�l�vent � 393 millions d’euros. Elles vont � pr�s de 70 organisations internationales – contre 140 en 2007, un recentrage ayant �t� op�r�. Un effort accru de sinc�rit� budg�taire se traduit par l’inscription de 50 millions d’euros suppl�mentaires pour les op�rations de maintien de la paix, apr�s les 40 millions suppl�mentaires d�j� inscrits en 2009. La France souhaite que les bar�mes de contribution, notamment � l’ONU, soient plus �quitables et qu’ils refl�tent le r�le croissant des pays �mergents, tout en nous permettant de d�gager un peu de marge de manœuvre sur notre budget.
Deuxi�me priorit� : le respect des engagements politiques pris au plus haut niveau de l’�tat, concernant notamment la gratuit� de la scolarisation des �l�ves fran�ais � l’�tranger, �tendue � la classe de seconde.
Les moyens consacr�s aux m�canismes de soutien � la scolarit� progressent de 20 millions d’euros. Ils seront ainsi pass�s de 67 millions en 2008 � 106 millions en 2010 ; pr�s de 30 000 �l�ves – sur 80 000 – b�n�ficient d’une aide � la scolarit�, 9 500 au titre de la mesure de gratuit� et 20 000 au titre des bourses.
Pour autant, je n’oublie pas le d�veloppement du r�seau des lyc�es fran�ais, outil d’influence et source de rayonnement culturel incomparables. L’AEFE voit ainsi sa dotation progresser de 10 millions d’euros pour soutenir le formidable essor du r�seau et l’afflux continu de nouveaux �l�ves.
Troisi�me priorit� : l’action culturelle ext�rieure. Elle b�n�ficie d’une mesure exceptionnelle de 20 millions d’euros dans ce projet de loi de finances, mais ce sont 40 millions additionnels qui nous ont �t� accord�s par le Premier ministre sur deux ans pour accompagner la r�forme de notre dispositif.
Quatri�me priorit� : la s�curit�. Un effort particulier va �tre consenti pour mettre � niveau les dispositifs de s�curit� de nos ambassades, car l’�tat a le devoir de prot�ger ses agents. Dans un contexte international tourment�, la s�curit� des postes diplomatiques est une pr�occupation majeure. La dotation 2010 s’�l�ve � 15,5 millions d’euros, soit une augmentation de 50 % pour les d�penses d’�quipement – s�curit� passive – et la mise en œuvre de moyens humains – s�curit� active –, notamment dans les nouvelles zones de menace. Une trentaine de postes en b�n�ficieront.
Ce budget est en deuxi�me lieu un budget de r�forme. Il traduit le souhait du minist�re de s’inscrire dans l’effort global de ma�trise du train de vie de l’�tat et de modernisation de l’action publique, afin que chaque euro d�pens� soit le plus utile possible.
J’ai d�j� parl�, tout d’abord, de l’effort de sinc�rit� budg�taire. Il se traduit non seulement par l’inscription de 50 millions suppl�mentaires pour les op�rations de maintien de la paix, mais aussi par le r�ajustement des cr�dits de masse salariale, avec l’inscription de 10 millions suppl�mentaires.
S’agissant, ensuite, de la ma�trise du train de vie de l’�tat, nous poursuivons, comme la plupart des minist�res, la diminution des effectifs et des moyens de fonctionnement, gr�ce � une r�forme en profondeur du r�seau diplomatique, consulaire, culturel et de coop�ration.
La modernisation de l’outil diplomatique dans toutes ses composantes permettra de rendre 255 emplois en 2010, soit une r�duction de 2 % des effectifs du minist�re. Ces efforts seront r�partis entre l’administration centrale et l’�tranger, o� ils seront concentr�s sur les grandes ambassades dites � � format d’exception � et les plus petites, c’est-�-dire les trente postes de pr�sence diplomatique pour lesquelles un format-type � 10 postes �quivalents temps plein (ETP) a �t� d�fini. Notre pr�sence n’en reste pas moins universelle, et c’est l’atout de notre diplomatie. Le cœur du m�tier diplomatique – la veille politique, la protection des Fran�ais, la diplomatie d’influence – est pr�serv� partout.
Je souligne que ce minist�re est entr� dans un processus de rationalisation de l’emploi public bien avant les autres, depuis maintenant pr�s de quinze ans. Si nous poursuivons cet effort, il n’en est pas moins imp�ratif de pr�server pour l’avenir une capacit� de red�ploiement interne de nos effectifs, pour les personnels diplomatiques en particulier.
Nos moyens de fonctionnement, � Paris et dans les postes, diminuent aussi de 2 %.
Un mot sur la mise en œuvre de la r�forme du minist�re. 2009 fut l’ann�e de la r�forme de notre administration centrale, celle aussi d’une op�ration immobili�re majeure – l’installation des sites de La Courneuve et de Convention, que je vous invite � visiter – et exemplaire, puisqu’elle s’est faite � co�t nul pour l’�tat. En 2010, nous allons en premier lieu poursuivre la r�forme de nos op�rateurs : transformation de l’op�rateur culturel, cr�ation de l’op�rateur pour la mobilit� ; r�affirmation de notre tutelle politique et strat�gique sur l’Agence fran�aise de d�veloppement. Nous allons d’autre part poursuivre la mutation strat�gique du r�seau, autour du principe g�n�ral de renforcement de l’autorit� de l’ambassadeur comme coordonnateur et animateur des services. Les mots d’ordre seront : regroupement, mutualisation et externalisation, au moins partielle, des fonctions support des services de l’�tat � l’�tranger – achats, intendance, informatique, gestion immobili�re – ; modernisation des services consulaires, avec l’extension de la biom�trie sans ETP suppl�mentaire ; r�organisation de nos dispositifs de diplomatie d’influence.
Quelques remarques enfin sur notre politique d’action culturelle et nos cr�dits d’influence, au cœur de l’outil diplomatique. L’an dernier, je faisais devant vous le constat tr�s regrettable de leur effondrement. Au sein du programme Rayonnement culturel et scientifique, les cr�dits de diplomatie d’influence � destination des pays de la zone OCDE (hors cr�dits de l’AEFE) avaient enregistr� jusqu’� 20 % de baisse. Cette ann�e, les dotations seront stabilis�es – autour de 80 millions d’euros – sur le programme budg�taire 185, et en progression si l’on inclut les cr�dits de la mission � Aide publique au d�veloppement � – 177 millions, soit + 4 % sur le programme 209.
La crise des moyens aura permis de r�v�ler une crise de sens de notre politique, un doute sur les structures, les hommes et les outils. Ce fut le point de d�part d’une r�flexion approfondie sur la modernisation de notre dispositif. J’aurai l’occasion de vous pr�senter les conclusions de cette r�flexion tr�s prochainement, lors du d�bat sur le projet de loi relatif � l’action ext�rieure de l’�tat. Mon objectif est de mettre en place un dispositif plus efficace et plus coh�rent. Cela suppose en particulier une tutelle renforc�e du minist�re des affaires �trang�res et un lien r�nov� entre son agence d’influence et le r�seau d’�tablissements � l’�tranger.
Je terminerai par quelques points qui n�cessitent une vigilance particuli�re.
Le premier est la gestion immobili�re du minist�re, qui doit concilier des imp�ratifs de prestige et des probl�mes r�currents de tr�sorerie.
A l’�tranger, la r�flexion sur un op�rateur immobilier progresse, mais je souhaite que nous puissions pr�server, dans le choix de nos implantations, la double dimension de prestige et de s�curit�.
En France, il nous faut achever l’op�ration de regroupement. Le 37, Quai d’Orsay restera le cœur et l’embl�me de la diplomatie fran�aise. Au terme de sa r�novation, estim�e � 70 millions d’euros � l’horizon 2012-2013, la capacit� d’accueil des bureaux devrait �tre port�e � 1300 agents au lieu de 900 aujourd’hui, et le site enti�rement modernis�. Le minist�re des affaires �trang�res et europ�ennes pourra d�finitivement lib�rer ses implantations r�siduelles, notamment boulevard des Invalides.
Deuxi�me sujet de pr�occupation : l’action sociale. Sa dotation budg�taire passe de 19 � 17,5 millions d’euros. Il nous faut donc trouver des marges de manœuvre, afin de maintenir au mieux notre effort de solidarit� vis-�-vis de nos ressortissants les plus d�munis � l’�tranger. Dans cette perspective, nous devons en particulier mettre � profit les progr�s de la citoyennet� europ�enne et le principe de non-discrimination en mati�re d’action sociale au b�n�fice de nos compatriotes r�sidant dans les pays de l’Union europ�enne. Nos postes consulaires veilleront, en application de ce principe, � ce que nos ressortissants puissent acc�der pleinement aux m�canismes de protection sociale de leur pays de r�sidence.
Enfin, bien que l’aide publique au d�veloppement (APD) ne rel�ve pas de la mission � Action ext�rieure de l’�tat �, je veux souligner l’effort consenti en ce domaine, notamment dans un cadre bilat�ral au titre de l’aide projet, en particulier pour l’aide civile � l’Afghanistan et au Pakistan – avec 50 millions d’euros par an, la France est au sixi�me rang des contributeurs.
Pour atteindre l’objectif d’une APD � 0,7 % du PIB, il nous faudra �tre inventifs. C’est ainsi que j’ai propos� � nos partenaires internationaux une contribution sur les transactions financi�res. Au taux de 0,005 %, soit un pr�l�vement de 5 centimes sur une transaction de 1 000 euros, elle permettrait d�j� de lever 30 milliards d’euros par an.
Dans ce contexte, votre aide et votre relais sont plus que jamais indispensables. Nous avons besoin de vous pour pr�server le formidable outil que constitue notre r�seau de lyc�es fran�ais � l’�tranger, et � travers lui l’AEFE, et pour consolider le double objectif de soutien aux �l�ves fran�ais et de d�veloppement et modernisation du r�seau. Surtout, nous avons besoin de votre confiance pour mener � bien la r�forme. Nous nous retrouverons prochainement, je l’esp�re, pour d�battre du projet de loi relatif � l’action ext�rieure.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Merci pour cette pr�sentation, monsieur le ministre. Avant de donner la parole � Fran�ois Rochebloine, l’un de nos deux rapporteurs sur les cr�dits de la mission, j’aurais moi-m�me deux questions � vous poser au sujet de l’impact de la r�forme du r�seau sur le budget.
Vous nous avez expliqu� qu’une trentaine d’ambassades �taient transform�es en postes de pr�sence diplomatique ; quelles �conomies en r�sulte-t-il, en termes de cr�dits et d’effectifs ?
D’autre part, dans ce PLF, en incluant les transferts d’emplois, les effectifs diminuent globalement de 300 ETP, mais les d�penses de personnel de la mission � Action ext�rieure de l’�tat � augmentent de 12 millions. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi ?
M. Fran�ois Rochebloine. Monsieur le ministre, vous vous �tes f�licit� � juste titre de l’abondement en gestion 2009 des cr�dits d’action culturelle, � hauteur de 20 millions d’euros, ainsi que d’une autre mesure exceptionnelle du m�me montant pour le m�me objet en 2010.
La mesure 2010 s’applique-t-elle � la base 2009 d’origine, ou � la base major�e de 20 millions ?
Quelle est la r�partition des 20 millions, tant en 2009 qu’en 2010, entre les programmes 185 Rayonnement culturel et scientifique et 209 Solidarit� avec les pays en d�veloppement ? Pourriez-vous nous donner des exemples pr�cis de l’utilisation pr�vue de ces cr�dits ?
Quand les 20 millions d’euros de 2009 seront-ils effectivement allou�s ? Si l’on ne peut pas les utiliser avant la fin de l’ann�e, pouvez-nous nous donner l’assurance qu’ils seront report�s sur 2010 ?
Ma deuxi�me question concerne le moratoire que vous avez annonc� sur la mont�e en charge de la gratuit� pour les �l�ves fran�ais scolaris�s dans le r�seau de l’AEFE. C’est une d�cision sage, mais elle ne fait pas cesser les effets pervers de la mesure, qui restera contestable tant qu’elle ne sera pas encadr�e pour �tre rendue plus �quitable. O� en est la r�flexion sur ce sujet ? Genevi�ve Colot et moi avions d�pos� l’ann�e derni�re un amendement qui avait �t� adopt� � l’unanimit� par notre commission, mais qui malheureusement avait �t� rejet� en s�ance publique. Le premier volet de l’amendement plafonnait le montant de la prise en charge et le second fixait un plafond de revenu pour les b�n�ficiaires. Dans le cadre de la mission d’information que nous menons � la commission des affaires �trang�res sur ces questions, nous nous sommes rendus en Angleterre, en Allemagne, au Chili, en Argentine : nous n’avons pas encore trouv� une seule personne qui soit satisfaite de cette mesure.
En outre, on assiste dans certains pays, au motif de cette prise en charge, � une explosion des frais de scolarit�. L’AEFE, qui est pourtant tr�s bien g�r�e, est confront�e � des probl�mes de fonctionnement ; elle a aujourd’hui un fonds de roulement de moins de quinze jours de fonctionnement, alors qu’il a repr�sent� jusqu’� deux mois.
Je voudrais vous interroger en troisi�me lieu sur notre r�seau culturel. Sa r�forme est importante pour l’influence de la France dans le monde, et il est donc normal que le Gouvernement prenne tout le temps n�cessaire pour la mettre au point. Cependant, l’incertitude et l’inqui�tude grandissent apr�s les annonces de mars puis le report de juillet. Pouvez-vous nous dire ce que Mme Delphine Borione et M. Dominique de Combles de Nayves pr�conisent, � l’issue de la consultation aupr�s des postes, sur le point crucial de la r�forme, � savoir le p�rim�tre de la future agence culturelle et son articulation avec le r�seau des services culturels des ambassades d’une part, et des centres et instituts culturels d’autre part ?
Par ailleurs, pouvez-vous nous rassurer quant � la p�rennit� de la cat�gorie juridique des �tablissements � autonomie financi�re – tel celui que nous avons vu la semaine derni�re � Berlin –, qui sont la cl� d’un fonctionnement optimal et au moindre co�t du r�seau culturel ?
Pouvez-vous nous pr�ciser le calendrier d’examen du projet de loi cr�ant deux agences, que vous avez pr�sent� en Conseil des ministres le 22 juillet dernier et qui a �t� d�pos� sur le bureau du S�nat ?
Enfin, comment envisagez-vous de professionnaliser davantage les agents de notre r�seau culturel � l’�tranger ?
M. le ministre. Les effectifs du minist�re auront baiss� en trois ans de 700 ETP, soit une baisse de 4,3 % par rapport � 2008 ; en six ans, ils auront �t� r�duits de 10 %. L’universalit� du r�seau est n�anmoins maintenue.
Sa r�forme se traduit tout d’abord par la constitution d’une trentaine de postes de pr�sence diplomatique simple, d’un format-type de 10 ETP ; une implication active des ambassadeurs a �t� demand�e, notamment sur les cons�quences immobili�res de la r�duction des formats. Cela devrait entra�ner dans chacun des pays concern�s la suppression de 4 � 5 ETP.
En deuxi�me lieu, il est pr�vu de r�duire d’environ 10 % les effectifs dans huit ambassades parmi les mieux dot�es – Etats-Unis, Royaume uni, Allemagne, Espagne, Italie, Maroc, S�n�gal, Madagascar –, dans le cadre d’un effort interminist�riel pour r�duire le nombre d’agents dans ces pays – car le personnel diplomatique ne doit pas �tre seul concern�. L’objectif est de r�duire les effectifs de 160 ETP, soit en moyenne 20 ETP par poste. Enfin, une centaine d’ambassades � missions prioritaires seront moins touch�es mais rendront n�anmoins 110 ETP.
G�ographiquement, les objectifs � terme de r�duction des effectifs illustrent la priorit� donn�e aux pays �mergents, moins touch�s en proportion par les baisses d’ETP, avec – 15 % en Afrique et dans l’Oc�an indien, – 10 % dans l’Union europ�enne, – 8 % en Am�rique, – 8 % en Afrique du Nord et au Moyen-orient, – 6 % en Europe continentale et – 6 % en Asie.
Ce recalibrage selon une double logique permettra de r�aliser une �conomie de l’ordre des 380 ETP recherch�s en trois ans, soit un total de 570 ETP que le minist�re restituera sur son r�seau � l’�tranger.
Quant � l’augmentation de la masse salariale d’environ 10 millions d’euros entre 2009 et le PLF 2010, monsieur le pr�sident, elle s’explique d’abord par la n�cessit� de payer les retraites. Comme dans tous les minist�res, nous devons faire face � la forte augmentation de nos cotisations, qui passent de 60 � 62 % de l’assiette de r�f�rence. D’autre part, et c’est le point essentiel, notre masse salariale �tait sous-�valu�e de 10 millions sur un total de 1 030 millions ; nous ne pouvions pas pourvoir tous les emplois autoris�s dans le cadre de notre plafond d’emplois – car nous n’aurions pas eu suffisamment de cr�dits de r�mun�ration pour payer nos personnels. Un exemple de la cons�quence de ce hiatus entre le nombre de nos emplois et notre masse salariale : en 2008 et d�but 2009, nous avons �t� contraints de geler les recrutements de nos agents contractuels, et principalement des assistants techniques et des personnels pour notre r�seau culturel. Dans le projet de budget 2010, nous sommes convenus avec le minist�re du budget d’une dotation compl�mentaire de 10 millions. Nous pouvons donc d�sormais travailler dans de bonnes conditions, sans craindre de devoir � nouveau geler les contrats. L’affaire est donc r�gl�e.
La transformation des trente ambassades en postes de pr�sence diplomatique permet de faire 2 millions d’euros d’�conomies de fonctionnement et de geler 50 ETPT – � rapporter � la baisse de 255 ETPT du plafond d’emplois du minist�re.
Sur tout cela, nous avons �videmment un dialogue avec les syndicats et les agents.
M. Jacques Myard. Comme le dossier est mauvais, cela ne doit pas �tre facile !
M. le ministre. Monsieur Rochebloine, sur les 20 millions d’euros de cr�dits d’action culturelle suppl�mentaires pour 2009, 6,5 millions vont au programme 185 et 13,5 millions au programme 209. N’ayez crainte, je ne laisserai pas �chapper cette somme ! 20 millions vont s’y ajouter pour 2010, dont 9 millions pour le programme 185 et 11 millions pour le programme 209. Au total, cela fait donc 40 millions de plus sur deux ans. Cette enveloppe a vocation � �tre allou�e dans des op�rations non r�currentes : cr�ation de l’agence, relance et modernisation du r�seau, soutien aux industries culturelles.
En ce qui concerne l’enseignement fran�ais � l’�tranger, le moratoire qui a �t� d�cid� va permettre de faire le point sur la situation et de trouver la meilleure solution pour l’avenir, en corrigeant les injustices. Nous devons notamment veiller � ce que la gratuit� offerte aux Fran�ais ne p�nalise pas les �l�ves �trangers. Nous pourrons sans doute vous pr�senter notre bilan au milieu de l’ann�e 2010.
M. Fran�ois Rochebloine. Seriez-vous favorable � notre amendement ?
M. le ministre. Monsieur Rochebloine, je suis un fid�le serviteur de l’�tat et, quelle que soit mon opinion personnelle, je dois consid�rer les avantages et inconv�nients de chaque syst�me. Les choses ne sont pas simples. Je reconnais comme vous que l’on a profit� de la gratuit� pour augmenter les frais d’inscription. Mais je souligne aussi l’attractivit� de notre r�seau, qui a scolaris� cette ann�e 5 600 �l�ves de plus.
La p�rennit� de la cat�gorie des �tablissements � autonomie financi�re est un probl�me qui concerne le minist�re des finances, mais la p�rennisation de l’autonomie financi�re des instituts est la cl� de vo�te de notre r�forme. Les �tablissements drainent � eux seuls 100 millions d’euros de recettes pour le r�seau, ce qui repr�sente un taux d’autofinancement de 55 %. La r�vision g�n�rale des politiques publiques nous demandant d’atteindre 60 %, la priorit� est de conforter l’autonomie financi�re. Je souhaite que le projet de loi relatif � l’agence soit examin� au S�nat avant No�l ; mais il fallait que je prenne connaissance de tous les travaux entrepris. J’ai re�u celui de M. de Combles de Nayves il y a trois jours.
S’agissant de la professionnalisation des agents de notre r�seau culturel � l’�tranger, la formation est bien une priorit� de cette r�forme. Elle doit s’appuyer sur l’id�e qu’un centre culturel doit �tre avant tout celui du pays d’accueil. La rallonge budg�taire que nous avons obtenue pour 2009 et 2010 nous permettra de financer cette formation – y compris celle des ambassadeurs.
Quant � l’inqui�tude qu’inspirerait la r�forme, elle m’a conduit � envoyer un questionnaire � nos 16 000 agents : nous n’avons eu que 450 r�ponses, dont dix de la part d’ambassadeurs… L’anxi�t� n’est donc peut-�tre pas si grande.
M. Fran�ois Rochebloine. Le fait que l’anonymat n’ait pas �t� total expliquerait me dit-on ce pi�tre r�sultat.
M. Jean-Paul Bacquet. Concernant l’enseignement fran�ais � l’�tranger, l’effort ne saurait porter uniquement sur la prise en charge de la scolarit� des �l�ves fran�ais. Pourriez-vous faire le point sur les ouvertures et fermetures de lyc�es fran�ais � l’�tranger ? Au Y�men, nous avions ensemble constat� il y a quelque temps la fermeture d’une �cole.
M. le ministre. Elle est maintenant rouverte.
M. Jean-Paul Bacquet. Vous vous �tiez engag� � la rouvrir, et je ne doutais pas que vous alliez le faire – mais elle avait �t� ferm�e sans que l’on vous pr�vienne.
Quant au rayonnement culturel et scientifique, il ne faut pas oublier qu’il passe aussi par l’accueil en France d’�tudiants �trangers, ce qui suppose qu’ils obtiennent un visa. J’�tais la semaine derni�re au Vietnam avec Mme Ameline et M. Bouvard ; les Vietnamiens nous disaient avoir un tr�s bon syst�me de sant� parce que leurs �tudiants �taient all�s dans des grands services hospitaliers fran�ais, mais d�ploraient qu’il n’en aille pas de m�me aujourd’hui, faute de visas.
Enfin, puisque vous parlez de politique d’aide au d�veloppement � cibl�e �, je me r�f�re � l’excellent rapport de notre coll�gue Henriette Martinez, qui montre combien il est difficile de comprendre comment fonctionne l’APD. Sommes-nous v�ritablement associ�s aux d�cisions prises ? Quels sont les crit�res retenus ? A-t-on une �valuation ? Exige-t-on que l’aide soit accord�e dans le cadre d’un partenariat ?
M. Paul Giacobbi. Ce budget est manifestement beaucoup plus sinc�re dans bien des domaines, notamment pour ce qui concerne le multilat�ral, et en cours de red�ploiement. Concernant le rayonnement de la France, pour lequel on note des efforts incontestables, il reste quelques interrogations. Un exemple pr�cis : il y avait � New York une librairie fran�aise, qui avait son si�ge � Rockefeller Center ; elle a ferm� ses portes en septembre – alors qu’elle existait depuis 1935. Et pendant ce temps, nous avons un service culturel qui occupe un magnifique immeuble sur Central Park, � un endroit o� presque personne ne passe.
M. Jean Glavany. A propos de la rationalisation dans la gestion des ressources humaines, est-il exact que 30 ambassadeurs sont actuellement sans affectation ? Si oui, pourquoi ?
Ma deuxi�me question – moins directement li�e au budget, mais qui l’est n�anmoins dans la mesure o� les cr�dits budg�taires servent � mener une politique – concerne l’Afghanistan. Nous y avons des troupes, dans un contexte tr�s tendu. Aux Etats-Unis, un d�bat s’est engag� au plus haut niveau et dans toute la presse sur la demande du g�n�ral McChrystal d’envoyer 40 000 hommes suppl�mentaires. En France, rien ! Quand le Gouvernement organisera-t-il un d�bat au Parlement sur les objectifs de notre pr�sence en Afghanistan, la situation de nos forces et la strat�gie retenue ?
M. Jacques Myard. Monsieur le ministre, le minist�re des affaires �trang�res est le seul minist�re r�galien dont les effectifs baissent depuis quinze ans sans discontinuer. C’est proprement scandaleux. Nous avons besoin d’un outil pour renseigner le Gouvernement sur ce qui se passe dans le monde. Vous avez � juste titre cr�� une direction de la mondialisation, et c’est bien, mais encore faut-il que les informations lui parviennent. Je ne peux pas voter un budget qui poursuit cette d�flation des effectifs.
De surcro�t, je constate que, dans les cr�dits d’aide au d�veloppement comme dans les cr�dits d’action culturelle, il n’y a pas de red�ploiement du multilat�ral au profit du bilat�ral, bien au contraire. Or le bilat�ral est l’instrument d’une strat�gie d’influence, contrairement au multilat�ral, qui est anonyme.
Quant � la gratuit� de la scolarit�, elle constitue sans aucun doute une faute, d’autant qu’elle a �t� financ�e par la diminution des cr�dits d’action culturelle. Il faut trouver les moyens de taxer les entreprises � l’�tranger pour qu’elles appuient l’action de la France au niveau bilat�ral.
Dernier point : j’ai �t� tr�s frapp�, � la Conf�rence des ambassadeurs, par le nombre d’anciens ambassadeurs dont on n’utilise pas le savoir accumul� sur le monde. Il faudrait r�fl�chir aux moyens de b�n�ficier des services de ces retrait�s.
M. le ministre. L’�cole dont a parl� M. Bacquet au Y�men avait �t� ferm�e pour des raisons de s�curit� mais elle est maintenant rouverte.
Pour 173 600 �l�ves – fran�ais et locaux confondus –, l’�tat paie en moyenne 2 000 euros par �l�ve. Les Fran�ais repr�sentent 47 % du total, et il y a eu cette ann�e pr�s de 6 000 �l�ves de plus. On compte 461 �tablissements d’enseignement fran�ais, dans 130 pays. 77 sont en gestion directe, 166 sont conventionn�s ; il y a par ailleurs des accords de partenariat tr�s divers.
Nous avons beaucoup de demandes, mais nous n’avons pas assez d’argent pour construire davantage ; nous en avons � peine assez pour entretenir les lyc�es existants.
Je suis heureux d’entendre parler du Vietnam, ayant au sein d’un autre gouvernement �t� � l’origine de l’octroi de bourses � des �tudiants en m�decine pour qu’ils b�n�ficient d’une formation � Paris en faisant fonction d’interne ; le probl�me aujourd’hui, c’est que l’on apprend moins le fran�ais au Vietnam. Je serais pr�t � offrir des visas s’il y avait plus de demandes, mais je ne pense pas qu’il y ait de demandes de � faisant fonction d’interne � insatisfaites.
Concernant l’Agence fran�aise du d�veloppement, M. Joyandet fera une pr�sentation � l’occasion de la commission �largie. La critique que l’on peut faire est que, au-del� des gros financements assur�s par l’AFD, les postes n’ont pas assez d’argent pour des petits projets pr�cis, qui changeraient la vie des gens et qui nous permettraient de manifester l’int�r�t de la France sur des sujets ponctuels. Il faut r�former cela : ce que fait tr�s bien la coop�ration d�centralis�e, il faut que nous puissions le faire en accord avec elle.
Monsieur Giacobbi, je regrette la fermeture de la librairie fran�aise au Centre Rockefeller, mais le probl�me est aussi la traduction des livres fran�ais, auquel le Centre national du livre participe. Quant au centre culturel situ� en face de Central Park, qui compl�te les 20 millions d’euros de notre d�partement minist�riel par 70 millions d’euros provenant de dons d’entreprises notamment, il marche bien.
Monsieur Glavany, quarante ambassadeurs sont sans affectation. Vingt d’entre eux sont entre deux postes. Il faudrait que les ambassadeurs restent en poste trois ou quatre ans, mais c’est souvent deux ans et demi. Pour les vingt ambassadeurs qui n’ont pas de perspective imm�diate, nous avons un dispositif de fin de carri�re, qui a d�j� �t� appliqu� � dix-neuf d’entre eux. L’id�e est de leur permettre de changer de carri�re, comme le fait le minist�re de l’int�rieur avec les pr�fets ; nous devrions avoir trente postes � ce titre, contre vingt pr�c�demment.
Sur l’Afghanistan, je suis tout � fait partisan d’un d�bat. Il y a en effet un, � tous les niveaux, aux Etats-Unis ; mais la presse fran�aise y participe aussi. La diff�rence, c’est qu’en France nous avons dit tr�s clairement que nous n’augmenterions pas nos effectifs.
Monsieur Myard, reconnaissez que tous les postes ne sont pas �quivalents. Cela peut autoriser certaines r�ductions d’effectifs sans porter atteinte � l’universalit� de notre appareil diplomatique.
Sur les 700 ETPT supprim�s, un tiers d’entre eux sont en administration centrale, � Paris et � Nantes, et deux tiers sont � l’�tranger. Chez nos voisins britanniques, � l’inverse, les r�ductions d’effectifs concernent Londres pour les deux tiers et l’�tranger pour un tiers.
S’agissant de l’�volution du r�seau diplomatique au cours des derni�res ann�es, nous avons cr�� trois bureaux, dont un bureau franco-allemand � Banja Luka, et cinq antennes diplomatiques, dont deux en colocalisation avec nos partenaires de l’Union europ�enne. Nous avons dix-sept repr�sentations permanentes et quatre d�l�gations aupr�s des organisations internationales.
Il faut allier action multilat�rale et action bilat�rale, et c’est ce que nous faisons.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. A propos du d�bat r�clam� par M. Glavany, je prends bonne note, monsieur le ministre, de votre accord pour y participer. Je proposerai au bureau d’organiser un d�bat en commission, ouvert � la presse, et je vous soumettrai des dates.
M. Tony Dreyfus. Un d�bat en commission n’a pas le m�me retentissement qu’un d�bat dans l’h�micycle.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Si vous souhaitez un d�bat dans l’h�micycle, il faut le programmer dans une semaine r�serv� au contr�le de l’action du Gouvernement ; rien n’emp�che le groupe socialiste de mettre ce sujet � l’ordre du jour.
M. Michel Destot. Concernant le r�seau diplomatique de la France, tout n’est pas affaire de budget. Je plaide la cause de petits pays comme la Lituanie, qui se plaignent d’�tre moins bien trait�s que les grands. C’est vrai sur le plan politique, mais c’est �galement vrai sur le plan �conomique : l’Allemagne ou le Royaume-Uni y sont beaucoup plus actifs que nous.
De plus, tout n’est pas affaire de Gouvernement. L’action de la France � l’�tranger est �galement tr�s importante � travers les collectivit�s territoriales et les ONG, et une meilleure articulation serait n�cessaire. Il faudrait qu’au niveau du secr�tariat g�n�ral du Quai d’Orsay, l’association des collectivit�s territoriales devienne un r�flexe. Le maire de Copenhague, par exemple, va organiser une rencontre de maires en marge du prochain sommet, dans la mesure o�, de toute �vidence, les collectivit�s territoriales sont concern�es au premier chef par la question du d�veloppement durable.
Enfin, quid de l’id�e d’une colocalisation des ambassades et des consulats avec d’autres pays europ�ens, pour permettre une pr�sence dans tous les pays du monde ?
M. Jean-Marc Roubaud. Monsieur le ministre, vous avez �voqu� l’an dernier l’inadaptation de la carte de nos ambassades, mais vous ne l’avez pas �voqu�e cette ann�e. Qu’en est-il ?
Par ailleurs, parmi les actions � mener, vous avez peu parl� de la promotion �conomique de nos savoir-faire. Comment se fera-t-elle en 2010 ?
Mme Henriette Martinez. Concernant l’aide publique au d�veloppement, nous sommes sans doute quasiment tous d’accord ici pour dire qu’il est n�cessaire de renforcer la place de notre aide bilat�rale, l’aide multilat�rale repr�sentant 55 % de notre aide programmable. Dans ce budget pourtant, compte tenu de l’augmentation de nos contributions au Fonds europ�en de d�veloppement (FED), je ne vois pas encore de r��quilibrage. Pourrons-nous honorer nos documents cadres de partenariat (DCP) ? Pourrons-nous maintenir un volume d’aide projet acceptable ? Il me semble en effet que c’est le volume des pr�ts qui augmente ; or les pr�ts consentis par l’AFD, s’ils sont n�cessaires, ne b�n�ficient pas forc�ment aux pays les plus pauvres.
M. Jacques Remiller. Avec trois autres parlementaires, j’ai accompagn� le Premier ministre samedi � Rome, notamment pour l’inauguration du nouveau centre culturel, qui d�pend de l’ambassade de France pr�s le Saint-Si�ge. On voit bien l’efficacit� de cette pr�sence fran�aise � l’�tranger, mais on constate aussi que les r�seaux �trangers se densifient, qu’il s’agisse du r�seau Cervant�s ou des r�seaux chinois. Ne pensez-vous pas que tout retard dans la r�forme serait tr�s pr�judiciable, le probl�me essentiel concernant les moyens, beaucoup plus que les missions ou le pilotage institutionnel ?
M. Serge Janquin. Ma question concerne notre repr�sentation diplomatique au Sud-Soudan. Vous avez pris, monsieur le ministre, l’initiative tr�s heureuse d’installer une repr�sentation diplomatique � Juba, et vous y avez nomm� un fonctionnaire de qualit�. Je m’y suis rendu cet �t� et j’ai �t� �pouvant� : v�tust� des locaux – non s�curis�s –, manque de personnel, manque de cr�dits de fonctionnement… Notre repr�sentant doit faire l’avance des frais pour le fonctionnement du g�n�rateur ou la peinture de l’�tablissement. Il a r�ussi performance d’ouvrir un centre culturel fran�ais dans les locaux de l’universit� de Juba, et c’est admirable. Mais il faut choisir : ou bien on donne � notre repr�sentation diplomatique � Juba les moyens d’une existence digne, ou bien on y met fin – car ce n’est pas ainsi que l’on sert l’image de la France.
M. Gilles Cocquempot. Etant moi-m�me vice-pr�sident du groupe d’amiti� France-Vietnam, je voudrais � nouveau �voquer ce pays.
O� en est-on de la reconstruction du lyc�e de Ho Chi Minh Ville ?
Pourriez-vous envisager l’implantation d’un consulat � Da Nang, ville situ�e au centre du pays, qui devient capitale �conomique et dont l’a�roport deviendra prochainement international et offrira des liaisons directes avec Roissy ? Pour le moment en effet, les personnes de cette r�gion qui souhaitent venir en France doivent se d�placer soit au consulat g�n�ral de Saigon, soit � Hanoi pour obtenir un visa.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Sur la politique des visas, nous interrogerons M. Besson.
M. le ministre. Monsieur Destot, certes les entreprises de certains pays voisins sont parfois mieux implant�es, mais les entreprises fran�aises sont aussi pr�sentes, et nous les sollicitons tr�s souvent. Je conviens que l’Institut Goethe peut compter sur un large soutien financier des entreprises allemandes ; nous entendons bien que le futur EPIC b�n�ficie lui aussi de fonds p�rennes en provenance du secteur priv�.
Vous avez raison, nous devons �tre attentifs � la coop�ration d�centralis�e et � l’action des ONG. Malheureusement, les moyens consacr�s � l’aide au d�veloppement demeurent insuffisants. Je rappelle cependant que, dans le domaine de la sant� publique, c’est la France qui, par habitant, fait le plus pour lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria.
Il ne faudrait pas mettre d’esp�rances excessives dans le sommet de Copenhague. Parvenir � un texte minimum, qui ne d�taillera pas forc�ment les obligations de chacun, sera d�j� un succ�s. Bien entendu, le r�le des collectivit�s est consid�rable : sans elles, comment ferait-on ?
S’agissant des colocalisations, des Maisons franco-allemandes doivent �tre r�alis�es � Maputo et � Daka. A ces deux projets, pilot�s par la France, s’ajoutent la construction d’un centre culturel franco-allemand, pilot�e par l’Allemagne, et l’installation prochaine du consulat g�n�ral d’Allemagne dans la Maison de France � Rio de Janeiro.
M. Jacques Myard. On marche sur la t�te ! Nous sommes concurrents ! Vous �tes des na�fs !
M. le ministre. La concurrence n’est pas un probl�me de locaux. Je conviens que l’exemple des ambassades communes n’a pas �t� bon, mais les choses se pr�sentent diff�remment pour les centres culturels et pour les consulats.
Monsieur Roubaud, les missions �conomiques, missions culturelles, missions sur l’environnement �chappent pour une bonne part � notre r�seau diplomatique ; c’est un probl�me g�n�ral sur lequel il faut se pencher, et que la cr�ation de l’agence pourra contribuer � r�soudre.
Madame Martinez, nous parlerons de l’aide publique au d�veloppement ult�rieurement.
Monsieur Remiller, l’Institut Cervant�s a un budget inf�rieur au n�tre, l’Institut Goethe un budget �quivalent, le British Council des moyens trois fois plus importants. Mais tout ne se r�sume pas au budget : il faut savoir s’adapter aux demandes locales. En tout cas, nous n’avons pas � rougir de notre budget pour le moment – en tenant compte des �tablissements � autonomie financi�re.
Monsieur Janquin, merci d’�tre all� au Sud-Soudan. En particulier gr�ce � votre intervention, des travaux ont �t� r�alis�s. Ils ont �t� achev�s fin ao�t. Je remercie G�rard Larome, qui est maintenant notre ambassadeur � Monrovia, des services qu’il a rendus � ce poste. Son successeur devrait travailler dans de meilleures conditions.
Monsieur Cocquempot, la reconstruction du lyc�e Colette � Ho Chi Minh Ville n’est pas encore commenc�e, mais j’esp�re qu’elle sera engag�e avant la fin de l’ann�e car c’est un projet prioritaire. Nous n�gocions une nouvelle localisation.
Quant � la cr�ation d’un consulat � Da Nang, pourquoi pas ? Je vais y r�fl�chir.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Monsieur le ministre, il me reste � vous remercier d’avoir r�pondu � toutes nos questions.
Au cours de sa r�union du 28 octobre 2009, la commission examine, sur le rapport pour avis de Mme Genevi�ve Colot, les cr�dits des programmes Action de la France en Europe et dans le monde et Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires et, sur le rapport pour avis de M. Fran�ois Rochebloine, les cr�dits du programme Rayonnement culturel et scientifique, de la mission � Action ext�rieure de l’�tat � pour 2010.
Apr�s l’expos� des deux rapporteurs pour avis, un d�bat a lieu.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Je remercie nos deux rapporteurs pour leur travail. Je rappelle que nous sommes invit�s � d�jeuner par le ministre ce midi et que ce sera l’occasion de lui dire de vive voix ce que l’attitude inadmissible de son cabinet a d’inacceptable. Ce n’est d’ailleurs pas sans pr�c�dent, puisque deux de nos coll�gues, Claude Goasguen et Jean Mallot, dans le cadre du travail qu’ils m�nent au sein du Comit� d’�valuation et de contr�le sur les �tudes d’impact, ont d�j� eu l’occasion de faire ce genre de remarque. Il nous appartient de marquer notre protestation vigoureuse.
M. Roland Blum. Je voudrais poser deux questions � Genevi�ve Colot. En ce qui concerne le programme 151, a-t-on pu �valuer l’impact sur l’AEFE de la cr�ation des nouveaux si�ges de d�put�s, compte tenu du fait que les 12 s�nateurs de l’�tranger en sont d�j� membres de droit ? Dans le programme 105, il est pr�vu 1 million d’euros � l’action n� 1 pour le financement d’associations. De quelles associations s’agit-il ? Des ONG ? De quel type ? Quels sont les contr�les pr�vus quant � l’utilisation des fonds ? J’ai pos� il y a quelque temps une question �crite au ministre � ce sujet, pour laquelle j’attends toujours la r�ponse !
M. Herv� de Charette. Je formulerai quatre observations sur le budget. Sur les moyens des postes, tout d’abord, dont les effectifs sont en baisse constante. Il nous manque une analyse globale et s�rieuse quant � la strat�gie du minist�re des affaires �trang�res et europ�ennes en mati�re de ressources humaine, qui ne semble pas claire. On ne peut continuer ainsi. Le minist�re a une capacit� de r�flexion sur ces questions qui est des plus faibles. La r�partition des effectifs est mauvaise et je voudrais savoir ce que l’on peut demander au Quai d’Orsay en termes de prospective pour qu’il d�fende ses moyens et ma�trise ses d�penses.
Ensuite, en ce qui concerne le soutien au multilat�ralisme, nous passons de 140 � 70 organisations internationales financ�es par le minist�re. Quelle est la liste d�taill�e des organisations maintenues et des sacrifi�es ? La ma�trise des co�ts des organisations internationales est souhaitable mais elle nous �chappe. Il y a beaucoup de laxisme et une politique plus stricte est logique et n�cessaire. Il me semble aussi hautement souhaitable, par exemple, qu’on r�duise le montant de nos participations � certaines des op�rations de maintien de la paix. Notre pr�sence est parfois tr�s discutable et doit �tre plus s�lective. Il est grand temps par exemple que nous quittions l’Afghanistan.
En troisi�me lieu, la gratuit� de la scolarit� dans les �tablissements fran�ais � l’�tranger est une catastrophe. Il y faut de l’argent public car des investissements sont � r�aliser. Nous faisons actuellement faire des b�n�fices aux entreprises priv�es.
Enfin, concernant notre politique culturelle � l’�tranger, il est de notre responsabilit� d’�tre extr�mement vigilants car le minist�re ne l’est pas suffisamment. Cela �tant, je soutiens le ministre des affaires �trang�res qui est un excellent ministre.
Mme Martine Aurillac. Parmi les suppressions de postes consulaires, le consulat de Saint Louis, au S�n�gal, est-il concern� ? Ce serait tr�s grave, car il est tr�s symbolique de notre pr�sence. En ce qui concerne l’Europe, le service europ�en d’action ext�rieure va-t-il recevoir des cr�dits du minist�re ou de la Commission europ�enne ?
M. Jean-Marc Roubaud. Dans le cadre de la RGPP, la r�flexion a-t-elle �t� men�e pour que les conseillers �conomiques des ambassades d�pendent du Quai d’Orsay et pas uniquement de Bercy comme c’est le cas actuellement ? A l’heure de la globalisation, ce serait opportun qu’il y ait une action concert�e entre le minist�re des affaires �trang�res et europ�ennes et le minist�re des finances ; ce n’est toujours pas le cas et c’est dommage.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. C’est une question tr�s int�ressante dont je parlais tr�s r�cemment avec M. Didier Migaud qui consid�re que le secr�tariat d’Etat au commerce ext�rieur devrait d�pendre du minist�re des affaires �trang�res et europ�ennes.
M. Jean-Paul Lecoq. Il serait bon d’accompagner la discussion budg�taire d’un d�bat sur l’efficacit� des ambassades. Je d�fends totalement les positions exprim�es par Herv� de Charette sur les finances, notamment en ce qui concerne les �tablissements d’enseignement � l’�tranger : cette politique a pour cons�quence de moins donner � ceux qui en ont le plus besoin, c’est-�-dire aux boursiers, c’est un pur scandale. En revanche, quant aux questions culturelles, je ne me fais pas trop de souci : la culture passe aujourd’hui beaucoup par l’Internet et les ressortissants fran�ais � l’�tranger ont toujours la possibilit� de t�l�charger, sans �tre soumis � la loi Hadopi. Par contre, en ce qui concerne les investissements, je souscris aux conclusions du rapport de Fran�ois Rochebloine, m�me si je ne serais pas aussi optimiste sur l’agence culturelle.
M. Philippe Cochet. Trois types d’ambassades vont �tre institu�s, mais le monde bouge et les situations peuvent �voluer. Y a-t-il une r�flexion prospective sur l’adaptation de ce dispositif ? Par ailleurs, les alliances fran�aises ne doivent pas s’exclure des politiques publiques et elles devraient notamment s’impliquer davantage en faveur de certaines actions, comme par exemple la r�alisation des tests de connaissances civiques et linguistiques des migrants et leur formation, sur lesquelles elle fait preuve d’une certaine r�ticence.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. C’est plus une opinion qu’une question.
M. Jacques Myard. Il est urgent de souligner que le MAEE est le seul minist�re qui perd des effectifs de cat�gorie A. Il y a une sorte d’exercice masochiste de la part de Bercy vis-�-vis du Quai d’Orsay qui doit cesser. Nous devons r�agir. Tout cela date de l’�poque de Hubert V�drine. Je regrette que le budget nous arrive une fois de plus n�goci� en amont, sans qu’on ait aucune prise dessus. Nous devrions intervenir bien plus t�t.
Quant au multilat�ralisme, il y a 150 millions d’euros de plus que pour le bilat�ralisme, qui permet pourtant plus de visibilit�. Je ne veux pas jeter le b�b� avec l’eau du bain, mais je remarque qu’il y a 386 millions d’euros consacr�s aux OMP, dans des pays o� nous n’avons pas forc�ment d’int�r�ts directs. Pourquoi �galement finance-t-on � hauteur de 10 millions la CPI ? Cela me para�t beaucoup, compte tenu des contributions des autres grands pays, Allemagne, Royaume-Uni. Je ne comprends pas non plus pourquoi nous finan�ons encore une ligne de 47 millions d’euros pour l’Europe sur ce programme, alors qu’il y a en parall�le le budget communautaire. A quoi cette somme �norme est-elle consacr�e ? Cela m’am�ne � la question de l’articulation des dispositifs : nous assistons � la r�duction du nombre de nos cadres diplomatiques au moment o� le service europ�en d’action ext�rieure va se cr�er, qui risque d’�tre un lieu de paralysie. Comment l’articulation de ce service va-t-elle se faire avec les diplomaties des Etats membres ? Y aura-t-il des crit�res de recrutement, notamment sur le plan linguistique ? J’approuve enfin totalement l’amendement de Fran�ois Rochebloine sur la question du rayonnement culturel et linguistique.
M. Fran�ois Asensi. Je ferai un commentaire g�n�ral. Il est regrettable qu’il y ait un recul de la France au plan ext�rieur. Il s’agit de missions r�galiennes et, � l’heure de la globalisation anglo-saxonne, il est important de maintenir le rayonnement culturel de la France et que ne se perde pas son message universel. Or, il y a des baisses d’emplois, des pertes s�ches, la restructuration du r�seau d’ambassades selon trois cat�gories ; c’est dommage. L’identit� nationale, c’est aussi le regard ext�rieur sur notre nation et si notre rayonnement culturel diminue, une part de notre identit� fran�aise s’affaiblit. Je regrette cet affaiblissement et remarque enfin que si on a r�int�gr� l’OTAN, l’id�e de d�fense europ�enne en revanche n’a pas progress�.
Mme Marie-Louise Fort. Il semblerait que certains ambassadeurs n’aient pas d’affectation et restent longtemps � Paris en attente d’une nomination. Est-ce vrai ? Y a-t-il une bonne gestion des ressources humaines au minist�re des affaires �trang�res et europ�ennes ?
M. Herv� Gaymard. Sur l’organisation du dispositif �conomique et commercial, on doit distinguer le souverain du non souverain. La r�forme �tait indispensable mais il faut d�sormais aller plus loin et l’�conomie n’est pas distincte de la r�alit� du monde. Or, il y a une certaine culture d’ambassade avec le � noble �, � savoir le politique, qui rel�ve de la chancellerie, et le reste. Il faut casser cela et unifier les carri�res pour produire une mixit�, des passerelles entre postes diplomatiques, consulaires et �conomiques, � l’instar de ce que font les Allemands ou les Am�ricains. Il faudrait �galement comparer notre syst�me avec le mod�le allemand des chambres de commerce � l’�tranger, plus efficace et moins co�teux.
M. Andr� Schneider. La stabilit� des cr�dits consacr�s � la francophonie a �t� annonc�e. Est-ce confirm� ? En ce qui concerne le rayonnement de la France, je voudrais des pr�cisions compl�mentaires sur le recrutement des personnels qui enseignent le fran�ais � l’�tranger.
M. Robert Lecou. Je suis pr�occup� car lorsqu’on se d�place � l’�tranger, on se rend compte que les moyens des postes ne sont plus � la hauteur des besoins ni de ce que l’on attend de la France. Cela ne correspond plus � l’image de notre pays. L’Asie est en train de prendre une place croissante dans la mondialisation et si nous n’y prenons garde, le rayonnement de la France risque d’en p�tir s�rieusement. C’est notamment dans les petites ambassades qu’il convient de faire le plus attention, la France doit mieux garantir son rayonnement. Je soutiendrai enfin l’amendement de Fran�ois Rochebloine : il faut que nous tirions un signal d’alarme.
M. Jacques Remiller. Revenant sur deux questions pos�es ant�rieurement, je me demande s’il ne faut pas viser � plus de coh�rence et de d’efficacit� sur le long terme. J’ai eu l’occasion d’aller � Rome � plusieurs reprises ces derni�res semaines. Il semblerait qu’un regroupement de nos trois ambassades, aupr�s de l’Italie, du Vatican et de la FAO, soit envisag� sur le site du Palais Farn�se. Est-ce ou non confirm� ? Il y a des inqui�tudes.
M. Didier Mathus. Tout le monde s’accorde � dire que la gratuit� de l’enseignement est une fausse bonne id�e, qui se r�v�le finalement inefficace et nocive. On constate une baisse des moyens, une diminution du nombre d’enseignants expatri�s et un seuil critique existe en de�� duquel la qualit� sera menac�e. Il aurait fallu plus de moyens. Je suis par ailleurs perplexe et sceptique sur l’agence culturelle qu’on nous annonce. Le parall�le avec l’AEFE n’est pas justifi� car les objectifs de celle-ci sont pr�cis. L’AEFE a une t�che simple : assurer la scolarit� des enfants � conduire jusqu’au baccalaur�at. En revanche, l’agence culturelle a des objectifs qui semblent peu clairs. Elle risque d’�tre surtout � glamour � � Paris, mais au-del� ?
M. Jean-Pierre Kucheida. Je souscris totalement � ce qu’a dit Herv� de Charette. Ce budget ne r�pond pas aux besoins. Je suis surpris de voir que tout le monde d�plore la baisse de 250 emplois alors que les m�mes applaudissent par ailleurs � la baisse des effectifs de fonctionnaires ! Les ambassades sont une part de notre fonction publique et c’est donc toute la politique du gouvernement qui est � remettre en cause. La fonction publique joue un r�le essentiel, le rayonnement de la France se ressent de ces diminutions, tout le monde ici a pu le constater. Il faut maintenir ces 250 emplois et m�me, pour garantir le rayonnement et le dynamisme de notre pays, les augmenter : quand on a 55 milliards de d�ficit commercial, on peut s’interroger. Sur le plan culturel, je souscris � l’amendement de Fran�ois Rochebloine qui permettra de corriger la situation.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Je crois toutefois utile de pr�ciser que, malgr� cette baisse de 250 emplois, la France conservera le deuxi�me r�seau diplomatique au monde.
M. Jean Glavany. Au nom du groupe PS, je voudrais exprimer notre m�contentement sur le fait que l’on n’arrive pas � obtenir du gouvernement l’organisation d’un d�bat sur l’Afghanistan. Nous avons 3 300 hommes l�-bas, le secr�taire g�n�ral de l’OTAN vient de remercier la France de l’envoi de personnels suppl�mentaires, dont nous ne sommes pas au courant ! Nous sommes face � une politique qui, apr�s la d�faite des talibans, a �t� une impasse et un �chec et aucun d�bat n’est organis� en France sur ce sujet ! Nous en sommes � la deuxi�me r�vision strat�gique, qui ne fait l’objet d’aucune discussion chez nous. Quand on voit le niveau du d�bat, y compris dans la presse, que ces questions suscitent chez nos voisins, ainsi qu’aux Etats-Unis par exemple, on est en droit de se demander si le parlement fran�ais est le seul qui n’ait pas le droit de d�battre. J’ai sollicit� le Premier ministre qui a r�pondu � ma demande qu’il n’y aurait pas de d�bat sauf si le groupe socialiste en faisait la demande dans le cadre de sa niche parlementaire ! Le gouvernement n’a-t-il donc rien � dire ?
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Je crois qu’il faut �tre raisonnable : dans le cadre de l’ordre du jour partag� d�sormais en vigueur, il est incontestable que le gouvernement a vu son temps disponible consid�rablement r�duit, compte tenu notamment de la quantit� de textes qu’il doit pr�senter. Mais rien n’emp�che effectivement le groupe socialiste de prendre l’initiative de ce d�bat, sur le principe duquel je suis totalement d’accord.
M. Jacques Myard. Je suis enti�rement d’accord. Il y a effectivement un probl�me strat�gique majeur dont il faut d�battre. S’il s’agit d’une question de temps, je suis d’accord pour demander ce d�bat sur le temps de la majorit�.
M. Jean-Luc Reitzer. Je voudrais dire � Jean-Pierre Kucheida qu’on peut tr�s bien globalement vouloir diminuer les effectifs de la fonction publique tout en ayant pour souci de maintenir ceux du minist�re qui effectivement, souffre particuli�rement. On a notamment parl� de suppression d’agents de cat�gorie A. Tout est li� et on voit en revanche la politique que m�nent l’Allemagne, l’Italie, le Royaume uni, avec les r�sultats que l’on sait. Il y a une r�elle faiblesse de notre outil diplomatique. La question des bourses est aussi de celles qui auront des r�percussions non seulement � court terme, mais aussi � moyen et long terme, dans la mesure o� la densit� du r�seau d’influence, les liens d’amiti� avec notre pays, qu’elles permettent sur une longue dur�e, ira diminuant. On sait le travail exceptionnel des lyc�es fran�ais � l’�tranger que nous avons tous pu constater et il est certain qu’il faudra faire de lourds investissements pour les maintenir. Enfin, les alliances fran�aises sont des outils essentiels et dans certains pays elles sont seules pour assurer la pr�sence culturelle de la France.
M. Michel Terrot. Je constate que la conjonction entre la diminution des fonds disponibles et la RGPP conduit � chaque fois � la diminution du bilat�ralisme au profit du multilat�ralisme, et ce, budget apr�s budget. Et cela se traduit � chaque fois par une moindre visibilit� de notre pays. Il est temps d’envoyer des signaux tr�s forts au ministre pour lui dire son obligation de d�fendre la langue fran�aise sur la sc�ne internationale. Il y a urgence dans cette n�cessit�. Je suis �galement sceptique sur l’agence culturelle qui risque de n’�tre qu’une grosse structure de plus, sur laquelle, en tout cas, il sera essentiel que le minist�re et les postes exercent la plus attentive tutelle.
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Je rappelle que c’est pr�cis�ment pour r�pondre � cette inqui�tude que la mission d’information sur l’�quilibre entre le multilat�ralisme et le bilat�ralisme a �t� cr��e au sein de la commission des affaires �trang�res.
M. Lo�c Bouvard. Les lyc�es fran�ais � l’�tranger ont effectivement un grand rayonnement. J’ai not� les chiffres de Fran�ois Rochebloine selon lequel ils accueilleraient environ 80 000 lyc�ens fran�ais et 90 000 �trangers. Les Fran�ais ont logiquement la priorit�, mais ce ne sont pas eux qui, finalement, contribueront au rayonnement de notre pays, ce sont les enfants �trangers qui y sont scolaris�s et acqui�rent notre langue et notre culture. Or, j’ai pu constater par exemple qu’� Lisbonne, les jeunes Portugais �taient refus�s, faute de place. Savez-vous quel est le nombre global de refus ?
M. le pr�sident Axel Poniatowski. Cela justifierait sans doute une question �crite au ministre.
M. Gilles Cocquempot. Concernant le r�seau consulaire, le Vietnam pose le cas particulier d’un pays au territoire tr�s allong� et j’ai r�clam� au contraire une augmentation du nombre des postes consulaires pour �viter que les gens n’aient � se d�placer � Hanoi ou Ho-Chi-Minh Ville, devant prendre l’avion, passer une nuit � l’h�tel, pour effectuer leurs formalit�s. Il faudrait le rappeler au ministre la n�cessit� d’un autre poste consulaire au centre du pays.
M. Herv� de Charette. Concernant le d�bat entre le bilat�ralisme et le multilat�ralisme, Hubert V�drine brocarde souvent, � tort, le concept de communaut� internationale. La France contribue pr�cis�ment � l’�mergence de la communaut� internationale et il est tout � fait justifi� qu’on soit pr�sent et que l’on contribue financi�rement � ses diff�rentes instances. Il faut donc une aide multilat�rale significative m�me si elle doit �tre s�lective, c’est tr�s important.
Mme Genevi�ve Colot, rapporteure. Les d�put�s repr�sentant les Fran�ais de l’�tranger ne co�teront rien � l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger (AFE) car, comme c’est le cas actuellement pour les S�nateurs membres de droit de l’AFE, aucune r�mun�ration autre que celle vers�e par leur assembl�e parlementaire n’est pr�vue.
S’agissant des crit�res pr�sidant au choix des associations financ�es sur les cr�dits du minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes, je pourrais vous en citer la liste ; celle-ci figurera dans mon rapport �crit. J’admets que le contr�le de l’utilisation de ces cr�dits pourrait �tre renforc�. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’ONG, et le financement porte sur des op�rations ponctuelles, pas sur le fonctionnement courant. Voici par exemple la liste des huit associations b�n�ficiant d’une subvention sup�rieure � 75 000 euros : le centre d’accueil de la presse �trang�re, la F�d�ration fran�aise des maisons de l’Europe, le Mouvement europ�en France, le groupement d’int�r�t �conomique Toute l’Europe, la Fondation Robert Schuman, l’Union des Fran�ais de l’�tranger, l’Association d�mocratique des Fran�ais de l’�tranger et l’Institut fran�ais des relations internationales.
La diminution des effectifs du minist�re �tait pr�vue par la loi de programmation des finances publiques pour les ann�es 2009 � 2011. Certes, une baisse de 700 ETPT sur trois ans repr�sente un effort important pour le minist�re, d’autant qu’elle fait suite � une diminution de 760 ETPT au cours des trois ann�es pr�c�dentes. M�me si cela n’est pas en soi une justification, le fait est que ces r�ductions d’effectifs portent souvent sur des personnels recrut�s locaux, occupant des emplois de service dans les postes, et rarement sur des emplois de fonctionnaires de niveau plus �lev�.
Les organisations internationales b�n�ficiaires de contributions inscrites sur le budget du minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes �taient nagu�re au nombre de 140 et elles ne sont plus aujourd’hui que 80 car beaucoup parmi elles relevaient de la comp�tence d’autres minist�res, auxquels les cr�dits correspondants ont �t� transf�r�s. Le Quai d’Orsay pourra en fournir la liste compl�te.
Je dois malheureusement confirmer � notre coll�gue Martine Aurillac que le consulat de Saint-Louis du S�n�gal sera supprim� en 2010, en raison du peu de ressortissants fran�ais r�sidant dans cette r�gion et du faible nombre de visas d�livr�s. Le poste comp�tent sera dor�navant celui de la capitale.
Le moratoire appliqu� � la mesure de prise en charge des �colages des enfants fran�ais scolaris�s dans le r�seau des lyc�es fran�ais � l’�tranger intervient dans la situation suivante : en 2009, pour 19 853 enfants boursiers, le co�t des bourses � sociales � est de 58,82 millions d’euros. Il sera l’an prochain de 70 millions d’euros pour 20 000 boursiers. Quant � la mesure de gratuit�, elle repr�sente en 2009 un co�t de 28,19 millions d’euros pour quelque 5 500 enfants pris en charge ; en 2010, il en co�tera au budget de l’�tat 45,64 millions d’euros pour 9 500 enfants. Les moyens allou�s augmenteront donc sensiblement. Au total, ce sont ainsi 29 500 enfants qui b�n�ficieront d’un soutien budg�taire sur le total de 82 000 �l�ves fran�ais fr�quentant le r�seau. J’ajoute, pour r�pondre � une question pr�cise sur ce point, que le montant des ressources prises en compte pour l’�ligibilit� aux bourses scolaires est en effet relev� de 5 %, de sorte que certaines familles sortiront du dispositif.
Le classement en trois cat�gories d’ambassades traduisant les d�cisions du Conseil de modernisation des politiques publiques nous a �t� communiqu�. Les postes y sont r�partis entre 38 ambassades � missions �largies, 92 ambassades � missions prioritaires centr�es sur l’activit� diplomatique et consulaire traditionnelle, et 32 postes de pr�sence diplomatique dans les �tats de petite taille ou accueillant peu de ressortissants fran�ais. � titre d’exemple, cette derni�re cat�gorie comprend nos ambassades en Andorre, � Malte, pr�s le Saint-Si�ge, au Mont�n�gro – qui sont incontestablement de petits �tats –, ou encore au Tadjikistan ou en Mongolie – qui sont des �tats avec lesquels nos relations sont d’une intensit� assez r�duite.
Les organisations europ�ennes financ�es sur les cr�dits du programme � Action de la France en Europe et dans le monde �, pour un total d’environ 37 millions d’euros en 2010, ne sont pas des institutions communautaires : il s’agit principalement du Conseil de l’Europe pour 34 millions d’euros et de l’Union de l’Europe occidentale pour 2,46 millions d’euros.
Le probl�me des ambassadeurs sans affectation tient � la forme atypique de la pyramide des �ges de ce corps de fonctionnaires, avec un sommet large et une base �troite. Une vingtaine de diplomates pouvant pr�tendre � un emploi d’ambassadeur sont en attente de poste. Ces derni�res ann�es, a �t� mis en place un dispositif d’incitation � la fin d’activit� pour ceux de ces diplomates qui sont �g�s de 58 � 62 ans. Un � p�cule de d�part � leur �tait propos�, correspondant � la moiti� du total des primes auxquelles ils auraient pu pr�tendre entre la date de leur d�part effectif et la date th�orique de leur mise � la retraite. 19 ambassadeurs ont utilis� ce dispositif. Le minist�re souhaite qu’un dispositif du m�me type soit cr�� � compter de 2010 et offre une possibilit� de d�part � trente cadres du minist�re.
M. Fran�ois Rochebloine, rapporteur. Les cr�dits consacr�s � la francophonie multilat�rale sont maintenus, dans le projet de budget pour 2010, � 65 millions d’euros, dont 13 millions d’euros au titre de la contribution statutaire de la France � l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et 48 millions d’euros � titre de contributions sur conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens � l’OIF et aux op�rateurs. Ces cr�dits sont inscrits sur le programme 209, ce qui me permet une fois de plus de plaider pour une � r�unification � de l’action culturelle, au moins au sein d’une m�me mission.
Si certains �l�ves �trangers ne trouvent pas de places dans les lyc�es fran�ais, c’est souvent � cause du dispositif de prise en charge, dont la mise en œuvre s’est traduite par une forte augmentation du nombre d’�l�ves fran�ais, prioritaires par rapport aux �trangers.
Un autre effet pervers de ce dispositif est observ� dans les fratries. Certaines familles b�n�ficient aujourd’hui d’une prise en charge des frais de scolarit� moins �lev�e que par le pass� car le fait que les a�n�s fr�quentent une classe devenue gratuite pour eux a parfois pour effet de priver les cadets de bourses sur crit�res sociaux.
Le travail r�alis� par les Alliances fran�aises est remarquable, surtout au regard de leurs moyens souvent tr�s limit�s. Il n’est pas dans leur r�le de faire passer des tests de langue ou de connaissance des valeurs de la R�publique aux �trangers, m�me si elles peuvent �videmment leur fournir une formation linguistique.
Il est difficile de se prononcer sur la future agence culturelle tant que le minist�re n’en a pas r�v�l� davantage sur les missions qui lui seront confi�es. Le principal avantage qu’elle offrira sera d’isoler et donc de prot�ger les cr�dits d’intervention dans le domaine culturel.
Article 35 : Etat B – Mission � Action ext�rieure de l’Etat �
M. Fran�ois Rochebloine, rapporteur. L’amendement que je vous propose vise � obtenir un plafonnement du niveau de revenu des familles b�n�ficiaires de la prise en charge des frais de scolarit�, en tenant compte de la zone o� elles r�sident. Je demande que les 10 millions d’euros qui pourraient �tre �conomis�s soient transf�r�s sur la subvention de l’AEFE et utilis�s au profit de ses d�penses immobili�res.
M. le Pr�sident Axel Poniatowski. L’amendement fixe-t-il le niveau de ce plafonnement ?
M. Fran�ois Rochebloine, rapporteur. Non, la fixation des plafonds rel�ve du domaine r�glementaire.
La commission adopte � l’unanimit� l’amendement de M. Fran�ois Rochebloine (amendement n� II- 12).
Suivant les conclusions des deux rapporteurs pour avis, la Commission �met un avis favorable � l’adoption des cr�dits de la mission � Action ext�rieure de l’Etat � pour 2010, ainsi modifi�s.
*
* *
AMENDEMENT ADOPT� PAR LA COMMISSION
Amendement pr�sent� par M. Fran�ois Rochebloine, rapporteur pour avis :
Article 35
�tat B
Mission � Action ext�rieure de l’�tat �
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les cr�dits de paiement :
(en euros)
|
Programmes |
+ |
– |
Action de la France en Europe et dans le monde Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Rayonnement culturel et scientifique Dont titre 2 |
10 000 000 0 |
0 0 |
Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires Dont titre 2 |
0 0 |
10 000 000 0 |
|
TOTAUX |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
SOLDE |
0 | |
EXPOS� SOMMAIRE
La prise en charge des frais de scolarit� pour les enfants fran�ais inscrits dans les lyc�es fran�ais � l’�tranger entre dans sa troisi�me ann�e d’application : la gratuit� s’�tend d�sormais � toutes les classes de seconde.
Mais en application de la loi de finances initiale pour 2009, suite aux d�bats sur ce point pr�cis, toute extension du dispositif est subordonn�e � une �tude d’impact et dans cette attente, un moratoire s’applique.
C’est bien le signe d’une difficult�, que d’ailleurs toutes les parties prenantes reconnaissent. L’Agence pour l’enseignement fran�ais � l’�tranger (AEFE) a d� prendre cet �t� des mesures destin�es � endiguer la croissance du dispositif, qui accapare l’essentiel des marges de manœuvre disponibles au sein du programme � Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires � de la mission � Action ext�rieure de l’�tat �.
Cet engagement du Pr�sident de la R�publique �tait g�n�reux mais faute d’encadrement de la mesure, ses nombreux effets pervers, d�sormais bien connus, se r�v�lent chaque ann�e davantage.
C’est donc au nom de consid�rations �l�mentaires d’�quit� – entre familles expatri�es mais aussi entre contribuables m�tropolitains et ressortissants expatri�s –, que le pr�sent amendement propose une diminution de cr�dits en autorisations d’engagement et cr�dits de paiement de 10 millions d’euros, sur l’action � Acc�s des �l�ves fran�ais au r�seau AEFE � du programme � Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires �, dot�e de 106,2 millions d’euros pour 2010, en augmentation de plus de 20 millions d’euros par rapport � la loi de finances initiale pour 2009.
Cette diminution correspond � la mise en œuvre imm�diate, par l’AEFE et sa tutelle, d’un plafonnement � fixer par voie r�glementaire en fonction des revenus bruts des familles, selon un bar�me variable par pays de r�sidence, sur le m�me mod�le que celui appliqu� au calcul des bourses ordinaires.
Cette proposition est raisonnable, �quitable et applicable pour l’ann�e budg�taire 2010 en rythme sud comme en rythme nord. Contrairement � l’an dernier, il n’est pas propos� de plafonner le montant des frais de scolarit� eux-m�mes ; en effet, il ne serait pas juste de priver d’une prise en charge totale les familles qui, sur crit�res de revenus, pouvaient y pr�tendre avant la mise en place de la mesure pr�sidentielle. En outre, une � cristallisation � de la prise en charge au niveau de 2007 a d�j� �t� d�cid�e par l’AEFE.
Par ailleurs, il est propos� d’augmenter les cr�dits de l’AEFE, sur l’action 5 � Service public d’enseignement � l’�tranger � du programme � Rayonnement culturel et scientifique �. L’autonomie financi�re de l’op�rateur qu’est l’AEFE implique que la subvention du budget de l’�tat soit globalis�e. Pour autant, les auteurs de l’amendement souhaitent que l’augmentation de cette dotation de 10 millions d’euros soit consacr�e au programme immobilier de l’Agence qui, depuis qu’elle a repris de l’�tat la comp�tence immobili�re pour le r�seau des lyc�es fran�ais, se trouve confront�e � un r�el manque de moyens dans ce domaine. La programmation immobili�re de l’AEFE repr�sente, � titre d’illustration, un besoin de 60 millions d’euros en 2009.
Ces deux mouvements de cr�dits sont l’un comme l’autre n�cessaires pour mener � bien le plan de d�veloppement du r�seau des lyc�es fran�ais � l’�tranger, une ambition qui figure express�ment dans la lettre de mission du ministre des Affaires �trang�res et europ�ennes.
• Dans le cadre de la Mission d’information sur le rayonnement de la France par l’enseignement et la culture
– M. Berthold Franke, directeur g�n�ral du Goethe Institut de Paris
– M. Jorge Jimenez et Mme Asuncio Pastor, de l’Instituto Cervantes de Paris
– Mme Dawn Long, directrice adjointe du British Council � Paris, et Mme Sylvie Gelis, directrice finances et ressources humaines
– M. Christian Masset, directeur g�n�ral de la mondialisation, du d�veloppement et des partenariats et M. Yves Carmona, directeur adjoint de la politique culturelle et du fran�ais
– M. Jean-Pierre de Launoit, pr�sident de la Fondation Alliance fran�aise et M. G�rald Candelle, responsable des zones Asie/Oc�anie/�tats-Unis et du recrutement
– M. Yves Aubin de la Messuzi�re, pr�sident de la Commission pour l’avenir de l’enseignement fran�ais � l’�tranger (10)
– Mme Anne-Marie Desc�tes, directrice de l’Agence pour l’enseignement fran�ais � l’�tranger (AEFE)
– M. Alain Catta, directeur des Fran�ais � l’�tranger et de l’administration consulaire (11) et M. �ric Lamouroux, sous-directeur de l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale
– M. Jean-Pierre Bayle, Pr�sident de la Mission la�que fran�aise et M. Jean-Pierre Villain, directeur g�n�ral (12)
– Mme Anne Gazeau-Secret, ancienne directrice g�n�rale de la coop�ration internationale et du d�veloppement (DGCID)
– M. St�phane Romatet, directeur g�n�ral de l’administration et de la modernisation du minist�re des Affaires �trang�res et europ�ennes
– M. Alain Gr�nd, pr�sident du Bureau international de l’�dition fran�aise et M. Jean-Guy Boin, directeur g�n�ral
Mme Sophie Mercier, directrice du Bureau export musique et M. Jean-Fran�ois Michel, fondateur et aujourd’hui conseiller du Bureau export
– M. Olivier Poivre d’Arvor, directeur de CulturesFrance
– M. Antoine de Clermont-Tonnerre, pr�sident d’Unifrance et Mme R�gine Hatchondo, directrice g�n�rale
– M. Fran�ois Denis, pr�sident de la F�d�ration des associations de parents d’�l�ves des �tablissements d’enseignement fran�ais � l’�tranger (FAP�E)
– M. Cl�ment Duhaime, administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie
– M. Henri Loyrette, Pr�sident-directeur du Mus�e du Louvre, accompagn� de M. Herv� Barbaret, administrateur g�n�ral et de Mme Dominique de Fontr�aulx, conseill�re scientifique, ainsi que M. Bruno Maquart, directeur g�n�ral de l’Agence France mus�ums, Mme Laurence des Cars, directrice scientifique et M. Ugo Bertoni, charg� de mission.
Par ailleurs, la Mission d’information a organis�, le 9 septembre dernier, un d�jeuner en l’honneur des conseillers de l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger �lus dans les circonscriptions de l’Am�rique du Nord.
Elle a �galement effectu� les d�placements suivants :
– Londres, le 1er juillet 2009 ;
– Chili et Argentine, du 12 au 20 septembre 2009 ;
– Berlin, les 7 et 8 octobre 2009.
• Dans le cadre du pr�sent avis budg�taire
– M. Fran�ois Saint-Paul, directeur des Fran�ais � l’�tranger et de l’administration consulaire, accompagn� de M. Jean Wiet, chef de la mission de gestion administrative et financi�re, de M. Antony Nguyen Van Ton, chef de la cellule budg�taire et de Mme Brigitte Baley, adjointe au sous-directeur de l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale
– M. Jean-Marc Berthon, conseiller charg� de l’action culturelle ext�rieure au cabinet du ministre des Affaires �trang�res et europ�ennes
– M. Christian Masset, directeur g�n�ral de la mondialisation, du d�veloppement et des partenariats, responsable du programme Rayonnement culturel et scientifique, M. Yves Carmona, adjoint � la directrice de la politique culturelle et du fran�ais, Mme Eva Nguyen Binh, adjointe au chef du service des programmes et du r�seau et M. �ric Lamouroux, sous-directeur de l’enseignement sup�rieur.
Annexe 2 : lettre du ministre des affaires �trang�res et europ�ennes aux agents du r�seau culturel