
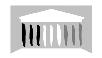
N´┐Ż 3365
______
ASSEMBL´┐ŻE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZI´┐ŻME L´┐ŻGISLATURE
Enregistr´┐Ż ´┐Ż la Pr´┐Żsidence de l'Assembl´┐Że nationale le 12 octobre 2006
AVIS
PR´┐ŻSENT´┐Ż
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ´┐ŻCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI de finances pour 2007 (n´┐Ż 3341),
TOME XVI
VILLE ET LOGEMENT
AIDE ´┐Ż L’ACC´┐ŻS AU LOGEMENT ; D´┐ŻVELOPPEMENT ET AM´┐ŻLIORATION DE L’OFFRE DE LOGEMENT
PAR M. JEAN-PIERRE ABELIN,
D´┐Żput´┐Ż.
——
Voir le num´┐Żro : 3363 (annexe 41).
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I.— 2006 : UNE ANN´┐ŻE PHARE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT 9
A.— DES R´┐ŻSULTATS TR´┐ŻS FAVORABLES D´┐ŻS 2005 9
1. L’envol´┐Że de la construction neuve : un record in´┐Żgal´┐Ż depuis 25 ans 9
2. L’entretien et l’am´┐Żlioration des logements : une activit´┐Ż dont la hausse se poursuit 10
3. La construction de b´┐Żtiments non r´┐Żsidentiels 10
B.— L’ANN´┐ŻE 2006 : UNE PROGRESSION QUI S’AMPLIFIE 11
1. Le logement neuf : troisi´┐Żme ann´┐Że cons´┐Żcutive de forte croissance 12
2. Entretien et am´┐Żlioration du logement : de bonnes perspectives 13
3. La construction des b´┐Żtiments non r´┐Żsidentiels : une franche reprise de la construction priv´┐Że 14
II.— LE BUDGET DU LOGEMENT POUR 2007 : UNE PRIORIT´┐Ż DANS LE CADRE DU PLAN DE COH´┐ŻSION SOCIALE 15
A.— LE PROGRAMME ´┐Ż AIDE ´┐Ż L’ACC´┐ŻS AU LOGEMENT ´┐Ż : UN PROGRAMME MARQU´┐Ż PAR LA REVALORISATION D’1,8 % DU BAR´┐ŻME DES AIDES AU LOGEMENT 15
1. Les deux actions du programme 16
a) L’action ´┐Ż aides personnelles au logement ´┐Ż 16
b) L’action ´┐Ż accompagnement des publics en difficult´┐Ż ´┐Ż 18
2. La n´┐Żcessit´┐Ż de renforcer les moyens de cette action afin de remettre en cause le seuil des 24 euros conditionnant le versement de l’aide personnalis´┐Że au logement 18
B.— LE PROGRAMME ´┐Ż D´┐ŻVELOPPEMENT ET AM´┐ŻLIORATION DE L’OFFRE DE LOGEMENT ´┐Ż 19
1. L’action ´┐Ż construction locative et am´┐Żlioration du parc ´┐Ż 19
2. L’action ´┐Ż soutien ´┐Ż l’accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż ´┐Ż 22
3. L’action ´┐Ż lutte contre l’habitat indigne ´┐Ż 23
4. L’action ´┐Ż r´┐Żglementation de l’habitat, politique technique et qualit´┐Ż de la construction ´┐Ż 24
5. L’action ´┐Ż soutien ´┐Ż 24
C.— LES D´┐ŻPENSES FISCALES : UN EFFORT CONS´┐ŻQUENT EN FAVEUR DU LOGEMENT 24
1. L’application d’un taux r´┐Żduit de TVA 25
a) Pour les travaux d’am´┐Żlioration, de transformation, d’am´┐Żnagement, et d’entretien portant sur les logements achev´┐Żs depuis plus de deux ans 25
b) Sur la construction, l’am´┐Żlioration et la vente de logements sociaux 25
c) Sur les terrains ´┐Ż b´┐Żtir dans le cadre de la construction de logements sociaux 25
2. Les d´┐Żpenses fiscales en faveur de l’investissement locatif 26
Le dispositif ´┐Ż Besson ´┐Ż 26
Le ´┐Ż Robien ´┐Ż 26
Le recentrage du dispositif ´┐Ż Robien ´┐Ż et la cr´┐Żation du ´┐Ż Borloo populaire ´┐Ż dans le cadre de la loi ´┐Ż ENL ´┐Ż : une r´┐Żforme rendue n´┐Żcessaire par certaines d´┐Żrives 27
3. Les d´┐Żpenses fiscales en faveur de l’´┐Żpargne-logement : des d´┐Żpenses en forte baisse en raison de la r´┐Żforme engag´┐Że en 2006 28
4. Les d´┐Żductions des d´┐Żpenses de grosses r´┐Żparations et d’am´┐Żlioration 29
5. Les cr´┐Żdits d’imp´┐Żt pour d´┐Żpenses d’´┐Żquipement de l’habitation principale 29
En faveur des ´┐Żconomies d’´┐Żnergie et du d´┐Żveloppement durable : 29
En faveur de l’aide aux personnes 29
6. L’exon´┐Żration d’imp´┐Żt sur les soci´┐Żt´┐Żs au profit des organismes HLM et les OPAC 29
7. La compensation par l’Etat des exon´┐Żrations de taxe fonci´┐Żre sur les propri´┐Żt´┐Żs b´┐Żties consenties dans le cadre de la construction de logements sociaux 29
III.— L’ACCESSION SOCIALE ´┐Ż LA PROPRI´┐ŻT´┐Ż : UNE POLITIQUE L´┐ŻGITIME ET EFFICACE 31
A.— DES INSTRUMENTS R´┐ŻFORM´┐ŻS POUR PLUS D’EFFICACIT´┐Ż 33
1. Le pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro r´┐Żform´┐Ż : un pr´┐Żt ´┐Żlargi ´┐Ż l’ancien, dont les plafonds ont ´┐Żt´┐Ż relev´┐Żs en zone tendue, et profitant aux m´┐Żnages ´┐Ż revenus moyens et modestes 33
La relance du PTZ en 2005 : un ´┐Żlargissement ´┐Ż l’ancien 33
Un pr´┐Żt sous conditions de ressources 34
Un PTZ plus familial, et tenant compte de la diversit´┐Ż des march´┐Żs locaux de l’immobilier 35
Des modalit´┐Żs de financement plus favorables pour les m´┐Żnages gr´┐Żce ´┐Ż la r´┐Ż´┐Żvaluation du montant des pr´┐Żts 36
Un pr´┐Żt financ´┐Ż par l’Etat sous la forme d’un cr´┐Żdit d’imp´┐Żt au profit des ´┐Żtablissements de cr´┐Żdits habilit´┐Żs 36
Le r´┐Żle de gestion et de contr´┐Żle des ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit a ´┐Żt´┐Ż attribu´┐Ż ´┐Ż la SGFAS 37
Bilan au 31 d´┐Żcembre 2005 : une r´┐Żforme r´┐Żussie 37
Des perspectives tr´┐Żs encourageantes pour 2006 et 2007 39
L’impact budg´┐Żtaire et fiscal de la r´┐Żforme du financement du nouveau PTZ jusqu’en 2010 : une d´┐Żcroissance rapide des versements de subventions 39
2. La relance de la location-accession par la cr´┐Żation d’un pr´┐Żt sp´┐Żcifique 40
Le contrat de location-accession : un contrat en deux phases 40
Le pr´┐Żt social de location-accession (PSLA) : un mode de financement adapt´┐Ż au contrat de location-accession 41
Un pr´┐Żt conventionn´┐Ż accord´┐Ż aux personnes morales 41
Des avantages fiscaux garantissant l’´┐Żquilibre financier des op´┐Żrations 42
Les modalit´┐Żs financi´┐Żres du pr´┐Żt 43
Un encadrement strict du dispositif 43
Un contrat assorti de garanties 44
Une proc´┐Żdure d’agr´┐Żment en deux temps 45
Un dispositif qui r´┐Żpond aux besoins de logement du segment de march´┐Ż interm´┐Żdiaire entre le locatif social et les op´┐Żrations classiques d’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż 45
3. Le portage foncier 46
4. Le pr´┐Żt ´┐Ż l’accession sociale 47
5. La participation financi´┐Żre de l’ANRU 47
6. La promotion d’un habitat diversifi´┐Ż dans les quartiers en r´┐Żnovation urbaine : un taux r´┐Żduit de TVA pour les op´┐Żrations d’accession r´┐Żalis´┐Żes en zone urbaine sensible 47
7. Les SACICAP : des missions recentr´┐Żes sur l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż 47
B.— LA MAISON ´┐Ż 100 000 EUROS : UN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL AMBITIEUX CONJUGUANT LES DISPOSITIFS D’ACCESSION ET LA PARTICIPATION DES COLLECTIVIT´┐ŻS LOCALES 48
Des normes de qualit´┐Ż exigeantes 48
Trois types de montages financiers sont propos´┐Żs selon la localisation des projets de construction de maisons ´┐Ż 100 000 euros 49
L’objectif : r´┐Żaliser 20 000 maisons ´┐Ż 100 000 euros par an 49
MESDAMES, MESSIEURS,
L’ann´┐Że 2006 aura ´┐Żt´┐Ż une ann´┐Że phare pour le secteur du logement, tant sur le plan l´┐Żgislatif et r´┐Żglementaire que sur le terrain.
En effet, alors que les chiffres des mises en chantier et des d´┐Żlivrances de permis de construire atteignent des niveaux historiques, l’ann´┐Że 2006 aura ´┐Żgalement ´┐Żt´┐Ż celle de l’adoption de la loi n´┐Ż 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et d’importants dispositifs r´┐Żglementaires, ainsi que du d´┐Żveloppement du programme des ´┐Ż maisons ´┐Ż 100 000 euros ´┐Ż.
Ainsi, tous les maillons de la cha´┐Żne du logement sont vis´┐Żs par la politique d’ensemble que m´┐Żne le Gouvernement depuis 2003 : le logement social, l’h´┐Żbergement d’urgence, la r´┐Żsorption de l’habitat indigne, la lutte contre la vacance, le logement conventionn´┐Ż, le logement interm´┐Żdiaire, la r´┐Żnovation urbaine et la relance de l’accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż.
D’un point de vue budg´┐Żtaire, le Gouvernement s’est efforc´┐Ż d’inscrire la politique du logement dans la dur´┐Że, en coh´┐Żrence avec les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances : ainsi, la relance de la construction de logements sociaux et la politique de r´┐Żnovation urbaine sont-elles d´┐Żsormais inscrites dans le cadre pluriannuel du plan de coh´┐Żsion sociale et du programme national de r´┐Żnovation urbaine. Sur le terrain, les premiers effets de ces deux dispositifs commencent ´┐Ż se faire sentir, l’ensemble des acteurs – pr´┐Żfets et services d´┐Żconcentr´┐Żs, agences, ´┐Żlus locaux, bailleurs sociaux, am´┐Żnageurs et soci´┐Żt´┐Ż civile – s’´┐Żtant mobilis´┐Żs.
S’il dresse un bilan tr´┐Żs positif de la politique active men´┐Że par le Gouvernement pour enrayer la crise du logement, votre rapporteur souhaiterait n´┐Żanmoins soulever quelques interrogations concernant notamment l’avenir du livret A, le maintien par le Gouvernement du seuil de 24 euros pour le versement des aides personnalis´┐Żes au logement, et l’affectation des terrains c´┐Żd´┐Żs par l’Etat ´┐Ż la construction de logements sociaux.
Il s’interroge ´┐Żgalement quant ´┐Ż l’impact de la hausse des taux d’int´┐Żr´┐Żt sur le retournement du march´┐Ż immobilier, notamment aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, ainsi que sur la capacit´┐Ż du mouvement des HLM ´┐Ż r´┐Żpondre ´┐Ż un double objectif : la mont´┐Że en puissance simultan´┐Że des op´┐Żrations de r´┐Żnovation urbaine, et de l’effort de production de logements sociaux, qui, en l’´┐Żtat actuel, est envisag´┐Ż sans mesure suppl´┐Żmentaire.
Apr´┐Żs avoir analys´┐Ż la conjoncture du secteur de la construction en 2005 et 2006, ainsi que le contenu du budget du logement pour 2007, votre rapporteur pour avis s'attachera ´┐Ż ´┐Żtudier un secteur particulier de la politique du logement. En raison d’une actualit´┐Ż dense en la mati´┐Żre, et des orientations soutenues par la Commission des affaires ´┐Żconomiques lors de l’examen du projet de loi portant engagement national pour le logement, votre rapporteur a choisi de pr´┐Żsenter l’ensemble des dispositifs de soutien ´┐Ż l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż.
L'article 49 de la loi organique du premier ao´┐Żt 2001 fixe comme date butoir, pour le retour des r´┐Żponses aux questionnaires budg´┐Żtaires, le 10 octobre 2006. A cette date, 89,4 % des r´┐Żponses lui ´┐Żtaient parvenues.
I.— 2006 : UNE ANN´┐ŻE PHARE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT
L’ann´┐Że 2006 aura ´┐Żt´┐Ż une ann´┐Że phare pour le secteur de la construction et du logement en raison des r´┐Żsultats historiques enregistr´┐Żs dans le secteur de la construction, fruit de la politique de relance men´┐Że par le Gouvernement.
L’ann´┐Że 2005 a ´┐Żt´┐Ż une ann´┐Że tr´┐Żs favorable pour l’activit´┐Ż du b´┐Żtiment en France et m´┐Żme historique pour la construction neuve de logements qui, gr´┐Żce au dispositif fiscal d’aide ´┐Ż l’investissement locatif, ´┐Ż des conditions de pr´┐Żt avantageuses et ´┐Ż la politique de relance du logement social, a tir´┐Ż l’ensemble de l’activit´┐Ż ´┐Ż la hausse. L’activit´┐Ż d’entretien des b´┐Żtiments progresse et les efforts d’investissement de l’Etat et des collectivit´┐Żs locales ont ´┐Żgalement contribu´┐Ż ´┐Ż la bonne sant´┐Ż du secteur. Au total, l’activit´┐Ż du b´┐Żtiment a augment´┐Ż de 3,6 % en volume par rapport ´┐Ż 2004.
La construction de logement neuf est une activit´┐Ż en pleine expansion en 2005, profitant de l’accroissement du nombre des logements mis en chantier en 2004 et en 2005. 314 000 logements mis en chantier en 2003, 363 000 en 2004 et 410 000 en 2005, record in´┐Żgal´┐Ż depuis 25 ans.
Ann´┐Że |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Mise en chantier |
312 530 |
324 840 |
308 396 |
307 711 |
310 586 |
314 364 |
362 887 |
410 188 |
Le contexte de forte demande, les bonnes conditions de pr´┐Żt ainsi que la politique mise en œuvre en faveur de l’investissement locatif, du logement social et de l’accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż expliquent cette envol´┐Że.
Tous les segments du march´┐Ż – qu’il s’agisse des logements individuels ou collectifs, des logements sociaux ou des logements priv´┐Żs – connaissent une poursuite de la croissance enregistr´┐Że en 2005. Ainsi, le plan de coh´┐Żsion sociale a permis de relancer la construction de logements locatifs sociaux, en hausse de pr´┐Żs de 10 % si l’on ne tient compte que des logements dont le ma´┐Żtre d’ouvrage est public et social.
L’activit´┐Ż li´┐Że ´┐Ż la construction de logements neufs cro´┐Żt de 10,3 % en 2005 apr´┐Żs une croissance de 9,6 % enregistr´┐Że en 2004.
L’ACTIVIT´┐Ż DANS LE LOGEMENT NEUF
2003/2002* |
2004/2003* |
2004 |
2005/2004* | ||
Logement neuf |
1,3 % |
9,6 % |
30,4 |
10,3 % | |
Dont |
Individuel |
1,4 % |
8,7 % |
21,0 |
6,0 % |
Collectif |
1,1 % |
11,8 % |
9,3 |
19,9 % | |
(*) : Evolution en volume, CA 2004 en valeur courante hors taxe
Source : SG/DAEI/BASP, mai 2006
De m´┐Żme, pr´┐Żs de 512 000 permis de construire ont ´┐Żt´┐Ż accord´┐Żs en 2005, soit un niveau qui n’avait ´┐Żgalement pas ´┐Żt´┐Ż atteint depuis 25 ans. Le nombre de permis de construire accord´┐Żs en 2005 montrait d´┐Żj´┐Ż que la forte reprise en mati´┐Żre de production de logements s’inscrivait dans la dur´┐Że. Cela se confirme en 2006 avec une nouvelle hausse des mises en chantier de logements, qui atteignent d´┐Żsormais un rythme annuel de 430 000.
Ann´┐Że |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Permis de construire |
382 356 |
297 150 |
330 469 |
321 777 |
327 899 |
378 968 |
460 794 |
511 723 |
En 2005 cette activit´┐Ż conna´┐Żt une hausse de 1 % en volume apr´┐Żs avoir enregistr´┐Ż une hausse de 1,1 % l’ann´┐Że pr´┐Żc´┐Żdente. Les travaux non aid´┐Żs, qui repr´┐Żsentaient 25,2 milliards d’euros en 2004, ont progress´┐Ż de 2,9 % en 2005 tandis que l’on enregistre un recul de 11,9 % pour les travaux aid´┐Żs.
CA en milliards euros hors taxe, |
2004/03 |
2004 |
2005/04 |
Entretien-am´┐Żlioration du logement |
1,1 % |
28,8 |
1,0 % |
Dont travaux aid´┐Żs |
- 7,0 % |
3,4 |
- 11,9 % |
Dont travaux non aid´┐Żs |
2,3 % |
25,4 |
2,9 % |
Travaux aid´┐Żs : travaux d’entretien-am´┐Żlioration du logement b´┐Żn´┐Żficiant de PALULOS,
PLUS, PLAI, PLS, PAH, d’aides de l’ANAH ou bien de l’ANRU.
Source : SG/DAEI/BASP, mai 2006.
L’ensemble de l’activit´┐Ż enregistr´┐Że dans le secteur des b´┐Żtiments non r´┐Żsidentiels – activit´┐Ż qui inclut aussi bien la construction neuve que l’entretien des b´┐Żtiments existants – a augment´┐Ż de 0,8 % en volume en 2005.
L’activit´┐Ż de construction neuve de b´┐Żtiments non r´┐Żsidentiels est en l´┐Żg´┐Żre hausse en 2005 (+ 0,4 % en volume par rapport ´┐Ż 2004) alors que l’activit´┐Ż d’entretien progresse davantage, en hausse de 1,3 % ´┐Ż prix constant sur l’ann´┐Że 2005.
En 2005, les mises en chantier de b´┐Żtiments non r´┐Żsidentiels ont ´┐Żt´┐Ż stables (- 0,1 % par rapport ´┐Ż 2004). La production de bureaux et de commerces a augment´┐Ż respectivement de 6,5 % et de 5,6 % en volume en 2005, b´┐Żn´┐Żficiant de la croissance de l’emploi tertiaire. La construction de commerces profite par ailleurs du d´┐Żveloppement tr´┐Żs actif du logement neuf.
L’´┐Żl´┐Żment qui a marqu´┐Ż l’ann´┐Że 2005 est la tr´┐Żs forte progression des permis d´┐Żpos´┐Żs (+ 12 % en 2005). En termes d’autorisations, tous les secteurs sont tr´┐Żs bien orient´┐Żs, en particulier les bureaux, les commerces, les b´┐Żtiments industriels et de stockage, ainsi que les locaux destin´┐Żs ´┐Ż la sant´┐Ż, ´┐Ż l’hygi´┐Żne et ´┐Ż l’action sociale. Cette forte augmentation des surfaces autoris´┐Żes laisse pr´┐Żsager des investissements dynamiques en 2006 et t´┐Żmoigne des premiers signes d’une reprise robuste de la commande priv´┐Że.
LA CONSTRUCTION DES B´┐ŻTIMENTS NON R´┐ŻSIDENTIELS EN 2005
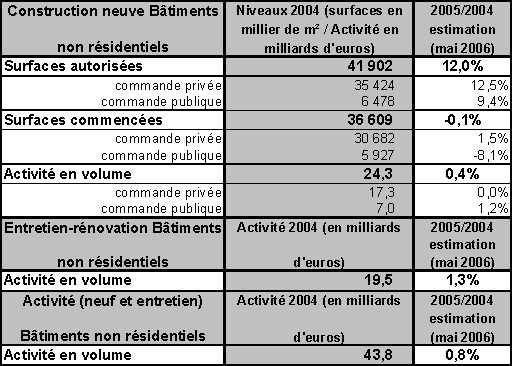
´┐Żvolutions en volume
Source : SG / DAEI / SITADEL et BASP, mai 2006
La progression de l’activit´┐Ż des entreprises de b´┐Żtiment devrait s’amplifier en 2006 avec une croissance attendue comprise entre 4,7 % en hypoth´┐Żse basse et 5,7 % en hypoth´┐Żse haute.
L’activit´┐Ż li´┐Że ´┐Ż la construction neuve de logements est ´┐Ż nouveau le moteur de cette croissance mais les autres secteurs sont ´┐Żgalement porteurs. En particulier la construction neuve de b´┐Żtiments non r´┐Żsidentiels b´┐Żn´┐Żficie d’une reprise de la commande des entreprises.
Le nombre des logements autoris´┐Żs et commenc´┐Żs a connu une forte hausse au 1er semestre 2006. Plus de 550 000 autorisations et 430 000 logements commenc´┐Żs sont comptabilis´┐Żs en glissement annuel, soit des hausses de 13,8 et de 12 % en rythme annuel. Ce sont des niveaux d’activit´┐Ż jamais enregistr´┐Żs depuis 1980.
Compte tenu de ces excellents r´┐Żsultats, la croissance de l’activit´┐Ż sera toujours tr´┐Żs soutenue, en hausse de 10 % en 2006. L’ensemble des segments du logement, individuel et collectif, priv´┐Ż et social, progresseront en 2006 que ce soit en termes de nombre de logements mis en chantier ou en termes d’activit´┐Ż.
Les premiers effets du plan de coh´┐Żsion sociale commencent ´┐Ż se ressentir sur les mises en chantier de logements sociaux en 2006. La hausse du nombre de logements sociaux financ´┐Żs se traduit en premier lieu par une augmentation du nombre de logements sociaux neufs financ´┐Żs.
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | |
Logements sociaux financ´┐Żs |
42 262 |
56 595 |
55 344 |
58 090 |
70 378 |
80 430 |
Logements sociaux neufs financ´┐Żs |
32 924 |
44 243 |
41 688 |
44 008 |
59 582 |
66 597 |
La hausse du nombre de logements commenc´┐Żs dont le ma´┐Żtre d’ouvrage est public ou social s’´┐Żl´┐Żvera ainsi ´┐Ż 18 % entre 2005 et 2006.
Les politiques d’incitation ´┐Ż l’investissement locatif et ´┐Ż l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż contribuent ´┐Ż ces niveaux de production tr´┐Żs ´┐Żlev´┐Żs (cf. infra la pr´┐Żsentation des dispositifs d’amortissement locatif, et de la politique d’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż men´┐Że par le Gouvernement).
L’ACTIVIT´┐Ż LOGEMENT NEUF : PR´┐ŻVISIONS 2006
2003/2002* |
2004/2003* |
2004 |
2005/2004* |
2006/2005* | |||
Hypo haute |
Hypo basse | ||||||
Logement neuf |
1,3 % |
9,6 % |
30,4 |
10,3 % |
10,2 % |
8,8 % | |
Dont |
Individuel |
1,4 % |
8,7 % |
21,0 |
6,0 % |
7,3 % |
5,8 % |
Collectif |
1,1 % |
11,8 % |
9,3 |
19,9 % |
15,7 % |
14,7 % | |
(*) : ´┐Żvolution en volume, CA 2004 en valeur
Source : SG/DAEI/BASP, mai 2006
2004 |
2005 |
´┐Żvolutions |
Pr´┐Żvisions |
´┐Żvolutions | |
Total des mises en chantier |
363 003 |
410 488 |
13 % |
429 386 |
5 % |
Logements individuels |
215 942 |
228 816 |
6 % |
237 449 |
4 % |
Logements collectifs |
147 061 |
181 672 |
24 % |
191 937 |
6 % |
Logements sous ma´┐Żtrises d’ouvrage de particuliers |
189 394 |
197 306 |
4 % |
204 251 |
4 % |
Logements sous ma´┐Żtrise d’ouvrage sociale ou publique |
38 860 |
43 094 |
11 % |
50 787 |
18 % |
Autres (incluant logements sociaux sous ma´┐Żtrise d’ouvrage priv´┐Że) |
134 749 |
170 088 |
26 % |
174 348 |
3 % |
Aux logements sous ma´┐Żtrise d’ouvrage sociale et publique mis en chantier, il convient d’ajouter :
– les logements acquis par l’Association fonci´┐Żre logement et lou´┐Żs ´┐Ż des locataires sous conditions de plafonds de loyers et de ressources de type ´┐Ż PLS ´┐Ż, ce qui repr´┐Żsente 4 200 logements en 2005 ;
– et les logements sous ma´┐Żtrise d’ouvrage priv´┐Że acquis par des bailleurs sociaux, soit environ 1 500 logements par an.
D’autres logements sous ma´┐Żtrise d’ouvrage priv´┐Że sont ´┐Żgalement acquis par des investisseurs ´┐Ż l’aide d’un pr´┐Żt locatif ´┐Ż usage social (PLS) et mis en location ´┐Ż des conditions sociales : on estime que cela repr´┐Żsente 2 000 ´┐Ż 3 000 logements.
Au total, on peut donc estimer qu’au moins 7 000 ´┐Ż 8 000 logements comptabilis´┐Żs parmi dans les mises en chantier sous ma´┐Żtrise d’ouvrage priv´┐Że ont contribu´┐Ż en 2005 ´┐Ż l’augmentation de l’offre sociale. Cela se v´┐Żrifiera ´┐Żgalement en 2006 et les ann´┐Żes suivantes.
La construction de logements neufs devrait ainsi d´┐Żpass´┐Ż le record ´┐Żtabli en 2005, pour atteindre un volume de 430 000 mises en chantier.
L’activit´┐Ż li´┐Że ´┐Ż l’entretien-am´┐Żlioration du logement resterait bien orient´┐Że en 2006 avec une croissance comparable ´┐Ż celle enregistr´┐Że en 2005. Le maintien de la TVA ´┐Ż 5,5 % (cf. infra la pr´┐Żsentation des d´┐Żpenses fiscales profitant au secteur du logement et de la construction), la croissance des revenus et le bas niveau des taux d’int´┐Żr´┐Żt devraient contribuer ´┐Ż soutenir la demande de telle sorte que l’activit´┐Ż augmenterait entre 1 et 1,5 % en 2006.
Evolution de l’activit´┐Ż en % |
2004/03 |
2005/04 |
2006/05 |
2006/05 |
Entretien-am´┐Żlioration du logement |
1,1 % |
1,0 % |
1,5 % |
1,0 % |
Dont travaux aid´┐Żs |
- 7,0 % |
- 11,9 % |
3,1 % |
3,1 % |
Dont travaux non aid´┐Żs |
2,3 % |
2,9 % |
1,3 % |
0,8 % |
Source : SG/DAEI/BASP, mai 2006.
3. La construction des b´┐Żtiments non r´┐Żsidentiels : une franche reprise de la construction priv´┐Że
L’ensemble de l’activit´┐Ż de construction de b´┐Żtiments non r´┐Żsidentiels devrait progresser en 2006 dans une fourchette comprise entre 4,2 % et 5,2 % par rapport aux r´┐Żsultats enregistr´┐Żs en 2005.
La croissance de la construction neuve a ´┐Żt´┐Ż r´┐Żvis´┐Że nettement ´┐Ż la hausse par rapport aux pr´┐Żvisions de novembre 2005, compte tenu des r´┐Żsultats tr´┐Żs favorables de la construction neuve au 4e trimestre 2005 et surtout au premier semestre 2006 (+13 % pour les autorisations et + 8,6 % pour les mises en chantier sur 12 mois glissants ´┐Ż la fin juin 2006). Au total sur l’ann´┐Że, la progression de l’activit´┐Ż de construction neuve devrait ´┐Żtre comprise entre + 6,4 % et 7,6 % par rapport ´┐Ż 2005. L’activit´┐Ż d’entretien devrait quant ´┐Ż elle augmenter entre 1,4 % et 2,1 % en 2006.
Ainsi, apr´┐Żs plusieurs ann´┐Żes de croissance atone, la diminution du taux de ch´┐Żmage et la progression de l’emploi tertiaire devraient s’acc´┐Żl´┐Żrer en 2006, tout comme les investissements de capacit´┐Ż r´┐Żalis´┐Żs par les entreprises. Les secteurs les mieux orient´┐Żs devraient ´┐Żtre ceux li´┐Żs ´┐Ż la commande priv´┐Że (les bureaux, les commerces, les b´┐Żtiments industriels et de stockage). Concernant la commande publique, la progression de la construction des locaux destin´┐Żs ´┐Ż la sant´┐Ż, ´┐Ż la culture et aux loisirs devrait compenser la diminution de la production des b´┐Żtiments li´┐Żs ´┐Ż l’enseignement.
´┐ŻVOLUTION PR´┐ŻVISIONNELLE EN VOLUME DE L'ACTIVIT´┐Ż LI´┐ŻE AU B´┐ŻTIMENT NON R´┐ŻSIDENTIEL EN 2006
B´┐Żtiments non r´┐Żsidentiels |
2006/2005 Hypo |
2006/2005 Hypo |
Haute (mai 2006) |
Basse (mai 2006) | |
Construction neuve |
7,6 % |
6,4 % |
commande priv´┐Że |
8,9 % |
7,7 % |
commande publique |
4,4% |
3,3 % |
Entretien-r´┐Żnovation |
2,1 % |
1,4% |
Activit´┐Ż (neuf et entretien) |
5,2 % |
4,2 % |
´┐Żvolutions en volume
Source : SG / DAEI / SITADEL et BASP, mai 2006
II.— LE BUDGET DU LOGEMENT POUR 2007 : UNE PRIORIT´┐Ż DANS LE CADRE DU PLAN DE COH´┐ŻSION SOCIALE
En 2007, le budget du logement devrait s’´┐Żlever ´┐Ż 6,15 milliards d’euros d’autorisations d’engagement, soit une baisse de 2,53 % par rapport ´┐Ż 2006 et ´┐Ż 5,98 milliards d’euros de cr´┐Żdits de paiement, soit une baisse de 5,49 % par rapport ´┐Ż 2006. Il se d´┐Żcompose en deux programmes :
– le programme ´┐Ż aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement ´┐Ż qui repr´┐Żsente 4,92 milliards d’euros d’autorisations de programme et de cr´┐Żdits de paiement, en baisse de 3,83 % par rapport ´┐Ż 2006 ;
– le programme ´┐Ż d´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż qui repr´┐Żsente 1,23 milliard d’euros d’autorisations de programme, en hausse de 3,1 % par rapport ´┐Ż 2006, et 1,06 milliard d’euros de cr´┐Żdits de paiement, en baisse de 12,49 % par rapport ´┐Ż 2006.
(en millions d’euros)
Autorisations d’engagement |
Cr´┐Żdits de paiement | |||||
LFI 2006 |
PLF 2007 |
2006/2007 |
LFI 2006 |
PLF 2007 |
2006/2007 | |
Aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement |
5.114 |
4.918 |
–3,83 % |
5.114 |
4.918 |
– 3,83 % |
Aides personnelles |
5.107 |
4.911 |
– 3,84 % |
5.107 |
4.911 |
– 3,84 % |
Accompagnement des publics en difficult´┐Żs |
7,68 |
7,99 |
4,04 % |
7,68 |
7,99 |
4,04 % |
D´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement |
1.194 |
1.231 |
3,10 % |
1.209 |
1.058 |
– 12,49 % |
Construction locative et am´┐Żlioration du parc |
996,7 |
1.032 |
3,54 % |
944,7 |
855,36 |
– 9,46 % |
Soutien ´┐Ż l’accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż |
14,74 |
7,7 |
– 47,76 % |
84,74 |
14,7 |
– 82,65 % |
Lutte contre l’habitat indigne |
20 |
26 |
30 % |
18 |
23 |
27,78 % |
R´┐Żglementation de l’habitat, politique technique et qualit´┐Ż de la construction |
6,6 |
7,4 |
12,12 % |
5,9 |
7,4 |
25,42 % |
Soutien |
156,90 |
157,67 |
0,49 % |
156,49 |
157,67 |
0,75 % |
Total |
6.310 |
6.150 |
– 2,53 % |
6.325 |
5.977 |
– 5,49 % |
A.— LE PROGRAMME ´┐Ż AIDE ´┐Ż L’ACC´┐ŻS AU LOGEMENT ´┐Ż : UN PROGRAMME MARQU´┐Ż PAR LA REVALORISATION D’1,8 % DU BAR´┐ŻME DES AIDES AU LOGEMENT
Le programme ´┐Ż aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement ´┐Ż regroupe l’ensemble des aides accord´┐Żes directement ou indirectement aux m´┐Żnages qui, pour de multiples raisons (financi´┐Żres, sociales…), rencontrent des difficult´┐Żs pour acc´┐Żder ´┐Ż un logement d´┐Żcent ou s’y maintenir durablement. Ce programme devrait ´┐Żtre dot´┐Ż en 2007 de 4,918 milliards d’euros (soit une baisse de 3,83 % par rapport ´┐Ż 2006).
LFI 2006 |
PLF 2007 | ||
Programme aide ´┐Ż l'acc´┐Żs au logement Action "aides personnelles au logement" | |||
61 transferts aux m´┐Żnages |
AE |
5 107 000 000 |
4 911 000 000 |
CP |
5 107 000 000 |
4 911 000 000 | |
TOTAL Action "aides personnelles au logement" |
AE |
5 107 000 000 |
4 911 000 000 |
CP |
5 107 000 000 |
4 911 000 000 | |
Action "accompagnement des publics en difficult´┐Ż" | |||
ADIL |
|||
64 transferts aux autres collectivit´┐Żs |
AE |
5 910 000 |
6 250 000 |
CP |
5 910 000 |
6 250 000 | |
Autres associations |
|||
64 transferts aux autres collectivit´┐Żs |
AE |
1 740 000 |
1 740 000 |
CP |
1 740 000 |
1 740 000 | |
TOTAL Action "accompagnement des publics en difficult´┐Ż" |
AE |
7 650 000 |
7 990 000 |
CP |
7 650 000 |
7 990 000 | |
TOTAL Programme aide ´┐Ż l'acc´┐Żs au logement |
AE |
5 114 650 000 |
4 918 990 000 |
CP |
5 114 650 000 |
4 918 990 000 | |
Cette action couvre la contribution de l’Etat au financement des aides personnelles au logement et est dot´┐Że de 4,911 milliards d’euros, soit une baisse de 3,84 %.
Ce montant correspond ´┐Ż la contribution de l’Etat au financement des aides personnelles au logement par une dotation au fonds national d’aide au logement (FNAL).
Le bar´┐Żme des aides personnelles au logement sera revaloris´┐Ż de 1,8 % sur les loyers et sur les charges, ´┐Ż compter du 1er janvier 2007. L’ensemble des actualisations des APL repr´┐Żsentera une augmentation des prestations de 259 millions d’euros en 2007, dont 127 millions d’euros seront pris en charge sur le budget de l’Etat.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, cette baisse de 3,84 % s’expliquerait par l’am´┐Żlioration de la situation ´┐Żconomique des m´┐Żnages, et en particulier la baisse du ch´┐Żmage, l’augmentation des cotisations en provenance des employeurs, et la moindre augmentation des loyers.
En effet, le nouvel indice de r´┐Żvision des loyers est entr´┐Ż en vigueur le 1er janvier 2006, et exerce un effet de mod´┐Żration des loyers. Ce nouvel indice ´┐Żvolue depuis le d´┐Żbut de l’ann´┐Że 2006 ´┐Ż un rythme plus faible que l’indice du co´┐Żt de la construction.
Le nouvel indice de r´┐Żf´┐Żrence des loyers
L’indice du co´┐Żt de la construction (ICC), qui servait auparavant de r´┐Żf´┐Żrence ´┐Ż la r´┐Żvision des loyers dans le parc priv´┐Ż, a connu des hausses importantes d´┐Żcoulant de l’augmentation des prix internationaux du p´┐Żtrole et des mati´┐Żres premi´┐Żres, en particulier, de l’acier : c’est pourquoi le Gouvernement a mis en place un nouvel indice, l’indice de r´┐Żf´┐Żrence des loyers, calcul´┐Ż ´┐Ż partir de l’´┐Żvolution des prix ´┐Ż la consommation, du co´┐Żt des travaux d’entretien et d’am´┐Żlioration des logements ´┐Ż la charge des bailleurs, et de l’ICC. La pond´┐Żration des indices retenus dans le nouvel indice est de 60 % pour l’indice des prix ´┐Ż la consommation, 20 % pour l’indice des prix d’entretien et d’am´┐Żlioration, et 20 % pour l’ICC.
En outre, les ressources du FNAL augmenteront gr´┐Żce ´┐Ż un alignement de la cotisation des employeurs publics sur celle des employeurs priv´┐Żs : cet alignement r´┐Żduit les sommes ´┐Ż verser au FNAL ´┐Ż partir du programme ´┐Ż aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement ´┐Ż d’un montant de 236 millions d’euros en 2007. En outre, la contribution exceptionnelle des soci´┐Żt´┐Żs anonymes de cr´┐Żdit immobilier (SACI) ´┐Ż la politique du logement se traduira par un apport de 150 millions d’euros au FNAL en 2007.
Les subventions aux associations augmentent de 4,4 %, notamment en vue d’aider ´┐Ż la cr´┐Żation de trois nouvelles agences d´┐Żpartementales pour l’information sur le logement (ADIL).
FINANCEMENT DU FNAL
(en millions d’euros)
Ressources du FNAL |
Charges du FNAL | ||
Contribution des r´┐Żgimes sociaux |
3,614 |
Prestations APL |
6,317 |
– dont CNAF |
3,506 |
Prestations ALS |
4,302 |
– dont ALS |
108 |
Frais de gestion |
212 |
Cotisation des employeurs |
2,016 |
– |
|
Contribution de l’Etat |
4,911 |
– |
|
Affectation d’une partie de la taxe sur les tabacs |
140 |
||
Recette exceptionnelle |
150 |
– |
|
Total |
10,831 |
10,831 | |
Il convient de souligner que le FNAL est ´┐Żquilibr´┐Ż pour la premi´┐Żre fois ´┐Ż l’aide de la contribution exceptionnelle des SACI et d’une affectation d’une partie de la taxe sur les tabacs (1).
Le programme ´┐Ż aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement ´┐Ż comprend les subventions accord´┐Żes annuellement aux associations sp´┐Żcialis´┐Żes dans le domaine du logement, qui jouent un r´┐Żle important dans la mise en œuvre du droit au logement et dans le conseil et l’assistance du public.
Les subventions aux associations devraient repr´┐Żsenter en 2007 un total de 7,99 millions d’euros (en hausse de 4,04 %), dont 6,25 millions d’euros aux ADIL et ´┐Ż l’agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) - dont une dotation permettant la cr´┐Żation de trois ADIL.
2. La n´┐Żcessit´┐Ż de renforcer les moyens de cette action afin de remettre en cause le seuil des 24 euros conditionnant le versement de l’aide personnalis´┐Że au logement
Votre rapporteur a alert´┐Ż ´┐Ż plusieurs reprises le Gouvernement sur la n´┐Żcessit´┐Ż de supprimer le seuil de 24 euros en de´┐Ż´┐Ż duquel les aides au logement ne sont pas vers´┐Żes aux m´┐Żnages. Ce seuil, qui s’´┐Żlevait initialement ´┐Ż 15 euros et n’avait pas ´┐Żt´┐Ż r´┐Ż´┐Żvalu´┐Ż depuis 1988, a ´┐Żt´┐Ż actualis´┐Ż au printemps 2004, ´┐Ż hauteur de 24 euros.
Selon le Gouvernement, il s’agissait de ´┐Ż rattraper avec beaucoup de retard l’inflation enregistr´┐Że sur cette p´┐Żriode ´┐Ż. Dans une r´┐Żponse ´┐Ż une question ´┐Żcrite de M. William Dumas, d´┐Żput´┐Ż du Gard, le ministre de l’emploi, de la coh´┐Żsion sociale et du logement, a indiqu´┐Ż que ´┐Ż 98 % des 6 millions de b´┐Żn´┐Żficiaires des aides personnelles au logement ne sont pas concern´┐Żs par cette mesure ´┐Ż.
Votre rapporteur reconna´┐Żt que le Gouvernement a fait des efforts importants en faveur des b´┐Żn´┐Żficiaires des aides personnelles au logement :
– ces aides ont ´┐Żt´┐Ż revaloris´┐Żes de 1,8 % ´┐Ż compter du 1er septembre 2006 et de 1,8%, pour les loyers et pour les charges, ´┐Ż compter du 1er janvier 2007 (cf. supra) ;
– en outre, l’action du Gouvernement en faveur des aides personnelles au logement est compl´┐Żt´┐Że par une politique de mod´┐Żration des loyers, avec la mise en place du nouvel indice de r´┐Żf´┐Żrence des loyers (cf. supra).
Cela ´┐Żtant, votre rapporteur souhaiterait attirer l’attention du Gouvernement sur la n´┐Żcessit´┐Ż de supprimer le seuil de 24 euros. Dans le cadre de l’examen du projet de loi portant engagement national pour le logement, la Commission des affaires ´┐Żconomiques, de l’environnement et du territoire a adopt´┐Ż ´┐Ż l’unanimit´┐Ż trois amendements identiques d´┐Żpos´┐Żs par le rapporteur du projet de loi, M. G´┐Żrard Hamel, par votre rapporteur pour avis, et par M. Jean-Yves Le Bouillonnec. N´┐Żanmoins, ces amendements ont ´┐Żt´┐Ż d´┐Żclar´┐Żs irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution.
C’est la raison pour laquelle votre rapporteur propose ´┐Ż la Commission d’adopter un amendement pr´┐Żsent´┐Ż par votre rapporteur (amendement n´┐Ż II-165) modifiant la r´┐Żpartition des cr´┐Żdits entre les programmes de la mission ´┐Ż ville et logement ´┐Ż, afin de d´┐Żgager les cr´┐Żdits de l’Etat n´┐Żcessaires ´┐Ż une r´┐Żforme du r´┐Żgime des APL, et supprimant ce seuil, r´┐Żforme que le Parlement appelle de ses voeux. On estime cette d´┐Żpense ´┐Ż environ 34 millions d’euros pour l’Etat.
En 2007, le programme ´┐Ż d´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż devrait ´┐Żtre dot´┐Ż de 1,231 milliard d’euros d’autorisations d’engagement, en hausse de 3,1 % et de 1,058 milliard d’euros de cr´┐Żdits de paiement, ce qui repr´┐Żsente une baisse de 12,49 %, r´┐Żpartis en cinq actions.
Cette action regroupe les moyens consacr´┐Żs au d´┐Żveloppement et ´┐Ż l’am´┐Żlioration du parc locatif social, en dehors des zones urbaines sensibles qui sont dans le champ d’intervention de l’ANRU (et qui rel´┐Żve du programme ´┐Ż r´┐Żnovation urbaine ´┐Ż).
L’avenir du livret A menac´┐Ż ?
La question du livret A s’inscrit dans le double contexte :
– du financement et de la s´┐Żcurisation du logement social,
– et du traitement de l’´┐Żpargne populaire.
Il est un facteur important de coh´┐Żsion sociale, puisqu’il prot´┐Żge l’´┐Żpargne populaire et contribue ´┐Ż la lutte contre l’exclusion bancaire.
a) Le livret A, fondement du financement des pr´┐Żts au logement social
Le syst´┐Żme fran´┐Żais de financement du logement social repose sur des pr´┐Żts de longue dur´┐Że assis sur le livret A, qui apporte une ressource abondante et stable ´┐Ż long terme. Cette ressource est centralis´┐Że par la Caisse des d´┐Żp´┐Żts et consignations.
Chaque op´┐Żration de r´┐Żalisation de logements sociaux est financ´┐Że pour l’essentiel par un pr´┐Żt ´┐Ż long terme – 40 ans pour la construction, 50 ans pour le foncier –, ´┐Ż taux d’int´┐Żr´┐Żt r´┐Żglement´┐Żs, ce qui permet de r´┐Żduire la part des aides publiques directes et fiscales.
Accord´┐Ż de mani´┐Żre non discriminatoire ´┐Ż toute op´┐Żration qui re´┐Żoit l’agr´┐Żment des pouvoirs publics le pr´┐Żt repose sur la capacit´┐Ż de la Caisse des d´┐Żp´┐Żts et consignations ´┐Ż transformer une ´┐Żpargne liquide en pr´┐Żts ´┐Ż long terme. L’encours des pr´┐Żts avoisine 85 milliards d’euros pour une collecte de 110 milliards d’euros. Le remboursement du pr´┐Żt est garanti par la solidit´┐Ż financi´┐Żre des organismes de logement social, par une caisse de garantie aliment´┐Że par une cotisation obligatoire, la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), ainsi que par une garantie des collectivit´┐Żs territoriales. L’Etat garantit les d´┐Żp´┐Żts, ce qui permet aux ´┐Żpargnants de pouvoir retirer leurs fonds ´┐Ż tout moment et de maintenir la collecte ´┐Ż un niveau suffisant.
b) Un outil d’´┐Żpargne populaire
Le livret A constitue ´┐Żgalement un outil d’´┐Żpargne populaire, ´┐Żquivalant ´┐Ż un compte bancaire pour les m´┐Żnages les plus modestes.
En effet, sur 46 millions de livrets A ouverts, repr´┐Żsentant 110 milliards d’euros de d´┐Żp´┐Żts, plus de la moiti´┐Ż repr´┐Żsentent des montants tr´┐Żs faibles, de moins de 150 euros. 74 % des livrets ouverts repr´┐Żsentent 5 % de l’encours de la collecte et 45 % des op´┐Żrations, tandis que 6 % d’entre eux repr´┐Żsentent 45 % de la collecte et 4 % des op´┐Żrations. Le livret A sert souvent de compte bancaire aux personnes les plus modestes, en particulier aux personnes ´┐Żg´┐Żes.
Le livret A repr´┐Żsente une forte activit´┐Ż de guichet, co´┐Żteuse pour le r´┐Żseau distributeur. Ce syst´┐Żme suppose que le distributeur qui g´┐Żre les petits livrets g´┐Żre aussi de ´┐Ż gros ´┐Ż livrets, afin d’op´┐Żrer une p´┐Żr´┐Żquation de ses co´┐Żts, qu’il ait un tr´┐Żs grand nombre de guichets, y compris en zone rurale et dans les quartiers en difficult´┐Ż, qu’il accepte de traiter les clients les plus modestes, et qu’il b´┐Żn´┐Żficie d’une commission tenant compte de cette r´┐Żpartition.
c) Des droits sp´┐Żciaux de distribution mis en question par la Commission europ´┐Żenne
La distribution du livret A repose sur des droits sp´┐Żciaux accord´┐Żs ´┐Ż trois r´┐Żseaux, mis en question par la Commission europ´┐Żenne, sur le fondement des r´┐Żgles de concurrence ´┐Żtablies par les trait´┐Żs communautaires.
Selon les informations fournies ´┐Ż votre rapporteur par le minist´┐Żre de l’emploi, de la coh´┐Żsion sociale et du logement, en cas de banalisation de la distribution du livret A, le risque serait de voir certains r´┐Żseaux distributeurs chercher, dans le cadre de leur politique commerciale, ´┐Ż capter les ´┐Ż gros clients ´┐Ż, en abandonnant la client´┐Żle la plus sociale aux r´┐Żseaux traditionnels de collecte. Dans ce cas, la commission servie ´┐Ż ces r´┐Żseaux ne serait plus en mesure de couvrir leurs co´┐Żts. Les agences les moins rentables devraient ´┐Żtre ferm´┐Żes et le service public d’´┐Żpargne populaire ne serait plus assur´┐Ż.
De plus, selon l’Union sociale pour l’habitat, ´┐Ż le livret A est concern´┐Ż par les trait´┐Żs, mais pas seulement au titre de la concurrence. La coh´┐Żsion sociale justifie un syst´┐Żme sp´┐Żcifique de financement du logement social, la protection de l’´┐Żpargne populaire, et la lutte contre l’exclusion, notamment l’exclusion bancaire. ´┐Ż L’USH estime en outre que les r´┐Żgles de concurrence ne sont nullement menac´┐Żes par des droits sp´┐Żciaux de distribution qui concernent moins de 4 % de l’´┐Żpargne financi´┐Żre des m´┐Żnages. Elle souligne ´┐Żgalement l’avantage d’un syst´┐Żme de financement du logement social qu’elle qualifie de ´┐Ż fort peu co´┐Żteux pour les finances publiques ´┐Ż.
Le poids du livret A, s’il est d´┐Żcisif pour le logement social, est faible pour le secteur bancaire, puisqu’il repr´┐Żsente moins de 4 % du patrimoine financier des m´┐Żnages.
Selon l’USH, ´┐Ż une d´┐Żstabilisation du syst´┐Żme aurait un impact n´┐Żgatif sur les finances publiques nationales et locales et sur l’offre de logement social : des pr´┐Żts peuvent ´┐Żtre n´┐Żgoci´┐Żs sur le march´┐Ż par les organismes de logement social, mais rarement sur des p´┐Żriodes aussi longues, et ils impliquent une s´┐Żlection et une tarification du risque, ´┐Żliminant ou p´┐Żnalisant certains organismes ´┐Ż.
En outre, compte tenu du nombre important de livrets actuellement distribu´┐Żs, la marge de d´┐Żveloppement permise par une banalisation de la distribution est probablement tr´┐Żs faible : l’exemple du livret d’´┐Żpargne populaire, dont la distribution est banalis´┐Że, illustre que la banalisation n’est nullement synonyme de collecte abondante.
Enfin, les taux de commissionnement des trois r´┐Żseaux concern´┐Żs ont ´┐Żt´┐Ż r´┐Żduits ´┐Ż deux reprises en douze mois.
Cette action inclut ´┐Żgalement les subventions destin´┐Żes ´┐Ż l’agence nationale de l’habitat (ANAH), ainsi que les aides d´┐Żdi´┐Żes ´┐Ż la r´┐Żalisation d’aires d’accueil des gens du voyage.
S’agissant du d´┐Żveloppement et de l’am´┐Żlioration du parc locatif social, le projet de loi de finances pr´┐Żvoit une dotation de 479,5 millions d’euros. Dans le cadre du plan de coh´┐Żsion sociale, 100 000 logements locatifs sociaux devraient ´┐Żtre financ´┐Żs en 2007.
La vente de terrains de l’Etat au profit de la construction de logements sociaux : un bilan contrast´┐Ż
Selon les informations fournies ´┐Ż votre rapporteur par le Gouvernement, le programme de mobilisation des terrains de l’Etat en faveur du logement porte sur environ 700 sites identifi´┐Żs, propri´┐Żt´┐Żs de l’Etat et de ses ´┐Żtablissements publics – terrains dont la cession doit d´┐Żboucher sur la r´┐Żalisation de 30 000 logements.
Le Gouvernement a en outre pr´┐Żcis´┐Ż qu’en juillet 2006, le programme s’´┐Żtablissait ´┐Ż plus de 25 000 logements - dont 35 % de logements locatifs sociaux (2) - r´┐Żpartis sur 280 sites, repr´┐Żsentant pr´┐Żs de 4 millions de m´┐Żtres carr´┐Żs.
PROGRAMME DE FINANCEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX EN 2007
Nombre de logements |
Co´┐Żt total | |
PLUS |
56.500 |
152,5 |
PLAI |
6.500 |
78,0 |
PLS |
37.000 |
– |
dont PLS fonci´┐Żre |
10.000 |
– |
Surcharge fonci´┐Żre |
– |
177,6 |
Sous total : offre nouvelle |
100.000 |
408,1 |
R´┐Żhabilitation et am´┐Żlioration de la qualit´┐Ż du service |
40.000 |
60,0 |
D´┐Żmolition |
1.000 |
34, |
H´┐Żbergement |
– |
5,0 |
Actions d’accompagnement |
– |
3,0 |
Total |
– |
479,5 |
Le programme de l’ANAH, d’un montant total de 527,3 millions d’euros, sera financ´┐Ż par la taxe sur les logements vacants, dont les recettes sont estim´┐Żes ´┐Ż 20 millions d’euros en 2007, et par une dotation de l’Etat de 507,3 millions d’euros.
PROGRAMME PR´┐ŻVISIONNEL DE L’ANAH EN 2007
Nombre de logements |
Co´┐Żt total | |
Production de logements ´┐Ż loyers ma´┐Żtris´┐Żs |
37.500 |
232,5 |
Remise sur le march´┐Ż de logements vacants |
18.000 |
45 |
Lutte contre l’habitat indigne et traitement des copropri´┐Żt´┐Żs en difficult´┐Żs |
35.600 |
105,7 |
Am´┐Żlioration des logements appartenant ´┐Ż des propri´┐Żtaires modestes |
36.000 |
79,2 |
Adaptation des logements au handicap |
14.500 |
49,3 |
Aide au d´┐Żveloppement durable |
– |
4,5 |
Autres interventions |
– |
11,1 |
Total |
527,3 |
Cette action regroupe les cr´┐Żdits destin´┐Żs au financement :
– des pr´┐Żts ´┐Ż taux z´┐Żro (PTZ) ´┐Żmis avant le 1er f´┐Żvrier 2005 et financ´┐Żs au moyen de ressources budg´┐Żtaires ;
– ainsi que des moyens accord´┐Żs ´┐Ż la soci´┐Żt´┐Ż de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż (SGFGAS), charg´┐Że de g´┐Żrer pour le compte de l’Etat les dispositifs d’aide ´┐Ż l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż.
En 2007, cette action devrait ´┐Żtre de dot´┐Że de 7,7 millions d’euros d’autorisation d’engagement, en baisse de 47,76 %, et de 14,7 millions d’euros de cr´┐Żdits de paiement, en baisse de 82,65 %, en 2007.
Ces cr´┐Żdits financent les derniers PTZ ´┐Ż ancienne formule ´┐Ż encore en vigueur, les nouveaux pr´┐Żts ´┐Ż taux z´┐Żro ´┐Żtant financ´┐Żs par un cr´┐Żdit d’imp´┐Żt (cf. infra la pr´┐Żsentation des d´┐Żpenses fiscales en faveur du logement). C’est la raison pour laquelle on constate une baisse importante des cr´┐Żdits entre 2006 et 2007.
Rappelons en effet que depuis le 1er f´┐Żvrier 2005, le PTZ, ´┐Żtendu ´┐Ż l’acquisition de logements anciens, est financ´┐Ż par le biais d’une d´┐Żpense fiscale : l’absence d’int´┐Żr´┐Żts per´┐Żus par les ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit est compens´┐Że par un cr´┐Żdit d’imp´┐Żt sur les soci´┐Żt´┐Żs alors qu’elle l’´┐Żtait par des cr´┐Żdits budg´┐Żtaires, pour les pr´┐Żts ´┐Żmis avant cette date. Il en r´┐Żsulte une diminution des besoins budg´┐Żtaires, repr´┐Żsentant une diminution des autorisations d’engagement de 7 millions d’euros entre 2006 et 2007, et une diminution des cr´┐Żdits de paiement de 70 millions d’euros.
Parall´┐Żlement, le cr´┐Żdit d’imp´┐Żt sur les soci´┐Żt´┐Żs aff´┐Żrent au nouveau PTZ augmente fortement entre 2006 et 2007 : de 515 ´┐Ż 770 millions d’euros.
Les autres moyens affect´┐Żs ´┐Ż cette action, soit 4,7 millions d’euros en autorisations d’engagement et cr´┐Żdits de paiement, correspondent aux cr´┐Żdits relatifs ´┐Ż la gestion des dispositifs d’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż : il s’agit des d´┐Żpenses de fonctionnement de la soci´┐Żt´┐Ż de gestion du fonds de garantie ´┐Ż l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż (SGFGAS), charg´┐Że par l’Etat d’assurer la gestion des PTZ, du dispositif de s´┐Żcurisation des pr´┐Żts ´┐Ż l’accession sociale (PAS) et du fonds de garantie ´┐Ż l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż.
Outre les aides de l’ANAH qui permettront le traitement de pr´┐Żs de 35.600 logements indignes, l’Etat consacrera 26 millions d’euros d’autorisations d’engagement, soit une hausse de 30 %, et 23 millions d’euros de cr´┐Żdits de paiement, soit une hausse de 27,78 %, aux interventions d’urgence de lutte contre le saturnisme et l’insalubrit´┐Ż :
– une dotation de 15 millions d’euros d’autorisation d’engagement devrait financer les actions de l’Etat contre l’insalubrit´┐Ż et le ´┐Ż risque plomb ´┐Ż ;
– une dotation de 11 millions d’euros devrait financer les actions de r´┐Żsorption de l’habitat insalubre.
4. L’action ´┐Ż r´┐Żglementation de l’habitat, politique technique et qualit´┐Ż de la construction ´┐Ż
L’action ´┐Ż r´┐Żglementation de l’habitat, politique technique et qualit´┐Ż de la construction ´┐Ż regroupe notamment les moyens d´┐Żdi´┐Żs ´┐Ż la r´┐Żalisation d’´┐Żtudes permettant d’am´┐Żliorer les normes et les proc´┐Żd´┐Żs de construction. Elle devrait ´┐Żtre dot´┐Że de 7,4 millions d’euros en 2007.
Ainsi, cette action enregistre ´┐Żgalement une hausse importante, notamment en vue d’accompagner la mont´┐Że en charge du programme de recherche sur l’´┐Żnergie des b´┐Żtiments (PREBAT).
L’action ´┐Ż soutien ´┐Ż inclut les frais de personnel des agents de la mission ´┐Ż Ville et Logement ´┐Ż ainsi que les frais de fonctionnement de l’administration en charge du logement. Le budget de cette action devrait s’´┐Żlever ´┐Ż 157,65 millions d’euros d’autorisations d'engagement (+,0,49 %) et ´┐Ż 157,67 millions d'euros de cr´┐Żdits de paiement (+ 0,75 %).
88 % des effectifs de la missions seront affect´┐Żs ´┐Ż la mise en œuvre des programmes ´┐Ż aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement ´┐Ż et ´┐Ż d´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż, dont 336 dans les services d’administration centrale (DGUHC et MILOS), et 2380 dans les services d´┐Żconcentr´┐Żs du minist´┐Żre charg´┐Ż de l’´┐Żquipement (DDE et DRE). 12 % des effectifs de la mission participeront ´┐Ż la mise en œuvre des programmes ´┐Ż r´┐Żnovation urbaine ´┐Ż et ´┐Ż ´┐Żquit´┐Ż sociale et territoriale et soutien ´┐Ż.
Comme en 2006, ces emplois feront l’objet en 2007 d’un transfert en gestion vers les programmes du minist´┐Żre charg´┐Ż de l’´┐Żquipement :
– le programme ´┐Ż am´┐Żnagement, urbanisme et ing´┐Żnierie publique ´┐Ż, s’agissant des emplois des services d’administration centrale ;
– le programme ´┐Ż soutien et pilotage des politiques d’´┐Żquipement ´┐Ż, en ce qui concerne les emplois des services d´┐Żconcentr´┐Żs.
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, les d´┐Żpenses fiscales en faveur de la politique du logement sont tr´┐Żs importantes, et concernent notamment les dispositifs d’investissement locatif, l’application d’un taux r´┐Żduit de TVA ´┐Ż certains secteurs (travaux d’am´┐Żlioration des logements, logement social), et aux exon´┐Żrations d’imp´┐Żts consenties en faveur de l’´┐Żpargne logement.
(en millions d’euros)
Estimation |
´┐Żvaluation pour 2006 |
´┐Żvaluation pour 2007 | |
Programme Aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement |
35 |
35 |
33 |
Programme D´┐Żveloppement et am´┐Żlioration offre de logement |
9.693 |
10.793 |
10.575 |
Total |
9.728 |
10.798 |
10.608 |
´┐Żvolution ann´┐Że n / n+1 |
9,5 % |
11 % |
– 1,8 % |
% des d´┐Żpenses en faveur de la politique du logement |
– |
63 % |
64 % |
Ces d´┐Żpenses connaissent une baisse, en raison notamment de la r´┐Żforme de la fiscalit´┐Ż de l’´┐Żpargne-logement (cf. infra).
Les d´┐Żpenses fiscales (3) les plus cons´┐Żquentes sont les suivantes :
a) Pour les travaux d’am´┐Żlioration, de transformation, d’am´┐Żnagement, et d’entretien portant sur les logements achev´┐Żs depuis plus de deux ans
Le co´┐Żt de cette d´┐Żpense fiscale s’´┐Żlevait ´┐Ż 5 milliards d’euros en 2005, et est ´┐Żvalu´┐Ż par le Gouvernement ´┐Ż 5 milliards d’euros ´┐Żgalement, en 2006 et en 2007.
Font ´┐Żgalement l’objet d’une application du taux de TVA ´┐Ż 5,5 % les livraisons ´┐Ż soi-m´┐Żme d’op´┐Żrations de construction de logements sociaux ´┐Ż usage locatif ou destin´┐Żs ´┐Ż la location-accession, les livraisons ´┐Ż soi-m´┐Żme de travaux d’am´┐Żlioration, de transformation, d’am´┐Żnagement et d’entretien de logements sociaux ´┐Ż usage locatif, la vente de logements sociaux neufs ´┐Ż usage locatif ou destin´┐Żs ´┐Ż la location-accession, et les apports des immeubles sociaux neufs aux soci´┐Żt´┐Żs civiles immobili´┐Żres d’accession progressive ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż. Le co´┐Żt de cette d´┐Żpense fiscale s’´┐Żlevait ´┐Ż 750 millions d’euros en 2005, et est estim´┐Ż ´┐Ż 790 millions en 2006 et 840 millions d’euros en 2007.
Dans le cadre de la construction de logements locatifs sociaux, les organismes HLM et les personnes b´┐Żn´┐Żficiaires de pr´┐Żts sp´┐Żcifiques pour la construction de logements sociaux ´┐Ż usage locatif, b´┐Żn´┐Żficient de l’application d’un taux r´┐Żduit de TVA sur les terrains ´┐Ż b´┐Żtir qu’ils ach´┐Żtent : la d´┐Żpense fiscale s’´┐Żlevait ´┐Ż 50 millions d’euros en 2005, et est ´┐Żvalu´┐Że ´┐Ż 50 millions d’euros en 2006 et 50 millions d’euros en 2007.
L'article 96 de la loi de finances pour 1999 a institu´┐Ż un dispositif d'incitation fiscale ´┐Ż la location : le ´┐Ż dispositif Besson ´┐Ż, permettant aux bailleurs sous certaines conditions, notamment de loyers et de ressources du locataire, de b´┐Żn´┐Żficier d'avantages fiscaux.
Pour les logements neufs ou assimil´┐Żs, le propri´┐Żtaire du logement s'engageait ´┐Ż le donner en location nue ´┐Ż titre d'habitation principale, pendant neuf ans, ´┐Ż une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Les loyers et les ressources du locataire ne devaient pas exc´┐Żder des plafonds fix´┐Żs par d´┐Żcret.
Sous ces conditions, le propri´┐Żtaire bailleur b´┐Żn´┐Żficiait d'un r´┐Żgime d'amortissement, en d´┐Żduisant de ses revenus fonciers 8 % du prix du logement les cinq premi´┐Żres ann´┐Żes et 2,5 % les quatre ann´┐Żes suivantes. ´┐Ż l'issue des neuf ans, il avait la possibilit´┐Ż de continuer ´┐Ż amortir ´┐Ż raison de 2,5 % par an pendant six ans si les conditions demeurent respect´┐Żes.
En outre, l'option pour l'amortissement du logement ouvrait la possibilit´┐Ż d'amortir les gros travaux mais ram´┐Żne de 14 % ´┐Ż 6 % le taux de la d´┐Żduction forfaitaire sur les revenus fonciers.
Le dispositif Besson a repr´┐Żsent´┐Ż une d´┐Żpense fiscale de 150 millions d’euros en 2005, cette d´┐Żpense ´┐Żtant ´┐Żvalu´┐Że ´┐Ż 140 millions d’euros en 2006 et 110 millions d’euros en 2007.
Afin d'augmenter l'offre de logements locatifs, l'article 91 de la loi n´┐Ż 2003-590 du 2 juillet 2003, relative ´┐Ż l'urbanisme et ´┐Ż l'habitat, a r´┐Żform´┐Ż le dispositif fiscal en faveur de l'investissement locatif.
Les plafonds de loyers ont ´┐Żt´┐Ż augment´┐Żs et les plafonds de ressources des locataires, supprim´┐Żs, s'agissant des investissements neufs r´┐Żalis´┐Żs ´┐Ż compter du 1er janvier 2003.
Avant d’´┐Żtre r´┐Żform´┐Ż par la loi ´┐Ż ENL ´┐Ż, le dispositif ´┐Ż Robien ´┐Ż pr´┐Żvoyait ´┐Żgalement :
– l'extension du b´┐Żn´┐Żfice de l'amortissement aux acquisitions de logements anciens, ´┐Ż compter du 3 avril 2003, qui ne satisfaisaient pas aux caract´┐Żristiques des logements d´┐Żcents et faisant l'objet d'une r´┐Żhabilitation permettant de rapprocher, apr´┐Żs travaux, leurs caract´┐Żristiques de celles d'un logement neuf ;
– l'extension aux locations d´┐Żl´┐Żgu´┐Żes, pour faciliter les investissements dans les r´┐Żsidences pour les ´┐Żtudiants et les personnes ´┐Żg´┐Żes ;
– et l'adaptation de la r´┐Żglementation en faveur des soci´┐Żt´┐Żs civiles de placement immobilier (SCPI).
Le dispositif ´┐Ż Robien ´┐Ż a permis une v´┐Żritable relance de la construction de logements priv´┐Żs. En effet, le nombre de logements locatifs priv´┐Żs construit est compris entre 60 000 et 70 000 en 2004 et compris entre 45 000 et 55 000 en 2005.
Le dispositif d’amortissement Robien repr´┐Żsente une d´┐Żpense fiscale (hors Robien en zone de revitalisation rurale) de 250 millions d’euros en 2005 – cette d´┐Żpense ´┐Żtant ´┐Żvalu´┐Że par le Gouvernement ´┐Ż 350 millions d’euros en 2006, et 400 millions en 2007.
Le recentrage du dispositif ´┐Ż Robien ´┐Ż et la cr´┐Żation du ´┐Ż Borloo populaire ´┐Ż dans le cadre de la loi ´┐Ż ENL ´┐Ż : une r´┐Żforme rendue n´┐Żcessaire par certaines d´┐Żrives
En d´┐Żpit de ses effets positifs pour la relance de la construction, le dispositif semble avoir connu quelques d´┐Żrives. En effet, dans certaines r´┐Żgions, les constructions r´┐Żalis´┐Żes dans le cadre du ´┐Ż Robien ´┐Ż se sont av´┐Żr´┐Żes inadapt´┐Żes aux besoins locaux. Certains investisseurs ont raisonn´┐Ż en termes de gain fiscal sans s'int´┐Żresser aux caract´┐Żristiques du logement. Ainsi, certains logements ont ´┐Żt´┐Ż construits dans des zones o´┐Ż les besoins en logement ´┐Żtaient satisfaits et certains propri´┐Żtaires ´┐Żprouvent aujourd'hui des difficult´┐Żs ´┐Ż louer leur logement.
En outre, il a paru indispensable de compl´┐Żter le dispositif en vigueur par un m´┐Żcanisme plus cibl´┐Ż sur le logement interm´┐Żdiaire, en assortissant le b´┐Żn´┐Żfice de l'amortissement de contreparties en termes de conditions de ressources du locataire et de plafonnement du loyer.
C’est pourquoi la loi n´┐Ż 2006-872 a pr´┐Żvu le recentrage du dispositif ´┐Ż Robien ´┐Ż :
– l'amortissement est d´┐Żsormais de 6 % du prix d'acquisition du logement pendant les sept premi´┐Żres ann´┐Żes et de 4 % de ce prix les deux ann´┐Żes suivantes ;
– la possibilit´┐Ż d'amortir le bien au-del´┐Ż de neuf ans est donc supprim´┐Że et l'amortissement total est limit´┐Ż ´┐Ż 50 %.
La loi a ´┐Żgalement cr´┐Ż´┐Ż un dispositif ´┐Ż Borloo populaire ´┐Ż reprenant les caract´┐Żristiques de l'amortissement ´┐Ż Robien ´┐Ż, mais avec des possibilit´┐Żs d'amortissement et de d´┐Żduction diff´┐Żrentes, et en assortissant le b´┐Żn´┐Żfice du dispositif de conditions en termes de ressources du locataire.
Les investissements vis´┐Żs concernent :
– des logements acquis neufs ou en l'´┐Żtat futur d'ach´┐Żvement ´┐Ż compter de la date de publication du projet de loi ;
– des logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, ´┐Ż compter du 1er janvier 2006, d'une d´┐Żclaration d'ouverture de chantier ;
– des locaux affect´┐Żs ´┐Ż un usage autre que l'habitation acquis ´┐Ż compter la date de publication de la loi et que le contribuable transforme en logement ;
– des logements v´┐Żtustes acquis ´┐Ż compter du 1er janvier 2006 et qui font l'objet, de la part de l'acqu´┐Żreur, de travaux de r´┐Żhabilitation permettant aux logements d'acqu´┐Żrir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
Les b´┐Żn´┐Żficiaires sont les personnes physiques qui r´┐Żalisent des investissements locatifs directement ou par l'interm´┐Żdiaire de soci´┐Żt´┐Żs non soumises ´┐Ż l'imp´┐Żt sur les soci´┐Żt´┐Żs autres que les soci´┐Żt´┐Żs civiles de placement immobilier ´┐Ż la condition que le porteur de parts s'engage ´┐Ż conserver la totalit´┐Ż des titres jusqu'´┐Ż l'expiration de la dur´┐Że de 9 ans pr´┐Żvue dans ce dispositif.
La d´┐Żduction peut s'´┐Żlever ´┐Ż 6 % les 7 premi´┐Żres ann´┐Żes, et ´┐Ż 4 % les 2 ann´┐Żes suivantes, soit un total de 50 %.
Tant que les conditions de loyers et de ressources du locataire restent remplies, le propri´┐Żtaire peut, par p´┐Żriodes de 3 ans, et pendant une dur´┐Że maximale de 6 ans b´┐Żn´┐Żficier d'une d´┐Żduction de 2,5 % en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement du titulaire du bail.
Ainsi le propri´┐Żtaire peut-il proc´┐Żder ´┐Ż l'amortissement de 65 % de son bien, ce qui n'est pas le cas du nouveau dispositif ´┐Ż Robien ´┐Ż.
Le propri´┐Żtaire qui opte pour le dispositif ´┐Ż Borloo ´┐Ż b´┐Żn´┐Żficie d'une d´┐Żduction de 30 % de ses revenus fonciers.
Le Gouvernement estime que la mise en œuvre du dispositif ´┐Ż Borloo populaire ´┐Ż repr´┐Żsentera une d´┐Żpense fiscale de 10 millions d’euros en 2007.
3. Les d´┐Żpenses fiscales en faveur de l’´┐Żpargne-logement : des d´┐Żpenses en forte baisse en raison de la r´┐Żforme engag´┐Że en 2006
Les int´┐Żr´┐Żts et primes vers´┐Żs dans le cadre de l’´┐Żpargne-logement repr´┐Żsentaient une d´┐Żpense fiscale de 1,55 milliard d’euros en 2005, celle-ci ´┐Żtant ´┐Żvalu´┐Że ´┐Ż 1,5 milliard d’euros en 2006 et 900 millions d’euros en 2007.
Cette baisse de 600 millions d’euros s’explique par la r´┐Żforme du r´┐Żgime fiscal de l’´┐Żpargne-logement : en effet, l’article 7 de la loi n´┐Ż 2005-1719 du 30 d´┐Żcembre 2005 de finances pour 2006 a pr´┐Żvu l’assujettissement ´┐Ż l’imp´┐Żt sur le revenu des nouveaux int´┐Żr´┐Żts g´┐Żn´┐Żr´┐Żs ´┐Ż partir du 1er janvier 2006 sur les plans d’´┐Żpargne-logement (PEL) d´┐Żtenus depuis plus de douze ans (ou arriv´┐Żs ´┐Ż l’´┐Żch´┐Żance de leur contrat, pour les PEL ouverts avant le 1er avril 1992).
Ces d´┐Żductions d’imp´┐Żt ont repr´┐Żsent´┐Ż un co´┐Żt d’1 milliard d’euros en 2005, et le Gouvernement estime que ce co´┐Żt devrait ´┐Żtre identique en 2006 et en 2007.
Ce cr´┐Żdit d’imp´┐Żt voit son co´┐Żt monter en puissance : s’´┐Żlevant ´┐Ż 400 millions d’euros en 2005, il est ´┐Żvalu´┐Ż ´┐Ż 900 millions d’euros en 2006, et 1 milliard d’euros en 2007.
Ce cr´┐Żdit d’imp´┐Żt repr´┐Żsente une d´┐Żpense fiscale de 30 millions d’euros en 2006 et en 2007.
Cette exon´┐Żration a repr´┐Żsent´┐Ż une d´┐Żpense fiscale de 300 millions d’euros en 2005, et devrait repr´┐Żsenter la m´┐Żme d´┐Żpense en 2006 et en 2007.
7. La compensation par l’Etat des exon´┐Żrations de taxe fonci´┐Żre sur les propri´┐Żt´┐Żs b´┐Żties consenties dans le cadre de la construction de logements sociaux
D’une part, l’article 92 de la loi de programmation pour la coh´┐Żsion sociale a port´┐Ż de 15 ´┐Ż 25 ans la dur´┐Że de l’exon´┐Żration de taxe fonci´┐Żre sur les propri´┐Żt´┐Żs b´┐Żties pour les logements locatifs sociaux construits pendant la dur´┐Że du plan de coh´┐Żsion sociale et a pr´┐Żvu la compensation de pertes de recettes r´┐Żsultant de cet allongement pour les collectivit´┐Żs territoriales.
D’autre part, l’article 23 de la loi n´┐Ż 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a pr´┐Żvu une compensation int´┐Żgrale des pertes de recettes r´┐Żsultant de l’exon´┐Żration de taxe fonci´┐Żre, pour les logements PLUS et PLA-I construits dans le cadre du plan de coh´┐Żsion sociale.
En 2007, le remboursement de l’exon´┐Żration de taxe fonci´┐Żre aux collectivit´┐Żs est estim´┐Ż ´┐Ż 125 millions d’euros pour l’Etat. Ce montant augmentera sensiblement au cours des prochaines ann´┐Żes, compte tenu de la derni´┐Żre mesure prise dans le cadre de la loi n´┐Ż 2006-872.
III.— L’ACCESSION SOCIALE ´┐Ż LA PROPRI´┐ŻT´┐Ż : UNE POLITIQUE L´┐ŻGITIME ET EFFICACE
L'accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż est un enjeu important de la politique du logement, et ce, pour plusieurs raisons :
– elle r´┐Żpond aux aspirations d’une majorit´┐Ż de m´┐Żnages ;
– elle favorise le choix des parcours r´┐Żsidentiels et augmente la mobilit´┐Ż dans le parc locatif social ; ´┐Ż ce titre, elle amplifie les effets de la loi de programmation pour la coh´┐Żsion sociale sur l’accroissement de l’offre locative accessible aux m´┐Żnages disposant de ressources modestes ;
– elle contribue au soutien de l'activit´┐Ż et de l'emploi dans le secteur du b´┐Żtiment ;
– enfin, elle permet aux m´┐Żnages de se constituer un patrimoine en vue de leur retraite.
L’engagement d’une op´┐Żration d’accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż n´┐Żcessite n´┐Żanmoins que le m´┐Żnage int´┐Żress´┐Ż puisse mobiliser un capital qui repr´┐Żsente, dans les conditions actuelles du march´┐Ż du logement, en moyenne plus de trois fois et demi son revenu annuel.
En France, pr´┐Żs de 57 % des m´┐Żnages sont propri´┐Żtaires de leur logement et 40 % en sont locataires. Ainsi que l’illustre le tableau ci-dessous, la France se situe dans la moyenne des pays europ´┐Żens, mais fort en de´┐Ż´┐Ż de pays voisins comme le Royaume-Uni (69 %), la Gr´┐Żce (74 %), le Portugal (75 %) ou l’Espagne (81 %).
Propri´┐Żtaires Occupants |
Locataires |
Autres statuts (1) | ||
|
Locatif social |
Locatif priv´┐Ż | ||
ALLEMAGNE |
43 |
6 |
51 |
0 |
AUTRICHE |
58 |
20 |
19 |
3 |
BELGIQUE |
68 |
7 |
23 |
2 |
CHYPRE |
64 |
3 |
18 |
15 |
DANEMARK |
53 |
22 |
26 |
0 |
ESPAGNE |
81 |
1 |
10 |
8 |
ESTONIE |
85 |
3 |
7 |
5 |
FINLANDE |
58 |
16 |
16 |
10 |
FRANCE |
56 |
17 |
21 |
6 |
GRECE |
74 |
0 |
20 |
6 |
HONGRIE |
92 |
5 |
2 |
1 |
IRLANDE |
77 |
7 |
11 |
5 |
ITALIE |
73 |
4 |
17 |
6 |
LETTONIE |
79 |
1 |
20 |
0 |
LITUANIE |
97 |
2 |
1 |
0 |
LUXEMBOURG |
70 |
2 |
25 |
3 |
MALTE |
74 |
6 |
20 |
0 |
PAYS BAS |
54 |
35 |
11 |
0 |
POLOGNE |
58 |
11 |
13 |
18 |
PORTUGAL |
75 |
3 |
18 |
4 |
REP.TCHEQUE |
47 |
17 |
17 |
19 |
ROY. UNI |
69 |
21 |
10 |
0 |
SLOVAQUIE |
85 |
4 |
1 |
10 |
SLOVENIE |
83 |
4 |
3 |
10 |
SUEDE |
39 |
23 |
22 |
15 |
Source : statistiques sur le logement dans l’Union Europ´┐Żenne et rapports des pays
(1) Selon les pays, les autres statuts rel´┐Żvent du secteur social ou du secteur priv´┐Ż, cela int´┐Żgre aussi des logements dont le statut est inconnu. Au Pays Bas, le secteur social int´┐Żgre les appartements en coop´┐Żrative ; en Su´┐Żde et au Danemark et dans les pays de l’Est les appartements coop´┐Żratifs sont class´┐Żs dans les autres statuts. A Chypre, la colonne autres statuts correspond aux logements gratuits des r´┐Żfugi´┐Żs.
Selon les informations fournies ´┐Ż votre rapporteur par le minist´┐Żre de l’emploi, de la coh´┐Żsion sociale et du logement, ´┐Ż court et moyen termes, le nombre de propri´┐Żtaires devrait encore progresser. En effet, l’accession continue de b´┐Żn´┐Żficier du niveau exceptionnellement bas des taux d’int´┐Żr´┐Żt et de l’allongement de la dur´┐Że des pr´┐Żts, ainsi que des r´┐Żformes men´┐Żes r´┐Żcemment, notamment l’extension, depuis le 1er f´┐Żvrier 2005, du pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro (PTZ) ´┐Ż l’acquisition de logements anciens sans condition de travaux (cf. infra).
Les pouvoirs publics disposent de plusieurs instruments permettant de solvabiliser les acc´┐Żdants (A) :
– le pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro (PTZ) ;
– la location-accession ;
– le bail ´┐Ż construction ;
– le pr´┐Żt ´┐Ż l’accession sociale (PAS) ;
– les subventions de l’ANRU ;
– et l’application d’un taux r´┐Żduit de TVA aux op´┐Żrations r´┐Żalis´┐Żes en zone de r´┐Żnovation urbaine.
Le programme gouvernemental des maisons ´┐Ż 100 000 euros conjugue ces dispositifs avec une participation active des collectivit´┐Żs locales (B).
1. Le pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro r´┐Żform´┐Ż : un pr´┐Żt ´┐Żlargi ´┐Ż l’ancien, dont les plafonds ont ´┐Żt´┐Ż relev´┐Żs en zone tendue, et profitant aux m´┐Żnages ´┐Ż revenus moyens et modestes
Le principal instrument de la politique d’accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż est le pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro (PTZ), qui permet d’all´┐Żger les mensualit´┐Żs de ses b´┐Żn´┐Żficiaires. Cr´┐Ż´┐Ż en 1995, sa vocation initiale ´┐Żtait alors non seulement d’aider les m´┐Żnages disposant de ressources modestes ´┐Ż devenir propri´┐Żtaires, mais ´┐Żgalement de relancer la construction de logements neufs dans un march´┐Ż d´┐Żprim´┐Ż. Il ´┐Żtait pour cette raison principalement destin´┐Ż ´┐Ż l’acquisition de logements neufs.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le Gouvernement a d´┐Żcid´┐Ż de relancer le PTZ, en l’´┐Żtendant ´┐Ż l’acquisition de logements anciens sans conditions de travaux. Ce nouveau pr´┐Żt est entr´┐Ż en vigueur le 1er f´┐Żvrier 2005.
Son ouverture ´┐Ż l’ancien permet aux m´┐Żnages d’acqu´┐Żrir un logement en zone urbaine dense, o´┐Ż l’on construit peu de logements neufs. Alors que 26% des anciens PTZ ´┐Żtaient mobilis´┐Żs dans les zones A et B du dispositif d’aide ´┐Ż l’investissement locatif (agglom´┐Żrations de plus de 50 000 habitants et agglom´┐Żrations o´┐Ż le march´┐Ż immobilier est le plus tendu), 47% des nouveaux pr´┐Żts sont ´┐Żmis pour des op´┐Żrations r´┐Żalis´┐Żes dans ces zones en 2005.
Les op´┐Żrations d´┐Żsormais ´┐Żligibles au PTZ sont les op´┐Żrations de construction ou d’acquisition d’un logement neuf, les op´┐Żrations d’acquisition d’un logement existant avec ou sans travaux d’am´┐Żlioration, et les op´┐Żrations de location-accession pour chacun des types d’op´┐Żrations pr´┐Żc´┐Żdents.
S’agissant de la construction ou de l’acquisition d’un logement neuf, le PTZ permet de financer :
– la construction d’une maison individuelle, avec ou sans acquisition du terrain ;
– l’acquisition d’un logement neuf (appartement ou maison) construit ou vendu en l’´┐Żtat futur d’ach´┐Żvement et n’ayant jamais fait l’objet d’une occupation ;
– l’acquisition et l’am´┐Żnagement ´┐Ż usage de logements de locaux non destin´┐Żs ´┐Ż l’habitation ou leur transformation seule qui sont assimil´┐Żs ´┐Ż de la construction neuve.
Cependant, d´┐Żsormais, le PTZ permet ´┐Żgalement de financer l’acquisition d’un logement existant avec ou sans travaux d’am´┐Żlioration, alors que le dispositif ant´┐Żrieur exigeait un montant de travaux d’am´┐Żlioration repr´┐Żsentant plus de 50 % du prix d’acquisition du logement.
Afin de garantir le confort et la s´┐Żcurit´┐Ż des m´┐Żnages acc´┐Żdant ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż, les logements acquis ´┐Ż l’aide du nouveau PTZ doivent respecter des normes de surface et d’habitabilit´┐Ż. Lorsque l’acquisition porte sur un logement achev´┐Ż depuis plus de 20 ans, la conformit´┐Ż du logement ´┐Ż ces normes de surface et d’habitabilit´┐Ż est appr´┐Żci´┐Że au moyen d’un ´┐Żtat des lieux, ´┐Żtabli selon la grille d’analyse en vigueur pour le pr´┐Żt conventionn´┐Ż par un professionnel ind´┐Żpendant de la transaction. Si des travaux d’am´┐Żlioration sont n´┐Żcessaires, l’octroi du pr´┐Żt demeure subordonn´┐Ż ´┐Ż leur r´┐Żalisation dans le cadre de l’op´┐Żration.
Enfin, le PTZ peut servir ´┐Ż financer une acquisition r´┐Żalis´┐Że dans le cadre d’un contrat de location-accession d´┐Żfini par la loi n´┐Ż84-595 du 12 juillet 1984 (cf. infra). Il ne peut toutefois pas financer les op´┐Żrations r´┐Żalis´┐Żes dans le cadre du nouveau dispositif PSLA (pr´┐Żt social de location accession).
Le nouveau PTZ est destin´┐Ż, comme le pr´┐Żc´┐Żdent dispositif, aux personnes physiques qui n’ont pas ´┐Żt´┐Ż propri´┐Żtaires de leur r´┐Żsidence principale au cours des deux ann´┐Żes pr´┐Żc´┐Żdant l’offre de pr´┐Żt. Les ressources de ces personnes doivent ´┐Żtre inf´┐Żrieures ´┐Ż des plafonds qui ont ´┐Żt´┐Ż relev´┐Żs ´┐Ż l’occasion de la r´┐Żforme de f´┐Żvrier 2005 et de celle de f´┐Żvrier 2006.
Les ressources sont examin´┐Żes sur la base de la somme des revenus fiscaux de r´┐Żf´┐Żrence des personnes destin´┐Żes ´┐Ż occuper le logement, en distinguant deux p´┐Żriodes selon la date d’´┐Żmission de l’offre :
– pour les offres ´┐Żmises du 1er janvier au 31 mars : sont prises en compte les ressources de l’avant-derni´┐Żre ann´┐Że pr´┐Żc´┐Żdant celle de l’offre de pr´┐Żt ; cette p´┐Żriode est port´┐Że ´┐Ż trois mois au lieu de deux dans le dispositif ant´┐Żrieur ;
– pour les offres ´┐Żmises du 1er avril au 31 d´┐Żcembre : sont prises en compte les ressources de l’ann´┐Że pr´┐Żc´┐Żdant celle de l’offre de pr´┐Żt.
Ces modalit´┐Żs, d´┐Żj´┐Ż en vigueur dans le cadre de l’ancien dispositif, ont pour but d’attribuer le PTZ sur la base de ressources refl´┐Żtant le plus fid´┐Żlement possible les moyens financiers dont disposent les m´┐Żnages pour acc´┐Żder ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż.
La loi de finances pour 2006 a relev´┐Ż les plafonds de ressources applicables au PTZ, dans les communes o´┐Ż les prix de l’immobilier sont les plus ´┐Żlev´┐Żs (correspondant ´┐Ż la zone A du dispositif d’aide ´┐Ż l’investissement locatif ´┐Ż Robien ´┐Ż). Ainsi, les m´┐Żnages disposant de ressources moyennes peuvent-ils ´┐Żgalement b´┐Żn´┐Żficier d’une aide pour devenir propri´┐Żtaires dans les centres-villes ou les zones urbaines les plus ch´┐Żres.
De fait, les nouveaux plafonds de ressources varient en fonction du nombre de personnes composant le m´┐Żnage acc´┐Żdant ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż, d’une part, et de la zone d’implantation du logement, d’autre part ; ils ont ´┐Żt´┐Ż relev´┐Żs de 3 % en moyenne pour les familles.
Nombre de personnes destin´┐Żes ´┐Ż occuper |
Zone A (4) |
Zone B |
1 personne |
25 000 € |
18 950 € |
2 personnes |
35 000 € |
25 270 € |
3 personnes |
40 000 € |
29 230 € |
4 personnes |
45 500 € |
32 390 € |
5 personnes et plus |
51 900 € |
35 540 € |
D´┐Żcret n´┐Ż 2006-93 du 31 janvier 2006
Des modalit´┐Żs de financement plus favorables pour les m´┐Żnages gr´┐Żce ´┐Ż la r´┐Ż´┐Żvaluation du montant des pr´┐Żts
Pour la premi´┐Żre fois depuis la cr´┐Żation du PTZ en 1995, les montants maximaux de pr´┐Żt ont ´┐Żt´┐Ż relev´┐Żs, de 12 % en moyenne, en 2005. L’augmentation du montant de pr´┐Żt est d’autant plus forte que la taille de famille est importante.
Le montant maximal de l’avance est ´┐Żgal ´┐Ż la moins ´┐Żlev´┐Że des sommes r´┐Żsultant des deux calculs suivants :
– 20 % du co´┐Żt de l’op´┐Żration retenu dans la limite d’un montant maximal en fonction du nombre de personnes destin´┐Żes ´┐Ż occuper le logement, de la localisation de l’op´┐Żration et de la nature du logement (neuf ou ancien) ; ce taux est port´┐Ż ´┐Ż 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines ;
– 50 % du montant du ou des autres pr´┐Żts d’une dur´┐Że sup´┐Żrieure ´┐Ż deux ans concourant au financement de l’op´┐Żration.
Quant aux modalit´┐Żs de remboursement du PTZ, elles d´┐Żpendent du revenu fiscal de r´┐Żf´┐Żrence du m´┐Żnage. Cette modulation des conditions de remboursement de l’aide publique permet d’ajuster la mensualit´┐Ż ´┐Ż la charge des m´┐Żnages en fonction de leurs moyens financiers. Le nouveau PTZ am´┐Żliore encore les conditions de remboursement pour les m´┐Żnages disposant des ressources les plus faibles, ´┐Żligibles ´┐Ż l’une des trois premi´┐Żres tranches du bar´┐Żme.
Un pr´┐Żt financ´┐Ż par l’Etat sous la forme d’un cr´┐Żdit d’imp´┐Żt au profit des ´┐Żtablissements de cr´┐Żdits habilit´┐Żs
Le PTZ est distribu´┐Ż par les ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit habilit´┐Żs ´┐Ż cet effet par convention avec l’Etat. A l’origine, le PTZ ´┐Żtait financ´┐Ż par l’Etat par le biais d’une subvention ´┐Ż ces ´┐Żtablissements, et figurait par cons´┐Żquent dans le volet d´┐Żpenses du projet de loi de finances. Cependant, depuis la r´┐Żforme op´┐Żr´┐Że par la loi de finances pour 2005, le PTZ constitue d´┐Żsormais un cr´┐Żdit d’imp´┐Żt sur les soci´┐Żt´┐Żs accord´┐Ż aux ´┐Żtablissements concern´┐Żs.
L’engagement de la d´┐Żpense n’intervenant qu’au stade de la mise en force des pr´┐Żts, qui peut suivre de plusieurs mois leur date d’´┐Żmission, des autorisations d’engagement sont n´┐Żcessaires jusqu’en 2007 pour couvrir les engagements de subventions dues aux ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit au titre des PTZ ´┐Żmis jusqu’en janvier 2005 inclus. Des dotations en cr´┐Żdits de paiement sont conserv´┐Żes jusqu’en 2007 au moins pour solder les paiements correspondants. Par la suite, l’alimentation du nouveau PTZ par le m´┐Żcanisme de cr´┐Żdit d’imp´┐Żt sur les soci´┐Żt´┐Żs aura pour cons´┐Żquence la suppression de la dotation budg´┐Żtaire.
Les ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit conventionn´┐Żs b´┐Żn´┐Żficient d’un cr´┐Żdit d’imp´┐Żt au titre des avances remboursables sans int´┐Żr´┐Żt vers´┐Żes au cours d’une ann´┐Że. Le montant du cr´┐Żdit d’imp´┐Żt est ´┐Żgal ´┐Ż la somme actualis´┐Że des ´┐Żcarts entre les mensualit´┐Żs dues au titre de l’avance remboursable sans int´┐Żr´┐Żt et les mensualit´┐Żs d’un pr´┐Żt consenti ´┐Ż des conditions normales de taux ´┐Ż la date d’´┐Żmission de l’offre de PTZ.
Le r´┐Żle de gestion et de contr´┐Żle des ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit a ´┐Żt´┐Ż attribu´┐Ż ´┐Ż la SGFAS
Par convention, l’Etat a donn´┐Ż mandat ´┐Ż la Soci´┐Żt´┐Ż de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż (SGFGAS) de recueillir les d´┐Żclarations de PTZ effectu´┐Żes par les banques. Cette derni´┐Żre d´┐Żtermine les ´┐Żl´┐Żments de calcul du montant du cr´┐Żdit d’imp´┐Żt aff´┐Żrent aux pr´┐Żts accord´┐Żs par l’´┐Żtablissement de cr´┐Żdit puis adresse le r´┐Żsultat de ce calcul ´┐Ż cet ´┐Żtablissement en lui fournissant une attestation lui permettant de remplir sa d´┐Żclaration sp´┐Żciale. Elle assure ´┐Żgalement le suivi des cr´┐Żdits d’imp´┐Żt sur les soci´┐Żt´┐Żs octroy´┐Żs aux banques.
Pr´┐Żs de 200 000 nouveaux PTZ ont ´┐Żt´┐Ż ´┐Żmis du 1er f´┐Żvrier 2005 au 31 d´┐Żcembre auxquels s’ajoutent 6134 PTZ ´┐Żmis au cours du mois de janvier 2005 (dans le cadre de l’ancien dispositif), alors qu’en 2004, ´┐Ż peine 80 000 PTZ avaient ´┐Żt´┐Ż ´┐Żmis. Pour les 195 381 nouveaux PTZ d´┐Żclar´┐Żs ´┐Żmis au titre de l’ann´┐Że 2005 en France m´┐Żtropolitaine, le montant pr´┐Żt´┐Ż global s’´┐Żl´┐Żve ´┐Ż 2 979 millions d’euros et le co´┐Żt total d’op´┐Żrations financ´┐Żes ´┐Ż 25 404 millions d’euros.
Le montant moyen de l’op´┐Żration financ´┐Że a progress´┐Ż de 4 % en 2005 et atteint 130 100 euros. Le montant moyen du PTZ est de 15 200 euros.
Par ailleurs, le nombre des op´┐Żrations r´┐Żalis´┐Żes dans le neuf a progress´┐Ż entre 2004 et 2005, passant de 70 800 ´┐Ż 75 217, soit une hausse de plus de 6 %.Le nombre d’op´┐Żrations r´┐Żalis´┐Żes dans l’ancien a progress´┐Ż de 7 750 en 2004 ´┐Ż 125 700 en 2005.
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | |
Individuel neuf |
77 338 |
79 072 |
64 100 |
67 275 |
Collectif neuf |
9 960 |
9 222 |
6 712 |
7 942 |
Individuel Acquisition am´┐Żlioration |
11 935 |
10 282 |
7 274 |
28 388 |
Collectif Acquisition am´┐Żlioration |
688 |
789 |
478 |
7 662 |
Individuel Acquisition seule |
- |
- |
- |
49 759 |
Collectif Acquisition seule |
- |
- |
- |
40 492 |
Neuf |
87 298 |
88 294 |
70 812 |
75 217 |
Acquisition am´┐Żlioration |
12 623 |
11 071 |
7 752 |
36 050 |
Acquisition seule |
- |
- |
- |
90 251 |
Individuel |
89 273 |
89 354 |
71 374 |
145 422 |
Collectif |
10 648 |
10 011 |
7 190 |
56 096 |
TOTAL |
99 921 |
99 365 |
78 564 |
201 518 |
Au total, 62 % des op´┐Żrations actuellement r´┐Żalis´┐Żes ´┐Ż l’aide du nouveau PTZ n’auraient pas pu ´┐Żtre financ´┐Żes avec l’ancien PTZ. Ce pourcentage recouvre les op´┐Żrations d’acquisition sans travaux et les op´┐Żrations d’acquisition avec moins de 50 % de travaux par rapport au prix d’achat du logement.
En outre, gr´┐Żce au nouveau PTZ, les m´┐Żnages disposant de ressources modestes ont ´┐Ż nouveau la possibilit´┐Ż de devenir propri´┐Żtaires dans les zones urbaines denses ou dans les centres-villes, o´┐Ż peu de nouveaux logements sont construits. Alors que 26 % des anciens PTZ ´┐Żtaient mobilis´┐Żs dans les zones A et B du dispositif d’aide ´┐Ż l’investissement locatif (agglom´┐Żrations de plus de 50 000 habitants et agglom´┐Żrations o´┐Ż le march´┐Ż immobilier est le plus tendu), 47 % des nouveaux PTZ sont ´┐Żmis pour des op´┐Żrations r´┐Żalis´┐Żes dans ces zones en 2005.
 (nouveaux PTZ ´┐Żmis ´┐Ż compter du 1er f´┐Żvrier 2005)
(nouveaux PTZ ´┐Żmis ´┐Ż compter du 1er f´┐Żvrier 2005)
D’un point de vue sociologique, on observe que 74% des b´┐Żn´┐Żficiaires de PTZ en 2005 ont un revenu inf´┐Żrieur ´┐Ż 2,5 SMIC, contre 67% en 2004. Ainsi, le nouveau PTZ a facilit´┐Ż l’acc´┐Żs de m´┐Żnages disposant de ressources plus modestes ´┐Ż l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż. Pr´┐Żs de 65% des b´┐Żn´┐Żficiaires sont ouvriers ou employ´┐Żs ; en outre, le pr´┐Żt contribue ´┐Ż la mobilit´┐Ż dans le parc locatif, puisque 83% des acc´┐Żdants avec un PTZ sont d’anciens locataires ; enfin, 71 % des b´┐Żn´┐Żficiaires ont moins de 35 ans.
Le PTZ b´┐Żn´┐Żficie aux m´┐Żnages dont les revenus n’exc´┐Żdent pas, pour 64 % d’entre eux, 2 200 euros par mois. En outre, selon les informations fournies ´┐Ż votre rapporteur par le Gouvernement, plus de 80 % des b´┐Żn´┐Żficiaires sont issus de cat´┐Żgories socioprofessionnelles ´┐Ż revenus modestes et moyens : 26 % d’ouvriers, 32 % d’employ´┐Żs, et 23,7 de professions interm´┐Żdiaires.
Globalement, le bilan de la r´┐Żforme du PTZ est par cons´┐Żquent tr´┐Żs positif: plus de 200 000 m´┐Żnages ont ´┐Żt´┐Ż aid´┐Żs par l’Etat en 2005, et le Gouvernement estime que 250 000 m´┐Żnages pourraient b´┐Żn´┐Żficier d’un PTZ en 2006.
En 2006, le PTZ devrait aider pr´┐Żs de 250 000 m´┐Żnages ´┐Ż acc´┐Żder ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż. Ainsi, en trois ans, le nombre de PTZ distribu´┐Żs aura ´┐Żt´┐Ż multipli´┐Ż par trois : de 80 000 en 2004 ´┐Ż plus de 200 000 en 2005 et pr´┐Żs de 250 000 en 2006.
La distribution du PTZ se poursuivra ´┐Ż un rythme encore sup´┐Żrieur en 2007. En effet, une nouvelle am´┐Żlioration a ´┐Żt´┐Ż apport´┐Że au PTZ par la loi n´┐Ż 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
A l’initiative du pr´┐Żsident de la Commission des affaires ´┐Żconomiques, M. Patrick Ollier, et ce en vertu de l’article 30 de la loi pr´┐Żcit´┐Że, les m´┐Żnages pourront d´┐Żsormais b´┐Żn´┐Żficier d’une majoration de leur PTZ pouvant atteindre 15 000 euros, et ce, ´┐Ż deux conditions :
– qu’ils disposent de ressources inf´┐Żrieures ou ´┐Żgales aux plafonds d’acc´┐Żs au logement locatif social de type ´┐Ż PLUS ´┐Ż (pr´┐Żt locatif ´┐Ż usage social) pour une op´┐Żration portant sur un logement neuf ;
– et que l’op´┐Żration soit financ´┐Że en partie gr´┐Żce ´┐Ż une aide de la part d’une ou plusieurs collectivit´┐Żs ou groupements de collectivit´┐Żs du lieu d’implantation du logement.
Cette disposition s’appliquera aux offres ´┐Żmises ´┐Ż compter du 1er janvier 2007. La conjonction de l’aide de la collectivit´┐Ż et du PTZ major´┐Ż devrait se traduire par une r´┐Żduction tr´┐Żs significative de la mensualit´┐Ż ´┐Ż la charge des m´┐Żnages.
Le montant de la majoration sera d´┐Żclin´┐Ż en fonction de la zone g´┐Żographique d’implantation du logement et de la composition du m´┐Żnage. Il convient, par ailleurs, que l’aide des collectivit´┐Żs repr´┐Żsente un montant minimal. Selon les informations fournies ´┐Ż votre rapporteur, le Gouvernement est actuellement en train de d´┐Żfinir les conditions d’application de la majoration du PTZ, qui seront pr´┐Żcis´┐Żes par d´┐Żcret en Conseil d’Etat.
Cette mesure, applicable ´┐Ż compter du 1er janvier 2007, et qui devrait concerner 20 000 m´┐Żnages chaque ann´┐Że, incitera des locataires du parc social ´┐Ż faire construire ou acqu´┐Żrir un logement neuf. Cela rendra disponibles des logements locatifs sociaux pour d’autres m´┐Żnages. Le co´┐Żt par g´┐Żn´┐Żration de cette mesure est estim´┐Ż ´┐Ż 100 millions d’euros.
L’impact budg´┐Żtaire et fiscal de la r´┐Żforme du financement du nouveau PTZ jusqu’en 2010 : une d´┐Żcroissance rapide des versements de subventions
Les engagements et versements de subvention au titre du PTZ subissent une d´┐Żcroissance rapide et ne sont plus significatifs, ´┐Ż compter de 2007, au regard de la d´┐Żpense fiscale induite par le nouveau dispositif.
L’impact fiscal du cr´┐Żdit d’imp´┐Żt au titre du PTZ est estim´┐Ż ´┐Ż 515 millions d’euros en 2006 et 770 millions d’euros en 2007. Il montera progressivement en puissance pour atteindre un r´┐Żgime de croisi´┐Żre de l’ordre de 1,4 milliard d’euros en 2009.
Le montant moyen de subvention par PTZ (ancien dispositif) mis en force en 2005 est de 6 000 euros pour les op´┐Żrations neuves auxquelles ´┐Żtait essentiellement destin´┐Ż l’ancien dispositif. Pour les nouveaux PTZ, le montant moyen de cr´┐Żdit d’imp´┐Żt atteint respectivement 6 652 euros pour les op´┐Żrations neuves et 5 300 euros pour les op´┐Żrations dans l’ancien. Ce co´┐Żt varie en fonction des tranches de revenus.
Pour les m´┐Żnages disposant des ressources les plus modestes, le PTZ repr´┐Żsente un gain de mensualit´┐Ż de l’ordre de 100 euros.
Le contrat de location-accession a ´┐Żt´┐Ż mis en place par la loi n´┐Ż 84-595 du 12 juillet 1984 d´┐Żfinissant la location accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż immobili´┐Żre et comporte deux phases :
– au cours de la premi´┐Żre phase, dite phase locative, le logement appartient ´┐Ż un op´┐Żrateur auquel le m´┐Żnage verse une redevance qui se divise en une fraction locative et une fraction acquisitive. La fraction locative, assimilable ´┐Ż un loyer, correspond au droit du m´┐Żnage ´┐Ż la jouissance du logement. La fraction acquisitive, assimilable ´┐Ż une ´┐Żpargne, repr´┐Żsente un paiement anticip´┐Ż du prix du logement. La dur´┐Że maximale de la phase locative est fix´┐Że dans le contrat de location-accession, conclu par acte authentique en d´┐Żbut d’op´┐Żration. Pendant la phase locative, le m´┐Żnage a la facult´┐Ż de lever l’option sur son logement, c’est-´┐Ż-dire de s’en porter acqu´┐Żreur ;
– la lev´┐Że d’option marque le d´┐Żbut de la phase d’accession, au cours de laquelle le m´┐Żnage est propri´┐Żtaire du logement et rembourse un emprunt. La fraction acquisitive accumul´┐Że pendant la phase locative s’impute sur le prix de vente, par ailleurs fix´┐Ż dans le contrat de location-accession. Si le m´┐Żnage ne l´┐Żve pas l’option, il ne b´┐Żn´┐Żficie pas d’un droit au maintien dans les lieux mais peut disposer d’une garantie de relogement. La fraction acquisitive accumul´┐Że lui est alors restitu´┐Że.
Cependant, ce dispositif n’a pas suscit´┐Ż l’int´┐Żr´┐Żt des op´┐Żrateurs, d’une part, parce que la location-accession introduisait un m´┐Żcanisme optionnel g´┐Żn´┐Żrateur de co´┐Żts, et d’autre part, parce qu’aucun financement n’´┐Żtait adapt´┐Ż ´┐Ż ce type d’op´┐Żration. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhait´┐Ż r´┐Żnover le m´┐Żcanisme de location-accession, en le dotant d’un instrument financier appropri´┐Ż, sans modifier le contrat juridique de location-accession.
Le pr´┐Żt social de location-accession (PSLA) : un mode de financement adapt´┐Ż au contrat de location-accession
Le m´┐Żcanisme b´┐Żti autour du PSLA s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 12 juillet 1984 (5) d´┐Żfinissant la location accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż immobili´┐Żre. Cette nouvelle forme de location-accession permettra ´┐Ż des m´┐Żnages modestes, susceptibles de rencontrer de fortes difficult´┐Żs d’accession notamment en raison d’un apport personnel insuffisant, de devenir propri´┐Żtaires d’un logement neuf dans des conditions optimales de s´┐Żcurit´┐Ż.
Le pr´┐Żt social de location accession (PSLA) a ´┐Żt´┐Ż institu´┐Ż en 2004. Ce nouveau dispositif permet ´┐Ż un m´┐Żnage de se porter acqu´┐Żreur de son logement, ´┐Ż l’issue d’une phase locative au cours de laquelle il peut mesurer sa capacit´┐Ż de remboursement et constituer un apport personnel. Il repose sur l’attribution d’un pr´┐Żt conventionn´┐Ż d´┐Żdi´┐Ż ´┐Ż ce type d’op´┐Żration et ouvre droit aux m´┐Żmes avantages fiscaux que le pr´┐Żt locatif social (PLS) : taux r´┐Żduit de TVA et exon´┐Żration de taxe fonci´┐Żre sur les propri´┐Żt´┐Żs b´┐Żties (TFPB). Ce dispositif s’applique aux op´┐Żrations de construction ou d’acquisition de logements neufs r´┐Żalis´┐Żes par les promoteurs publics ou priv´┐Żs.
Pour en b´┐Żn´┐Żficier, les op´┐Żrateurs doivent conclure une convention avec l’Etat, par laquelle ils s’engagent ´┐Ż respecter les caract´┐Żristiques sociales d´┐Żfinissant le PSLA. Pour l’ann´┐Że 2006, 10 000 logements peuvent ainsi faire l’objet d’un agr´┐Żment, d´┐Żlivr´┐Ż par le pr´┐Żfet de d´┐Żpartement.
Les conditions d’obtention de la d´┐Żcision d’agr´┐Żment ainsi que les caract´┐Żristiques des PSLA font l’objet d’un d´┐Żcret et d’un arr´┐Żt´┐Ż du 26 mars 2004, modifi´┐Żs par un d´┐Żcret et un arr´┐Żt´┐Ż du 2 d´┐Żcembre 2005.
Le PSLA est accord´┐Ż ´┐Ż la personne morale qui entreprend l’op´┐Żration de location-accession. Il s’agit d’un pr´┐Żt conventionn´┐Ż pouvant financer jusqu’´┐Ż 100% du prix de revient des logements. Les pr´┐Żts compl´┐Żmentaires habituels des pr´┐Żts conventionn´┐Żs, et notamment ceux accord´┐Żs par le 1 % logement, sont mobilisables en compl´┐Żment du PSLA.
La nature conventionn´┐Że du PSLA entra´┐Żne trois cons´┐Żquences. D’une part, le logement est destin´┐Ż ´┐Ż ´┐Żtre occup´┐Ż ´┐Ż titre de r´┐Żsidence principale par le m´┐Żnage pendant toute la dur´┐Że de remboursement et ne peut ´┐Żtre transform´┐Ż en local commercial et professionnel. D’autre part, le locataire-acc´┐Żdant peut, y compris en phase locative, b´┐Żn´┐Żficier de l’aide personnalis´┐Że au logement calcul´┐Że en fonction des bar´┐Żmes accession. Enfin, il peut ´┐Żtre pr´┐Żvu que le PSLA contract´┐Ż par l’op´┐Żrateur soit transf´┐Żr´┐Ż au m´┐Żnage au moment de la lev´┐Że d’option.
Il convient que les financements accord´┐Żs ´┐Ż l’op´┐Żrateur de location-accession soient compatibles avec une exploitation locative des logements. L’op´┐Żrateur peut ainsi, m´┐Żme en cas de non-lev´┐Że d’option, conserver les pr´┐Żts et mettre en location les logements n’ayant pas trouv´┐Ż preneur. Le d´┐Żcret du 26 mars 2004 augmente donc ´┐Ż 30 ans la dur´┐Że maximale des pr´┐Żts conventionn´┐Żs, avec possibilit´┐Ż de la porter ´┐Ż 35 ans. Cette disposition permet en particulier aux op´┐Żrateurs contractant un PSLA de parvenir plus facilement ´┐Ż l’´┐Żquilibre pendant la phase locative. En outre, afin de faciliter le montage financier, le d´┐Żcret assouplit, pour le PSLA accord´┐Ż ´┐Ż l’op´┐Żrateur et uniquement pendant la phase locative, certaines modalit´┐Żs de r´┐Żvision du taux d’int´┐Żr´┐Żt des pr´┐Żts conventionn´┐Żs. Pendant la phase d’accession, les dispositions encadrant la r´┐Żvision du taux redeviennent, en revanche, pleinement applicables afin de garantir une protection optimale des acc´┐Żdants personnes physiques.
Tous les ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit habilit´┐Żs ´┐Ż d´┐Żlivrer des pr´┐Żts conventionn´┐Żs peuvent accorder des PSLA. Les ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit peuvent refinancer les PSLA sur des ressources de march´┐Ż ou aupr´┐Żs de la Caisse des d´┐Żp´┐Żts et consignations sur des ressources issues de la collecte du livret A. L’adjudication de ces fonds, intervenue le 22 mars 2006, a conduit ´┐Ż la distribution d’une enveloppe de 130 millions d’euros.
La loi n´┐Ż 2004-804 du 9 ao´┐Żt 2004 pour le soutien ´┐Ż la consommation et ´┐Ż l’investissement conf´┐Żre au nouveau dispositif deux avantages fiscaux. Ainsi, l’op´┐Żrateur de location-accession b´┐Żn´┐Żficie ainsi d’un taux de TVA ´┐Ż 5,5 % sur le logement et d’une exon´┐Żration de taxe fonci´┐Żre sur les propri´┐Żt´┐Żs b´┐Żties (TFPB) pendant 15 ans.
Ces avantages fiscaux, parce qu’ils sont identiques ´┐Ż ceux octroy´┐Żs aux logements locatifs sociaux, garantissent donc que l’op´┐Żration restera ´┐Żquilibr´┐Że m´┐Żme si le m´┐Żnage ne l´┐Żve pas l’option. Dans ce cas, en effet, l’op´┐Żrateur reste propri´┐Żtaire du logement et conserve le b´┐Żn´┐Żfice du PSLA, les avantages fiscaux lui permettant alors d’affecter le logement ´┐Ż la location sociale.
Si le m´┐Żnage l´┐Żve l’option dans les 5 ans suivant l’ach´┐Żvement des travaux, le transfert de propri´┐Żt´┐Ż est exon´┐Żr´┐Ż de TVA et n’est pas soumis aux droits de mutation. L’avantage de TVA conf´┐Żr´┐Ż ´┐Ż l’op´┐Żrateur se transf´┐Żre donc indirectement au m´┐Żnage, puisque les prix de vente plafonds sont fix´┐Żs en tenant compte du taux de TVA de 5,5 % dont a b´┐Żn´┐Żfici´┐Ż l’op´┐Żrateur ´┐Ż la livraison des logements. L’exon´┐Żration de TFPB continue ´┐Żgalement ´┐Ż s’appliquer, pour la dur´┐Że restant ´┐Ż courir, au m´┐Żnage qui l´┐Żve l’option.
En outre, la loi n´┐Ż 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement assouplit les conditions de r´┐Żalisation des op´┐Żrations de location-accession. En effet, elle pr´┐Żvoit que la lev´┐Że d’option est d´┐Żsormais exon´┐Żr´┐Że de droits de mutation m´┐Żme si elle intervient au-del´┐Ż du d´┐Żlai de 5 ans suivant l’ach´┐Żvement des travaux. Les m´┐Żnages pourront donc, dans les m´┐Żmes conditions financi´┐Żres, lever l’option dans le d´┐Żlai de 5 ans ou au-del´┐Ż de ce d´┐Żlai.
Le PSLA est un pr´┐Żt conventionn´┐Ż. En effet, les caract´┐Żristiques sociales des op´┐Żrations financ´┐Żes ´┐Ż l’aide d’un PSLA font l’objet d’une convention conclue entre l’op´┐Żrateur et l’Etat, avant l’engagement de chaque projet.
A ce titre, il doit respecter les taux d’int´┐Żr´┐Żt plafonds applicables aux pr´┐Żts conventionn´┐Żs.
Le PSLA peut ´┐Żtre refinanc´┐Ż sur des ressources de march´┐Ż ou sur des ressources issues de la collecte du livret A. Le taux d’int´┐Żr´┐Żt du pr´┐Żt refinanc´┐Ż sur des ressources de march´┐Ż sera fix´┐Ż librement dans la limite des taux plafonds autoris´┐Żs. Le taux d’int´┐Żr´┐Żt du pr´┐Żt refinanc´┐Ż sur les ressources issues de la collecte du livret A r´┐Żsulte de la proc´┐Żdure d’adjudication des fonds d’´┐Żpargne. La convention d’adjudication, conclue sous l’´┐Żgide de l’Etat entre la Caisse des d´┐Żp´┐Żts et consignations et l’´┐Żtablissement de cr´┐Żdit, d´┐Żtermine ´┐Żgalement les majorations de taux qui peuvent ´┐Żtre appliqu´┐Żes aux diff´┐Żrents types d’emprunteur.
Les PSLA r´┐Żsultant de l’enveloppe de 130 millions d’euros distribu´┐Że lors de l’adjudication du 22 mars 2006 auront pour les organismes HLM un taux compris entre 3,63% et 3,70%.
Les logements faisant l’objet du dispositif du PSLA sont destin´┐Żs ´┐Ż des m´┐Żnages dont les ressources n’exc´┐Żdent pas les plafonds du PTZ, tels que d´┐Żfinis par le d´┐Żcret du 31 janvier 2005, au moment de la signature du contrat de location-accession ou, le cas ´┐Żch´┐Żant, du contrat pr´┐Żliminaire.
´┐Ż Le plafonnement de la fraction locative de la redevance
Pour les op´┐Żrations financ´┐Żes ´┐Ż l’aide d’un PSLA, la fraction locative de la redevance est plafonn´┐Że. Les plafonds retenus sont d´┐Żfinis en fonction des zones qui caract´┐Żrisent le dispositif d’amortissement fiscal ´┐Ż Robien ´┐Ż (zones A, B, C) et qui refl´┐Żtent les tensions sur les prix de l’immobilier. Les niveaux de loyer correspondent ´┐Ż ceux appliqu´┐Żs au pr´┐Żt locatif social (PLS), major´┐Żs en zone A.
La part acquisitive est fix´┐Że dans le cadre du contrat de location-accession en fonction des capacit´┐Żs financi´┐Żres du locataire-acc´┐Żdant et en accord avec le vendeur.
´┐Ż Le plafonnement du prix
Le prix de vente des logements doit ´┐Żgalement ´┐Żtre inf´┐Żrieur ´┐Ż des plafonds, modul´┐Żs en fonction des zones du dispositif ´┐Ż Robien ´┐Ż. Les plafonds retenus sont ceux des op´┐Żrations d’accession directe r´┐Żalis´┐Żes par les organismes d’habitations ´┐Ż loyer mod´┐Żr´┐Ż. Ils sont n´┐Żanmoins minor´┐Żs de la diff´┐Żrence entre le taux de TVA de 19,6 % appliqu´┐Ż aux op´┐Żrations d’accession classiques et le taux de 5,5 % accord´┐Ż ´┐Ż l’op´┐Żrateur qui contracte un PSLA. Ces plafonds de prix permettent donc aux m´┐Żnages de b´┐Żn´┐Żficier ´┐Żgalement de l’avantage de TVA conf´┐Żr´┐Ż ´┐Ż l’op´┐Żrateur.
Le prix du logement n’est pas r´┐Żvisable et doit ´┐Żtre minor´┐Ż de 1,5 % ´┐Ż chaque date anniversaire du contrat de location-accession. Cette minoration incitera les m´┐Żnages ´┐Ż rester suffisamment longtemps en phase locative, pour bien mesurer leur capacit´┐Ż ´┐Ż faire face ´┐Ż des charges r´┐Żguli´┐Żres de logement, avant d’entrer ou non dans la phase d’accession.
´┐Ż Le plafonnement de mensualit´┐Ż pendant la phase d’accession
La mensualit´┐Ż de remboursement, ´┐Ż la charge du m´┐Żnage en d´┐Żbut de phase d’accession, ne doit pas exc´┐Żder la derni´┐Żre redevance pay´┐Że en phase locative. L’op´┐Żrateur doit disposer, d´┐Żs la signature de la convention avec l’Etat, de l’engagement d’un ´┐Żtablissement de cr´┐Żdit de proposer au m´┐Żnage, au moment de la lev´┐Że d’option, une offre de financement respectant cette condition.
Cette disposition est destin´┐Że ´┐Ż s´┐Żcuriser le locataire-acc´┐Żdant et ´┐Ż lui donner, d´┐Żs la signature du contrat de location-accession, des garanties sur la charge financi´┐Żre qu’il devra supporter en phase d’accession. L’engagement peut prendre la forme d’une convention entre l’op´┐Żrateur et l’´┐Żtablissement de cr´┐Żdit ou d’un engagement unilat´┐Żral de l’´┐Żtablissement de cr´┐Żdit. Le m´┐Żnage n’a cependant pas pour obligation de contracter un emprunt aupr´┐Żs de l’´┐Żtablissement de cr´┐Żdit qui a donn´┐Ż cet engagement au vendeur.
´┐Ż Garanties en phase locative
En cas de non lev´┐Że d’option, le m´┐Żnage peut b´┐Żn´┐Żficier d’une garantie de relogement, lorsque ses ressources n’exc´┐Żdent pas les plafonds d’´┐Żligibilit´┐Ż au PLUS. La garantie consiste pour l’op´┐Żrateur ´┐Ż formuler trois offres de relogement correspondant aux besoins et possibilit´┐Żs de l’occupant, au plus tard dans les six mois suivant la date limite fix´┐Że pour la lev´┐Że d’option.
´┐Ż Garanties en phase d’accession
En cas de lev´┐Że d’option, le m´┐Żnage dispose, pendant une dur´┐Że de 15 ans ´┐Ż compter du transfert de propri´┐Żt´┐Ż, d’une garantie de rachat de son logement ´┐Ż un prix d´┐Żtermin´┐Ż ´┐Ż l’avance et d’une garantie de relogement. Ces garanties sont mises en jeu en cas de survenue, pour le m´┐Żnage, d’un ´┐Żv´┐Żnement exceptionnel ou d’un accident de la vie (divorce, d´┐Żc´┐Żs du co-emprunteur, ch´┐Żmage...), la liste de ces faits g´┐Żn´┐Żrateurs ´┐Żtant d´┐Żfinie par l’arr´┐Żt´┐Ż du 26 mars 2004.
Le prix de rachat garanti est, pendant les 5 ans suivant le transfert de propri´┐Żt´┐Ż, ´┐Żgal au prix au moment de la lev´┐Że d’option. Pendant les 10 ann´┐Żes suivantes, le prix de rachat garanti est minor´┐Ż de 2,5 % par an.
La garantie de relogement consiste pour l’op´┐Żrateur ´┐Ż formuler, dans les six mois suivant la demande de mise en jeu, trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilit´┐Żs du m´┐Żnage. Il convient de noter que la garantie de relogement ne s’applique qu’aux m´┐Żnages dont les revenus au moment de la demande de mise en jeu sont inf´┐Żrieurs aux plafonds d’´┐Żligibilit´┐Ż aux logements financ´┐Żs ´┐Ż l’aide d’un pr´┐Żt locatif ´┐Ż usage social (PLUS).
La proc´┐Żdure d’agr´┐Żment se d´┐Żroule en deux temps. La convention sign´┐Że avec l’Etat avant l’engagement des travaux a pour effet de r´┐Żserver un certain nombre d’agr´┐Żments pour l’op´┐Żrateur. Ces agr´┐Żments doivent ensuite ´┐Żtre confirm´┐Żs dans les 12 mois suivant l’ach´┐Żvement des travaux. Pour ce faire, l’op´┐Żrateur transmet ´┐Ż l’Etat (DDE) les contrats de location-accession sign´┐Żs ainsi que les justificatifs de ressources des locataires-acc´┐Żdants.
La direction d´┐Żpartementale de l’´┐Żquipement (DDE) s’assure du respect des conditions de ressources et de la conformit´┐Ż des contrats de location-accession avec les engagements pris par l’op´┐Żrateur dans la convention sign´┐Że avec l’Etat.
Le repr´┐Żsentant de l’Etat dans le d´┐Żpartement notifie alors ´┐Ż l’op´┐Żrateur la liste des logements b´┐Żn´┐Żficiant ´┐Ż titre d´┐Żfinitif de l’agr´┐Żment PSLA.
Un dispositif qui r´┐Żpond aux besoins de logement du segment de march´┐Ż interm´┐Żdiaire entre le locatif social et les op´┐Żrations classiques d’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż
La mont´┐Że en r´┐Żgime du nouveau dispositif PSLA s’op´┐Żre par la mobilisation des principaux acteurs concern´┐Żs : op´┐Żrateurs, ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit et services de l’Etat. Le dispositif r´┐Żpond aux besoins de logements d’un segment de march´┐Ż entre les op´┐Żrations de logements locatifs sociaux et les op´┐Żrations d’accession directe ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż, sur la base des principes d´┐Żcoulant de la loi n´┐Ż84-595 du 12 juillet 1984 d´┐Żfinissant la location-accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż.
En 2005, les op´┐Żrations de logements PSLA engag´┐Żes ont les caract´┐Żristiques suivantes :
– les op´┐Żrations agr´┐Ż´┐Żes sont en majorit´┐Ż des op´┐Żrations de dimension modeste (moyenne de 8 logements par op´┐Żration) ;
– elles visent ´┐Ż la r´┐Żalisation de constructions individuelles (79%) ;
– elles sont situ´┐Żes majoritairement en zone B et C (la r´┐Żgion Ile de France reste actuellement ´┐Ż l’´┐Żcart) ;
– les types de logement concern´┐Żs sont des grands logements (type III, IV ou V) dont le prix de revient au m´┐Ż est moins ´┐Żlev´┐Ż que celui des petits logements.
Plusieurs mesures intervenues r´┐Żcemment doivent constituer un facteur favorable ´┐Ż l’extension du PSLA :
– le rel´┐Żvement des plafonds de ressources du PSLA au niveau de ceux du PTZ en vigueur en f´┐Żvrier 2005 ;
– la simplification de la proc´┐Żdure d’agr´┐Żment des op´┐Żrations avec une programmation en d´┐Żbut d’ann´┐Że ;
– la signature de la charte de la ´┐Ż maison aujourd’hui, la maison ´┐Ż 100 000 euros ´┐Ż avec les ´┐Żlus et les professionnels.
En effet, des maisons ´┐Ż 100 000 euros pourront ´┐Żtre r´┐Żalis´┐Żes dans le cadre du dispositif de location-accession et b´┐Żn´┐Żficier ainsi des avantages fiscaux qui accompagnent ce m´┐Żcanisme (TVA ´┐Ż 5,5 % et exon´┐Żration de TFPB).
Le dispositif du bail ´┐Ż construction permet aux m´┐Żnages d’acqu´┐Żrir leur logement en deux temps, en diff´┐Żrant l’acquisition du terrain, par rapport ´┐Ż celle du logement, gr´┐Żce un m´┐Żcanisme de dissociation du foncier et du b´┐Żti.
En vertu de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, constitue un bail ´┐Ż construction le bail par lequel le preneur s'engage, ´┐Ż titre principal, ´┐Ż ´┐Żdifier des constructions sur le terrain du bailleur et ´┐Ż les conserver en bon ´┐Żtat d'entretien pendant toute la dur´┐Że du bail. Le deuxi´┐Żme alin´┐Ża de cet article pr´┐Żvoit que le bail ´┐Ż construction est consenti par ceux qui ont le droit d'ali´┐Żner et dans les m´┐Żmes conditions et formes. Enfin le troisi´┐Żme alin´┐Ża de cet article pr´┐Żvoit que le bail est conclu pour une dur´┐Że comprise entre 18 et 99 ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Sur le fondement de ce dispositif, les communes souhaitant mettre en œuvre une politique d'accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż, peuvent conclure avec des m´┐Żnages aux revenus modestes, des baux ´┐Ż construction assortis d'une option d'achat que les m´┐Żnages pourront exercer une fois qu'ils auront rembours´┐Ż l'achat de leur logement. En outre, dans le cadre de ce dispositif, les m´┐Żnages peuvent b´┐Żn´┐Żficier du pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro pour acqu´┐Żrir leur logement.
Ce dispositif a ´┐Żt´┐Ż assoupli dans le cadre de la loi n´┐Ż 2006-872 : d´┐Żsormais les m´┐Żnages primo-acc´┐Żdants auront la possibilit´┐Ż d’acqu´┐Żrir le terrain avant l’arriv´┐Że ´┐Ż ´┐Żch´┐Żance du bail.
Enfin, le ministre de l’Emploi, de la coh´┐Żsion sociale et du logement a annonc´┐Ż que la Caisse des d´┐Żp´┐Żts et consignations et l’Union d’´┐Żconomie sociale pour le logement (1 % logement) allaient mettre en place un dispositif de portage gratuit du foncier pour les habitations destin´┐Żes ´┐Ż l’accession sociale. Selon les informations fournies ´┐Ż votre rapporteur, ce portage se fera sur une dur´┐Że de 20 ´┐Ż 25 ans, et devrait profiter ´┐Ż 10 000 ´┐Ż 20 000 habitations par an.
Le pr´┐Żt ´┐Ż l’accession sociale (PAS) constitue un pr´┐Żt conventionn´┐Ż sp´┐Żcifique, garanti par le Fonds de garantie de l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż, et r´┐Żserv´┐Ż ´┐Ż des m´┐Żnages dont les revenus ne d´┐Żpassent pas des plafonds de ressources (6), d´┐Żfinis en fonction du zonage utilis´┐Ż pour le dispositif ´┐Ż Robien ´┐Ż. Les ressources des demandeurs du PAS s’appr´┐Żcient selon les m´┐Żmes modalit´┐Żs que celles pr´┐Żvues pour le nouveau PTZ.
Le PAS, qui constitue un pr´┐Żt conventionn´┐Ż, pr´┐Żsente l’avantage d’ouvrir droit ´┐Ż l’aide personnalis´┐Że au logement. En outre, en cas de perte d'emploi, il est assorti d'un ´┐Ż filet de s´┐Żcurit´┐Ż ´┐Ż permettant au m´┐Żnage de reporter en fin de pr´┐Żt une partie de ses ´┐Żch´┐Żances
D´┐Żs lors qu’une convention territoriale ANRU le pr´┐Żvoit, l’agence nationale pour la r´┐Żnovation urbaine peut apporter une subvention d’un montant maximum de 10 000 euros par logement en accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż : cette subvention est attribu´┐Że ´┐Ż l’op´┐Żrateur r´┐Żalisant et mettant en vente les logements en accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż.
6. La promotion d’un habitat diversifi´┐Ż dans les quartiers en r´┐Żnovation urbaine : un taux r´┐Żduit de TVA pour les op´┐Żrations d’accession r´┐Żalis´┐Żes en zone urbaine sensible
L’une des dispositions-phares de la loi n´┐Ż 2006-876 portant engagement national pour le logement en mati´┐Żre d’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż consiste en l’application d’un taux r´┐Żduit de TVA sur les op´┐Żrations d’accession r´┐Żalis´┐Żes dans un quartier de r´┐Żnovation urbaine, ou ´┐Ż 500 m´┐Żtres de ces quartiers.
En application de l’article 51 de la loi ´┐Ż ENL ´┐Ż, l’ordonnance n´┐Ż 2006-1048 du 25 ao´┐Żt 2006 relative aux soci´┐Żt´┐Żs anonymes coop´┐Żratives d’int´┐Żr´┐Żt collectif pour l’accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż r´┐Żforme le statut des soci´┐Żt´┐Żs anonymes de cr´┐Żdit immobilier (SACI), recentr´┐Żes sur la r´┐Żalisation de programmes d’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż. L’ancrage local de ces soci´┐Żt´┐Żs devrait ´┐Żgalement ´┐Żtre renforc´┐Ż dans le cadre de cette r´┐Żforme, par une participation obligatoire dans ces soci´┐Żt´┐Żs de collectivit´┐Żs territoriales et d’organismes locaux de logement social.
Les nouvelles soci´┐Żt´┐Żs anonymes coop´┐Żratives d’int´┐Żr´┐Żt collectif pour l’accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż favoriseront donc l’´┐Żmergence de projets locaux d’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż. Une convention sera prochainement sign´┐Że avec ces soci´┐Żt´┐Żs pour pr´┐Żvoir la r´┐Żalisation par celles-ci de 20 000 logements en accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż, dont 15 000 maisons ´┐Ż 100 000 euros au cours des cinq prochaines ann´┐Żes.
B.— LA MAISON ´┐Ż 100 000 EUROS : UN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL AMBITIEUX CONJUGUANT LES DISPOSITIFS D’ACCESSION ET LA PARTICIPATION DES COLLECTIVIT´┐ŻS LOCALES
Le programme de maisons ´┐Ż 100 000 euros a pour principal objectif le d´┐Żveloppement d’une offre de logements en accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż r´┐Żpondant aux besoins et aux capacit´┐Żs financi´┐Żres des m´┐Żnages aux ressources modestes. Il s’appuie sur l’utilisation optimale des dispositifs mis en place par le Gouvernement, pr´┐Żsent´┐Żs ci-dessus, tout en n´┐Żcessitant une mobilisation des collectivit´┐Żs locales.
Le programme vise ´┐Ż construire des maisons de qualit´┐Ż destin´┐Żes ´┐Ż l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż pour un prix de vente maximum de 100 000 euros.
Les maisons doivent r´┐Żpondre aux caract´┐Żristiques d´┐Żfinies par la charte sign´┐Że le 8 d´┐Żcembre 2005 entre les professionnels et les ´┐Żlus. Cette charte, accompagn´┐Że d’un mode d’emploi, a ´┐Żt´┐Ż suivie d’une circulaire ´┐Ż destination des services d´┐Żconcentr´┐Żs de l’Etat.
Ces maisons doivent notamment pr´┐Żsenter une surface habitable d’au moins 85 m´┐Ż, soit 4 pi´┐Żces en g´┐Żn´┐Żral, et r´┐Żpondre ´┐Ż des exigences particuli´┐Żres en mati´┐Żre de qualit´┐Ż environnementale (´┐Żconomie d’´┐Żnergie, label environnemental pour les op´┐Żrations group´┐Żes). Le prix de vente de 100 000 euros correspond ´┐Ż une maison avec son jardin et toutes les charges aff´┐Żrentes : les frais d’hypoth´┐Żque, les frais de notaire, les frais de raccordements (EDF, GDF, t´┐Żl´┐Żphone, assainissement…), les taxes et redevances (TVA, TLE, TDENS..).
Les principales f´┐Żd´┐Żrations professionnelles dans le domaine du logement et du b´┐Żtiment ont adh´┐Żr´┐Ż ´┐Ż la charte. Leurs adh´┐Żrents se sont donc engag´┐Żs ´┐Ż faciliter la r´┐Żalisation des maisons respectant les objectifs de la charte sur l’ensemble du territoire : les organismes HLM ainsi que les soci´┐Żt´┐Żs d’´┐Żconomie mixte peuvent r´┐Żaliser ces op´┐Żrations d’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż. Les promoteurs priv´┐Żs, le cas ´┐Żch´┐Żant, sollicit´┐Żs par les collectivit´┐Żs peuvent ´┐Żgalement construire de telles maisons, seuls ou en partenariats avec un organisme de logement social en mesure d’apporter les garanties de rachat et de relogement pr´┐Żconis´┐Żes par le dispositif.
Trois types de montages financiers sont propos´┐Żs selon la localisation des projets de construction de maisons ´┐Ż 100 000 euros
´┐Ż Le cas des zones ANRU
Dans les zones faisant l’objet d’un projet de r´┐Żnovation urbaine et d’une convention avec l’ANRU, le taux r´┐Żduit de TVA, pr´┐Żvu par la loi ´┐Ż ENl ´┐Ż (cf. infra) pourra se combiner avec les aides apport´┐Żes par l’agence aux op´┐Żrations d’accession.
´┐Ż Les op´┐Żrations r´┐Żalis´┐Żes dans les zones o´┐Ż le march´┐Ż foncier est peu tendu
Dans les zones o´┐Ż le march´┐Ż foncier est peu tendu, il est possible aux op´┐Żrateurs de financer les op´┐Żrations ´┐Ż l’aide d’un PSLA ouvrant droit ´┐Ż une TVA 5,5 %, ´┐Ż une exon´┐Żration de la TFPB pendant 15 ans, et aux garanties de rachat et de relogement (garanties pouvant ´┐Żtre apport´┐Żes par un autre op´┐Żrateur que celui ayant r´┐Żalis´┐Ż la construction).
´┐Ż Un recours privil´┐Żgi´┐Ż au portage foncier dans les zones o´┐Ż le march´┐Ż foncier est tendu
Dans les zones o´┐Ż l’enveloppe de 100 000 euros ne permet pas de financer simultan´┐Żment l’acquisition du terrain et de la construction, une acquisition diff´┐Żr´┐Że du foncier peut ´┐Żtre mise en place, afin que l’effort mensuel des acc´┐Żdants soit ´┐Żquivalent ´┐Ż celui qu’ils produiraient dans une op´┐Żration d’accession directe ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż pour un montant global de 100 000 euros : l’acc´┐Żdant se porte d’abord acqu´┐Żreur du b´┐Żtiment seul, et n’acqui´┐Żre le terrain qu’apr´┐Żs le remboursement de son pr´┐Żt principal.
La commune peut, par exemple, mettre le terrain ´┐Ż la disposition de l’acc´┐Żdant ´┐Ż des conditions favorables, dans le cadre d’un bail ´┐Ż construction, pendant la p´┐Żriode de remboursement du b´┐Żtiment.
Pour faciliter la r´┐Żalisation de ces op´┐Żrations, la Caisse des d´┐Żp´┐Żts et consignations et les partenaires sociaux du 1% Logement vont mettre en place, en lien avec le minist´┐Żre de l’emploi, de la coh´┐Żsion sociale et du logement, un dispositif de portage gratuit du foncier. Ce portage sera fait sur une dur´┐Że de 20 ´┐Ż 25 ans, qui est la dur´┐Że de remboursement du pr´┐Żt qu’aura contract´┐Ż le m´┐Żnage pour l’acquisition du b´┐Żti.
Les acteurs du secteur du logement, que sont les associations d’´┐Żlus, les f´┐Żd´┐Żrations professionnelles, les agences et associations, les op´┐Żrateurs et groupements d’op´┐Żrateurs, et plusieurs collectivit´┐Żs, ont massivement sign´┐Ż la charte de la maison ´┐Ż 100 000 euros.
En termes quantitatifs, le Gouvernement a pour objectif la r´┐Żalisation d’environ 20 000 logements r´┐Żpondant ´┐Ż la charte de la maison ´┐Ż 100 000 euros par ann´┐Że, en r´┐Żgime de croisi´┐Żre.
Lors de sa r´┐Żunion du mardi 7 novembre 2006, la Commission a entendu Mme Catherine Vautrin, ministre d´┐Żl´┐Żgu´┐Że ´┐Ż la coh´┐Żsion sociale et ´┐Ż la parit´┐Ż, sur les cr´┐Żdits de la mission ´┐Ż ville et logement ´┐Ż du projet de loi de finances pour 2007.
Mme Catherine Vautrin, ministre d´┐Żl´┐Żgu´┐Że ´┐Ż la coh´┐Żsion sociale et ´┐Ż la parit´┐Ż, s’est d´┐Żclar´┐Że heureuse de retrouver une commission dont elle fut membre et a pr´┐Żsent´┐Ż les excuses de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, de la coh´┐Żsion sociale et du logement, retenu par la r´┐Żunion des pr´┐Żfets pr´┐Żsid´┐Że par le Premier ministre.
Un an apr´┐Żs les ´┐Żv´┐Żnements de novembre 2005, la partie ´┐Ż ville ´┐Ż de cette mission t´┐Żmoigne que toutes les mesures prises la suite de ces ´┐Żv´┐Żnements ont ´┐Żt´┐Ż mises en œuvre ou le seront tr´┐Żs prochainement. L’objectif ´┐Żtait d’amplifier un programme de r´┐Żformes de grande ampleur lanc´┐Ż d´┐Żs 2003 avec la loi de programmation pour la r´┐Żnovation urbaine puis, en 2004, avec le plan de coh´┐Żsion sociale, et qui s’est poursuivi avec les mesures prises lors du comit´┐Ż interminist´┐Żriel pour la ville du 9 mars, et dans le cadre de la loi n´┐Ż 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’´┐Żgalit´┐Ż des chances.
Plus de moyens et, au-del´┐Ż, plus d’efficacit´┐Ż dans l’allocation de ces moyens : telle est la logique suivie dans le PLF 2007 qui se caract´┐Żrise par des moyens sans pr´┐Żc´┐Żdent et qui continuent d’augmenter, tant sur le volet urbain que sur le volet humain de la politique de la ville, et par la poursuite de la refondation des outils de cette politique afin d’assurer tout ´┐Ż la fois plus de coordination, plus de proximit´┐Ż et plus de s´┐Żcurit´┐Ż dans les financements.
La mobilisation de moyens exceptionnels se poursuit. Le projet de budget 2007, ´┐Ż tous ´┐Żgards historique, confirme l’effort significatif de 2006 avec 1,15 milliard d’euros en autorisations d’engagement et 1,18 milliard en cr´┐Żdits de paiement, soit une progression de 15 % par rapport ´┐Ż l’exercice pr´┐Żc´┐Żdent.
Deux priorit´┐Żs sont mises en avant. Premi´┐Żrement, l’acc´┐Żl´┐Żration de la r´┐Żalisation du programme national de r´┐Żnovation urbaine, qui d’ores et d´┐Żj´┐Ż rencontre un grand succ´┐Żs : 201 projets portant sur 355 quartiers o´┐Ż vivent 2,2 millions de personnes ont ´┐Żt´┐Ż valid´┐Żs par l’Agence nationale de r´┐Żnovation urbaine (ANRU), ce qui repr´┐Żsente plus de 23 milliards d’euros de travaux, dont 7,2 pris en charge par l’ANRU. Celle-ci verra ses moyens d’engagement augmenter de 30 % en 2007 ; les moyens de paiement apport´┐Żs par l’´┐Żtat ´┐Ż l’ANRU augmenteront de 122 % entre 2006 et 2007 (de 250 millions d’euros ´┐Ż 556 millions d’euros) afin de faire face au succ´┐Żs du PNRU, d´┐Żsormais entr´┐Ż dans sa phase op´┐Żrationnelle.
Deuxi´┐Żme priorit´┐Ż, la consolidation des moyens allou´┐Żs ´┐Ż l’insertion sociale et professionnelle des habitants. Les moyens exceptionnels obtenus en loi de finances initiale pour 2006 atteignent un niveau in´┐Żgal´┐Ż : pr´┐Żs de 795 millions d’euros pour le programme ´┐Ż ´┐Żquit´┐Ż sociale et territoriale et soutien ´┐Ż, dont 190,9 millions d’euros pour le Fonds d’intervention pour la ville (FIV), reconduit ´┐Ż hauteur de 2006 et qui permet de financer des actions de proximit´┐Ż, notamment associatives, dans les quartiers, 93 millions d’euros, contre 83 en 2006, pour les postes d’adultes relais, 112 millions d’euros contre 99 pour soutenir la cr´┐Żation d’´┐Żquipes de r´┐Żussite ´┐Żducative, avec un objectif de 500 projets en 2007, contre 380 en 2006 ; d’ores et d´┐Żj´┐Ż, 80 000 enfants b´┐Żn´┐Żficient de ce programme.
Enfin, 333 millions d’euros correspondent aux exon´┐Żrations sociales en zones franches urbaines. Ce chiffre est inf´┐Żrieur au montant pr´┐Żvu en 2006 (359 millions d’euros), qui s’est av´┐Żr´┐Ż sup´┐Żrieur aux besoins r´┐Żels (290 millions d’euros).
Au-del´┐Ż de ces moyens, la plupart des minist´┐Żres concourent ´┐Ż la politique de la ville. L’effort total de l’´┐Żtat est ainsi estim´┐Ż pour 2007 ´┐Ż 3,7 milliards d’euros.
Ces moyens seront mis en œuvre dans un cadre totalement r´┐Żnov´┐Ż. L’ann´┐Że 2007 sera marqu´┐Że par l’entr´┐Że en vigueur des nouveaux contrats urbains de coh´┐Żsion sociale (CUCS), qui succ´┐Żderont aux contrats de ville, comme cadre de partenariat entre l’´┐Żtat et des collectivit´┐Żs territoriales en faveur de la politique de la ville.
Pr´┐Żs de 400 millions d’euros seront mis en œuvre, chaque ann´┐Że, sur trois ans, ´┐Ż travers ces contrats – ´┐Ż comparer aux 130 millions d’euros contractualis´┐Żs annuellement sur la p´┐Żriode 2000-2006.
Les CUCS reposent sur quatre principes :
1. un cadre contractuel unique pour l’ensemble des interventions en faveur des quartiers et une coh´┐Żrence globale des actions men´┐Żes ´┐Ż l’´┐Żchelle de l’agglom´┐Żration ;
2. des priorit´┐Żs d’intervention qui s’articulent pour l’´┐Żtat autour de cinq champs prioritaires : acc´┐Żs ´┐Ż l’emploi et d´┐Żveloppement ´┐Żconomique, am´┐Żlioration du cadre de vie, r´┐Żussite ´┐Żducative, pr´┐Żvention de la d´┐Żlinquance et citoyennet´┐Ż, sant´┐Ż ;
3. une visibilit´┐Ż accrue des financements pour les acteurs locaux, en particulier les associations, avec la possibilit´┐Ż de contractualiser sur trois ans et de b´┐Żn´┐Żficier d’une p´┐Żrennisation des moyens sur la dur´┐Że du contrat ;
4. enfin, une ´┐Żvaluation tout ´┐Ż la fois syst´┐Żmatique et mieux organis´┐Że, par le biais d’un bilan annuel des actions afin de s’assurer de l’op´┐Żrationnalit´┐Ż des actions et de permettre aux acteurs de les r´┐Żorienter si n´┐Żcessaire. Un pourcentage des financements sera r´┐Żserv´┐Ż ´┐Ż l’´┐Żvaluation et des objectifs et des indicateurs de suivi et d’´┐Żvaluation d´┐Żfinis pour chaque priorit´┐Ż.
Les financements de ces contrats seront apport´┐Żs par la nouvelle Agence nationale pour la coh´┐Żsion sociale et l’´┐Żgalit´┐Ż des chances (ANCSEC), qui sera l’op´┐Żrateur de l’´┐Żtat sur le volet ´┐Ż humain ´┐Ż de la politique de la ville. Ce nouvel op´┐Żrateur permettra de poursuivre la simplification engag´┐Że dans l’attribution des financements de la politique de la ville au b´┐Żn´┐Żfice des acteurs associatifs.
Cette ann´┐Że, les cr´┐Żdits ont ´┐Żt´┐Ż d´┐Żl´┐Żgu´┐Żs exceptionnellement t´┐Żt et en une seule fois. Jamais les cr´┐Żdits de la politique de la ville n’´┐Żtaient arriv´┐Żs aussi massivement et aussi rapidement dans les d´┐Żpartements, ce qui a permis d’acc´┐Żl´┐Żrer le versement des subventions. L’objectif est de faire encore mieux en 2007 avec l’Agence qui permettra non seulement de d´┐Żl´┐Żguer encore plus rapidement les cr´┐Żdits, mais surtout de s´┐Żcuriser les financements associatifs dans le cadre de conventions de financement pluriannuelles. Assur´┐Żes d’une visibilit´┐Ż de trois ans pour r´┐Żaliser leurs actions, les associations pourront consacrer l’essentiel de leur temps au cœur de leur mission et non pas ´┐Ż la recherche de financements.
Pour la premi´┐Żre fois, le budget de la politique de la ville pr´┐Żsente les conditions d’une intervention ´┐Ż la fois massive et ´┐Żquilibr´┐Że sur le volet humain et urbain avec des masses budg´┐Żtaires comparables sur l’investissement et les cr´┐Żdits d’intervention.
Des r´┐Żsultats tout aussi historiques ont ´┐Żt´┐Ż obtenus dans le domaine du logement, avec un rythme de production annuel de 430 000 logements, jamais atteint depuis 1980, un rythme de financement de 93 000 logements sociaux, une mobilisation accrue du parc priv´┐Ż et un triplement de l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż avec pr´┐Żs de 250 000 pr´┐Żts ´┐Ż taux z´┐Żro distribu´┐Żs.
Avec la loi portant engagement national pour le logement, le Gouvernement met en œuvre de nouveaux outils pour mieux r´┐Żpondre ´┐Ż la demande de logement de l’ensemble de nos concitoyens. Le projet de budget pour 2007 permet de poursuivre dans cette voie et de lancer encore davantage d’op´┐Żrations, ce qui se traduit par une augmentation de la dotation en autorisations d’engagement du programme ´┐Ż D´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż.
En mati´┐Żre d’aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement, une revalorisation de 1,8 % des aides personnelles au logement sera pratiqu´┐Że ´┐Ż compter du 1er janvier 2007, pour les loyers et pour les charges. La politique en mati´┐Żre d’aides personnelles au logement est compl´┐Żt´┐Że par une politique de mod´┐Żration des loyers qui s’est traduite par l’entr´┐Że en vigueur du nouvel indice de r´┐Żf´┐Żrence des loyers depuis le 1er janvier 2006.
Hors impact du pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro, les autorisations d’engagement du programme ´┐Ż D´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż progressent de 3,7 %, ce qui permettra de lancer davantage d’op´┐Żrations en 2007 qu’en 2006, traduisant une mont´┐Że en puissance conforme aux engagements du plan de coh´┐Żsion sociale. 481 millions d’euros d’autorisations d’engagement seront consacr´┐Żs au parc social en 2007, l’objectif ´┐Żtant de r´┐Żaliser 100 000 logements locatifs sociaux.
Les moyens d’engagement de l’Agence nationale pour l’am´┐Żlioration de l’habitat (ANAH) progresseront de 4,4 %. La dotation budg´┐Żtaire destin´┐Że aux interventions de l’ANAH passera de 480 millions d’euros d’autorisations d’engagement en 2006 ´┐Ż 507,3 millions d’euros en 2007. La dotation d’intervention est compl´┐Żt´┐Że par l’affectation de 20 millions d’euros de taxe sur les logements vacants en 2007, portant ses moyens d’intervention ´┐Ż un niveau jamais atteint auparavant : 527,3 millions d’euros, contre 505 millions d’euros en 2006. L’ANAH pourra ainsi subventionner des travaux dans 37 500 logements priv´┐Żs ´┐Ż loyers ma´┐Żtris´┐Żs en 2007 et remettre sur le march´┐Ż locatif 18 000 logements vacants. ´┐Ż noter que l’Agence consacrera un cinqui´┐Żme de son budget ´┐Ż la lutte contre l’habitat indigne et au traitement des copropri´┐Żt´┐Żs d´┐Żgrad´┐Żes, soit 105 millions d’euros en 2007.
Pour accompagner la mise en œuvre des sch´┐Żmas d´┐Żpartementaux d’accueil des gens du voyage, les moyens destin´┐Żs ´┐Ż la production d’aires d’accueil des gens du voyage progresseront de 33 %, et seront port´┐Żs, en autorisations d’engagement, de 30 millions d’euros en 2006 ´┐Ż 40 millions d’euros en 2007. Ainsi, 3 500 places nouvelles pourront ´┐Żtre cr´┐Ż´┐Żes en 2007, contre 2 400 en 2006.
Les moyens sp´┐Żcifiques d’engagement destin´┐Żs ´┐Ż la lutte contre l’habitat indigne passeront de 20 millions d’euros en 2006 ´┐Ż 26 millions d’euros en 2007, soit une augmentation de 30 %. 9 700 logements feront l’objet de diagnostics et de contr´┐Żles en mati´┐Żre de saturnisme et d’insalubrit´┐Ż et 500 logements donneront lieu ´┐Ż des travaux d’office par l’´┐Żtat.
Dans le domaine de l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż, les besoins budg´┐Żtaires subissent une diminution m´┐Żcanique du fait de l’extinction de l’ancien pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro ; en revanche, les moyens destin´┐Żs aux pr´┐Żts ´┐Ż taux z´┐Żro ´┐Żmis depuis le 1er f´┐Żvrier 2005 et financ´┐Żs par un cr´┐Żdit d’imp´┐Żt sur les soci´┐Żt´┐Żs sont en forte progression, passant de 515 millions d’euros en 2006 ´┐Ż 770 millions d’euros en 2007.
En outre, l’application, pr´┐Żvue par la loi ´┐Ż engagement national pour le logement ´┐Ż, du taux de TVA de 5,5 % pour les op´┐Żrations en accession sociale dans les quartiers en r´┐Żnovation urbaine repr´┐Żsente un impact fiscal de 300 millions d’euros en 2007 et de 100 millions d’euros en 2006.
La dotation en cr´┐Żdits de paiement du programme ´┐Ż D´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż s’´┐Żtablit ´┐Ż 1 058,1 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2007. Cette dotation tient compte d’une baisse m´┐Żcanique de 70 millions d’euros des besoins en cr´┐Żdits de paiement li´┐Żs ´┐Ż l’ancien pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro ; en outre, les organismes de logement social ont b´┐Żn´┐Żfici´┐Ż en 2006 de 220 millions d’euros de ressources extra-budg´┐Żtaires qui ont permis d’am´┐Żliorer tr´┐Żs significativement leur situation de tr´┐Żsorerie. Ces 220 millions d’euros, avanc´┐Żs par la Caisse des d´┐Żp´┐Żts et consignations, ont ´┐Żt´┐Ż rembours´┐Żs par les SACI.
Avec ces 220 millions d’euros et les moyens pr´┐Żvus dans le PLF 2007, les organismes de logement social de m´┐Żtropole auront dispos´┐Ż de 1 678 millions d’euros entre 2005 et 2007, en avance de 9 millions d’euros sur les dotations pr´┐Żvues par la loi de programmation pour la coh´┐Żsion sociale.
Les aides personnelles au logement ont ´┐Żt´┐Ż quant ´┐Ż elles revaloris´┐Żes de 1,8 % pour les loyers en septembre 2005. Une nouvelle actualisation ´┐Ż hauteur de 1,8 % interviendra le 1er janvier 2007, pour les loyers et pour les charges. La revalorisation des aides co´┐Żncidera ainsi avec le calendrier budg´┐Żtaire, alors que l’actualisation traditionnellement op´┐Żr´┐Że au 1er juillet avait un impact budg´┐Żtaire ´┐Ż la fois sur l’ann´┐Że en cours et sur l’ann´┐Że suivante, ce qui compliquait le processus d’arbitrage, retardait la publication des bar´┐Żmes et entra´┐Żnait des modifications d’aide en cours d’ann´┐Że et des remises d’indus de prestations. L’actualisation au 1er janvier, mesure simple et efficace, ´┐Żvitera ces inconv´┐Żnients et am´┐Żliorera la lisibilit´┐Ż des aides pour les b´┐Żn´┐Żficiaires en garantissant que les bar´┐Żmes seront bien pr´┐Żts pour le d´┐Żbut de l’ann´┐Że.
5 107 millions d’euros avaient ´┐Żt´┐Ż inscrits en loi de finances pour 2006 pour le paiement des aides personnelles au logement. La dotation de l’´┐Żtat au paiement des aides personnelles au logement est vers´┐Że au Fonds national d’aide au logement (FNAL), ´┐Żgalement aliment´┐Ż par le budget des prestations familiales et par des cotisations des employeurs.
Plusieurs facteurs expliquent la baisse de la dotation de l’´┐Żtat au FNAL entre 2006 et 2007 : L’am´┐Żlioration de la situation ´┐Żconomique, notamment la baisse du ch´┐Żmage, permettra de limiter les besoins tendanciels en aides personnelles au logement en 2007 ; l’effet en est estim´┐Ż ´┐Ż environ 60 millions d’euros. De leur c´┐Żt´┐Ż, les cotisations au FNAL en provenance des employeurs sont en augmentation de 70 millions d’euros ´┐Ż p´┐Żrim´┐Żtre constant, ce qui minore d’autant le besoin en financement d’´┐Żtat. Par ailleurs, la dotation budg´┐Żtaire de l’´┐Żtat au financement des aides personnelles au logement en 2007 est minor´┐Że par l’apport de 150 millions d’euros r´┐Żsultant de la r´┐Żforme des SACI, ainsi que le pr´┐Żvoit l’ordonnance du 25 ao´┐Żt 2006. Enfin, l’augmentation du SMIC permet aux m´┐Żnages disposant de ressources modestes, dont beaucoup sont b´┐Żn´┐Żficiaires des aides personnelles au logement, de voir leurs revenus progresser plus vite que l’inflation, ce qui limite d’autant le besoin en aides personnelles ; cet effet est ´┐Żvalu´┐Ż ´┐Ż 20 millions d’euros.
Les revalorisations des aides personnelles au logement accompagnent un changement profond dans le mode de r´┐Żvision des loyers, jusqu’alors r´┐Żvis´┐Żs sur la base de l’indice du co´┐Żt de la construction (ICC), soumis ´┐Ż des fluctuations importantes et sans rapport avec la location de logements, li´┐Żes notamment ´┐Ż l’augmentation des prix internationaux des mati´┐Żres premi´┐Żres. Depuis le 1er janvier 2006, les loyers sont r´┐Żvis´┐Żs sur la base d’un nouvel indice dont les ´┐Żvolutions sont plus liss´┐Żes que celles de l’ICC et qui tient mieux compte de la capacit´┐Ż financi´┐Żre des locataires.
Dans ce domaine comme dans les autres, la volont´┐Ż du Gouvernement aura ´┐Żt´┐Ż d’ajuster au mieux, dans un souci de proximit´┐Ż, l’ensemble des dispositifs avec un accompagnement financier permettant la poursuite du plan de coh´┐Żsion sociale et la d´┐Żclinaison de l’ensemble des dispositifs adopt´┐Żs par l’Assembl´┐Że dans le cadre de la loi sur l’´┐Żgalit´┐Ż des chances, en mars dernier.
M. Philippe Pemezec, rapporteur pour avis sur les cr´┐Żdits des programmes ´┐Ż R´┐Żnovation urbaine ; ´┐Żquit´┐Ż sociale et territoriale et soutien ´┐Ż, a f´┐Żlicit´┐Ż la ministre pour sa pr´┐Żsentation d´┐Żtaill´┐Że du budget de la mission ´┐Ż Ville et logement ´┐Ż, marqu´┐Ż, en ce qui concerne la politique de la ville, par une progression des autorisations d’engagement de plus de 200 millions d’euros pour le programme ´┐Ż r´┐Żnovation urbaine ´┐Ż mais ´┐Żgalement s’agissant du programme ´┐Ż ´┐Żquit´┐Ż sociale et territoriale et soutien ´┐Ż, par la cr´┐Żation de l’ANCSEC, dont il a souhait´┐Ż conna´┐Żtre les avantages qu’elle apportera aux collectivit´┐Żs locales.
Les visites sur site du rapporteur ont permis de constater que les ´┐Żlus concern´┐Żs ´┐Żtaient globalement tr´┐Żs satisfaits : la r´┐Żnovation urbaine permet une requalification des quartiers et l’ANRU marque un v´┐Żritable changement de culture sur le terrain. Cette structure, qui sert de guichet unique, a su rester l´┐Żg´┐Żre et les subventions ont un effet de levier non n´┐Żgligeable.
Toutefois, plusieurs interlocuteurs visit´┐Żs se sont avou´┐Żs g´┐Żn´┐Żs de devoir reconstruire exactement le m´┐Żme type de logements, et souvent dans le m´┐Żme p´┐Żrim´┐Żtre, au d´┐Żtriment de la diversit´┐Ż et de la mixit´┐Ż souhait´┐Żes. Il serait opportun de faire du ´┐Ż un pour un ´┐Ż dans un p´┐Żrim´┐Żtre plus large et d’introduire, au passage, de l’accession sociale ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż.
Certains maires regrettent les retards de paiements, dont il serait bon de conna´┐Żtre les raisons.
S’agissant de l’ANRU, on peut craindre que l’augmentation du nombre de dossiers ne se poursuive au point de provoquer un embouteillage et une suradministration de l’agence qui doit rester une structure l´┐Żg´┐Żre.
Enfin, on pourrait envisager de simplifier les contr´┐Żles de l’ANRU en cr´┐Żant un seul contr´┐Żle a posteriori au lieu de l’actuel double contr´┐Żle de la DDE et de l’agence, et en choisissant quelques sites au hasard au lieu de proc´┐Żder syst´┐Żmatiquement ´┐Ż une double instruction.
M. Jean-Pierre Abelin, rapporteur pour avis pour les cr´┐Żdits des programmes ´┐Ż Aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement ; d´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż, a ´┐Żgalement remerci´┐Ż la ministre d’avoir r´┐Żpondu par avance ´┐Ż plusieurs de ses questions, en notant que ce projet de budget s’inscrivait dans une totale coh´┐Żrence avec les lois de programmation pr´┐Żc´┐Żdemment adopt´┐Żes. L’ann´┐Że 2006 doit ´┐Żtre consid´┐Żr´┐Że comme un bon cru pour le logement, tant au niveau de l’activit´┐Ż l´┐Żgislative et r´┐Żglementaire qu’´┐Ż celui de l’action sur le terrain o´┐Ż la mobilisation aura permis d’atteindre des records de production inconnus depuis vingt-cinq ans, et qui plus est sur tous les segments de march´┐Ż : 440 000 mises en chantier sur l’ann´┐Że, 550 000 d´┐Żp´┐Żts de permis de construire, autant d’´┐Żl´┐Żments qui d´┐Żmontrent ´┐Ż quel point l’activit´┐Ż a ´┐Żt´┐Ż soutenue, ce qui a dynamis´┐Ż d’autant le d´┐Żveloppement ´┐Żconomique et la cr´┐Żation d’emplois.
Pour 2007, le budget s’´┐Żl´┐Żvera ´┐Ż 6,15 milliards d’euros en autorisations d’engagement, en baisse de 2,53 % par rapport ´┐Ż 2006, et ´┐Ż 5,98 milliards d’euros, en baisse de 5,49 % par rapport ´┐Ż 2006. Les raisons de ces baisses ont ´┐Żt´┐Ż pour partie expliqu´┐Żes plus haut. Cela dit, plusieurs questions demeurent.
Tout en admettant les raisons de la baisse de la dotation de l’´┐Żtat au paiement des aides ´┐Ż la personne, le rapporteur s’est demand´┐Ż si l’on n’aurait pas d´┐Ż profiter de cette opportunit´┐Ż pour r´┐Żgler le lancinant probl´┐Żme des allocataires de l’APL situ´┐Żs en dessous du seuil de 24 euros. Il a ´┐Żgalement souhait´┐Ż des pr´┐Żcisions sur la fa´┐Żon dont se r´┐Żpartissaient les 93 000 logements sociaux construits en 2006 et observ´┐Ż que les chiffres de l’Union sociale pour l’habitat (USH) ´┐Żtaient un peu diff´┐Żrents.
Le rapporteur a ensuite pos´┐Ż la question, plus large, de l’avenir du livret A, au cœur m´┐Żme du financement du logement social, et de la r´┐Żponse que fera la Commission au rapport pr´┐Żsent´┐Ż par le Gouvernement. Il s’est ´┐Żgalement enquis de l’affectation de cessions de terrains de l’´┐Żtat en faveur de la r´┐Żalisation de logements sociaux, d´┐Żj´┐Ż ´┐Żvoqu´┐Że lors de l’examen du projet ENL, en particulier dans la r´┐Żgion parisienne qui reste la moins concern´┐Że par l’augmentation de la production : la Bretagne a construit en 2005 autant de logements que l’´┐Żle-de-France qui compte pourtant quatre fois plus d’habitants.
Un nouveau dispositif de garantie des revenus locatifs avait ´┐Żt´┐Ż annonc´┐Ż par le ministre. Le rapporteur a souhait´┐Ż conna´┐Żtre les publics vis´┐Żs et demand´┐Ż si le calendrier, qui pr´┐Żvoyait une entr´┐Że en vigueur d´┐Żs le d´┐Żbut de l’ann´┐Że prochaine, ´┐Żtait maintenu.
Certaines professions du b´┐Żtiment ont critiqu´┐Ż le manque de lisibilit´┐Ż du d´┐Żcret du 11 ao´┐Żt dernier relatif aux op´┐Żrations ´┐Żligibles au taux r´┐Żduit de TVA, porteur, selon eux, d’ins´┐Żcurit´┐Ż juridique : certains artisans, qui se demandent toujours si certaines d´┐Żpenses rel´┐Żvent du taux r´┐Żduit ou non, attendent des ´┐Żclaircissements.
S’exprimant au nom du groupe socialiste, M. Jean-Yves Le Bouillonnec a observ´┐Ż qu’il ´┐Żtait de tradition d’utiliser les chiffres ´┐Ż sa convenance, et en particulier dans le domaine du logement et de la r´┐Żnovation urbaine o´┐Ż cette habitude en devient dommageable, ne serait-ce que pour la compr´┐Żhension de la r´┐Żalit´┐Ż des situations. Ainsi le nombre, en augmentation, des permis de construire est un bon chiffre en termes de d´┐Żveloppement ´┐Żconomique pour le secteur de la construction, mais il recouvre des r´┐Żalit´┐Żs extraordinairement diverses : un seul permis peut ´┐Żtre d´┐Żpos´┐Ż tout aussi bien pour construire cent logements que pour r´┐Żnover une simple terrasse. On ne saurait donc s’en servir pour structurer une r´┐Żflexion sur une probl´┐Żmatique largement partag´┐Że : apporter ´┐Ż la demande de logements une r´┐Żponse diversifi´┐Że, depuis l’accession ´┐Ż la propri´┐Żt´┐Ż jusqu’au logement tr´┐Żs social, y compris les structures d’accueil d’urgence. Il faudrait disposer d’´┐Żl´┐Żments plus solides et de crit´┐Żres v´┐Żritablement objectifs pour mieux appr´┐Żcier l’´┐Żvolution budg´┐Żtaire et comprendre notamment ce que signifient tr´┐Żs exactement les 93 000 logements sociaux ´┐Żvoqu´┐Żs par la ministre : le rapporteur lui-m´┐Żme a remarqu´┐Ż que l’analyse de l’USH diff´┐Żrait de celle de la direction g´┐Żn´┐Żrale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction. Entre PLS (pr´┐Żt locatif social) et PLAI (pr´┐Żt locatif aid´┐Ż d’int´┐Żgration), auxquels vient s’ajouter encore un peu de financement de r´┐Żhabilitation, il est difficile de s’y retrouver dans l’offre de logement, par exemple lorsqu’il s’agit de logement tr´┐Żs social.
S’agissant du PNRU, le budget fait une fois de plus appel ´┐Ż des financements exceptionnels : apr´┐Żs avoir pr´┐Żlev´┐Ż sur le FRU en 2006, on tire parti en 2007 des cons´┐Żquences de la r´┐Żforme des SACI. Peut-on raisonnablement construire une politique budg´┐Żtaire de l’´┐Żtat, a fortiori sur un engagement aussi fondamental, ´┐Ż coup de ressources exceptionnelles ? Cela ne para´┐Żt pas de bonne m´┐Żthode, d’autant que personne ne sait ´┐Ż quelles ressources exceptionnelles le prochain gouvernement pourra faire appel en 2008.
Le probl´┐Żme d’appr´┐Żciation des chiffres se pose pour le PNRU, selon que les donn´┐Żes proviennent de l’ANRU, de l’USH ou de la compilation d’analyses r´┐Żgionales, notamment lorsqu’il s’agit de mesurer le taux de couverture du flux cumul´┐Ż des d´┐Żmolitions par les reconstructions. Entre le moment o´┐Ż l’on d´┐Żmolit et celui o´┐Ż l’on reconstruit, il s’ensuit in´┐Żvitablement un d´┐Żcalage dont il faut veiller, particuli´┐Żrement dans les zones les plus tendues, ´┐Ż ce qu’il n’en vienne pas ´┐Ż entamer l’offre de logements imm´┐Żdiatement disponibles face ´┐Ż un public en constante augmentation. L’´┐Żvolution du nombre de demandeurs de logement, entre le d´┐Żbut et la fin de la pr´┐Żsente mandature, peut ´┐Żtre un crit´┐Żre de r´┐Żf´┐Żrence pour juger de l’efficacit´┐Ż de l’action gouvernementale. En 2005, le rapport des reconstructions sur les d´┐Żmolitions ´┐Żtait de 53 %, chiffre somme toute assez logique ; reste ´┐Ż savoir comment faire progresser ce taux de couverture. Il n’est que de 76 % en 2006 et devrait atteindre 80 % en 2007. Autrement dit, le d´┐Żficit cumul´┐Ż des trois premi´┐Żres ann´┐Żes ´┐Żquivaut pratiquement ´┐Ż une ann´┐Że de d´┐Żmolitions sans aucune reconstruction… N’est-il pas temps de mettre en œuvre des solutions de rattrapage, particuli´┐Żrement dans les zones de tension, pour ´┐Żviter que la r´┐Żnovation urbaine n’en vienne ´┐Ż totalement annuler l’augmentation de l’offre de logements ? Bon nombre de maires et de pr´┐Żsidents de communaut´┐Żs d’agglom´┐Żration s’inqui´┐Żtent de voir toute leur offre de logements disponibles servir au relogement.
La nouvelle Agence nationale pour la coh´┐Żsion sociale, qui devait ´┐Żtre dot´┐Że de 500 millions d’euros par an, ne sera finalement dot´┐Że que de 385 millions en cr´┐Żdits de paiement en 2007. Comment sera-t-il possible d’engager malgr´┐Ż tout 500 millions ?
Les aides personnelles au logement ont ´┐Żt´┐Ż revaloris´┐Żes de 1,8 % alors que les loyers ont progress´┐Ż de 2,7 % et les charges de 5 %. On peut se demander comment, avec un tel diff´┐Żrentiel, l’´┐Żtat peut esp´┐Żrer maintenir l’objectif de solvabilisation des locataires.
Le Gouvernement avait pris l’engagement de ramener le seuil de versement de l’APL de 24 ´┐Ż 15 euros, ´┐Ż la suite, d’ailleurs, de l’intervention du M´┐Żdiateur de la R´┐Żpublique. Cet engagement ne sera visiblement pas tenu.
Les subventions aux bailleurs sociaux ne conna´┐Żtront aucune actualisation dans le budget 2007, au risque de voir leur dette progressivement se reconstituer et ´┐Ż devoir une fois de plus apurer leur situation dans les conditions budg´┐Żtairement difficiles.
M. Georges Mothron, au nom du groupe UMP, s’est r´┐Żjoui de voir les programmes de r´┐Żnovation urbaine prolong´┐Żs jusqu’en 2013, soit deux ann´┐Żes suppl´┐Żmentaires par rapport ´┐Ż la date pr´┐Żvue dans la loi de coh´┐Żsion sociale. Il sera ainsi possible de rattraper le retard ´┐Ż l’allumage pris lors du montage des projets. Les nouveaux CUCS de trois ans permettront de disposer d’un cadre contractuel fort autour de cinq priorit´┐Żs : acc´┐Żs ´┐Ż l’emploi et d´┐Żveloppement ´┐Żconomique, am´┐Żlioration du cadre de vie, r´┐Żussite ´┐Żducative, pr´┐Żvention de la d´┐Żlinquance et s´┐Żcurit´┐Ż, sant´┐Ż. Avec pr´┐Żs de 800 millions d’euros, le programme ´┐Ż ´┐Żquit´┐Ż territoriale et soutien ´┐Ż b´┐Żn´┐Żficiera des moyens n´┐Żcessaires pour une mont´┐Że en puissance des actions visant ´┐Ż restaurer l’´┐Żgalit´┐Ż des chances.
La mobilisation des cr´┐Żdits en faveur de la construction de logements sociaux et de logements priv´┐Żs ´┐Ż loyer ma´┐Żtris´┐Ż est ´┐Ż la hauteur des enjeux, concr´┐Żtisant les dispositifs adopt´┐Żs dans le cadre de la loi ENL visant ´┐Ż relancer la cha´┐Żne de production et ´┐Ż r´┐Żsorber les retards accumul´┐Żs sous d’autres gouvernements. L’objectif de 100 000 logements HLM est presque atteint. La dotation budg´┐Żtaire de l’ANAH, en progression, lui permettra de subventionner les travaux dans 37 500 logements et de remettre sur le march´┐Ż bon nombre de logements vacants. Parall´┐Żlement, la mont´┐Że en puissance du nouveau pr´┐Żt ´┐Ż taux z´┐Żro permettra ´┐Ż plus de 250 000 b´┐Żn´┐Żficiaires de disposer plus de 250 millions d’euros. Enfin, la mise en place des dispositifs Borloo dans le neuf et dans l’ancien et l’application du taux r´┐Żduit de TVA pour les op´┐Żrations en accession sociale dans les quartiers en r´┐Żnovation urbaine devraient contribuer ´┐Ż d´┐Żbloquer la situation du logement, de m´┐Żme que les financements d´┐Żgag´┐Żs au profit du FNAL, sans oublier la revalorisation des aides personnelles au logement de pratiquement 2 % ´┐Ż compter du 1er janvier 2007, qui profitera ´┐Ż pr´┐Żs de six millions de foyers.
Se pose toutefois la question, d´┐Żj´┐Ż ´┐Żvoqu´┐Że, des op´┐Żrations de renouvellement urbain dans des zones ´┐Ż tr´┐Żs forte concentration de logements sociaux parfois n´┐Żglig´┐Żs depuis plusieurs d´┐Żcennies. C’est notamment le cas de tout un quartier d’Argenteuil, constitu´┐Ż d’immeubles HLM devenus v´┐Żtustes, qui jouxte deux quartiers similaires de Saint-Gratien et d’Epinay-sur-Seine. Or il semblerait que le d´┐Żblocage des financements ANRU soit subordonn´┐Ż ´┐Ż l’obligation de reconstruire in situ 50 % des logements d´┐Żtruits alors qu’il serait parfaitement possible de les reconstruire dans d’autres endroits de la ville ; cela ne participe pas ´┐Ż l’objectif de mixit´┐Ż sociale.
En conclusion, M. Georges Monthron a relev´┐Ż que la volont´┐Ż de renouvellement urbain exprim´┐Że par le groupe UMP tant au sein de la commission que sur le terrain commen´┐Żait ´┐Ż se traduire concr´┐Żtement dans les faits, ´┐Ż tel point que ceux qui, voil´┐Ż trois ans, doutaient de l’efficacit´┐Ż de l’ANRU se bousculent d´┐Żsormais ´┐Ż son guichet – sans doute faut-il y voir la ran´┐Żon de la gloire –, et a indiqu´┐Ż que son groupe voterait ce budget.
Mme Marie-Fran´┐Żoise P´┐Żrol-Dumont a rapport´┐Ż l’inqui´┐Żtude des conseils g´┐Żn´┐Żraux, qui ne cessent d’alerter le Gouvernement sur ce tonneau des Dana´┐Żdes que constitue le transfert de la gestion du RMI, avec des retards de compensation de TIPP, qui en viennent ´┐Ż repr´┐Żsenter jusqu’´┐Ż six points de fiscalit´┐Ż. Il avait ´┐Żt´┐Ż assur´┐Ż que, gr´┐Żce ´┐Ż la loi de coh´┐Żsion sociale et aux contrats d’avenir, cet ´┐Żcart allait lentement, mais inexorablement se r´┐Żduire. Aussi les d´┐Żpartements se sont-ils lanc´┐Żs dans une politique tr´┐Żs volontariste, acceptant de prendre une part du fardeau apr´┐Żs avoir calcul´┐Ż qu’un allocataire du RMI passant en contrat d’avenir repr´┐Żsenterait un co´┐Żt pour les finances d´┐Żpartementales, estim´┐Ż ´┐Ż 1 200 euros par an dans la Haute-Vienne. Mais ils ignoraient que l’´┐Żtat sortirait l’allocataire en question du calcul de la compensation de la TIPP, tant et si bien que son co´┐Żt n’est plus de 1 200 euros, mais bien de 5 200 euros… C’est l´┐Ż un v´┐Żritable march´┐Ż de dupes, ´┐Ż telle enseigne que plusieurs pr´┐Żsidents de conseils g´┐Żn´┐Żraux ont d’ores et d´┐Żj´┐Ż arr´┐Żt´┐Ż de signer des contrats d’avenir. Au final, tout un pan de la loi de coh´┐Żsion sociale sera mis ´┐Ż mal, ce qui p´┐Żnalisera les plus fragiles dans la mesure o´┐Ż, depuis la suppression des CES et CEC et la r´┐Żforme de l’ASS, les contrats d’avenir restent le seul dispositif accessible aux publics les plus ´┐Żloign´┐Żs de l’emploi. L’´┐Żtat doit imp´┐Żrativement entendre raison et la solidarit´┐Ż nationale continuer ´┐Ż jouer sur ces politiques de l’emploi. Qui plus est, le serpent en vient ´┐Ż se mordre la queue lorsqu’on apprend que la rallonge de fin d’ann´┐Że sera distribu´┐Że au vu de trois crit´┐Żres, parmi lesquels le volet insertion : autrement dit, plus on ins´┐Żre, plus on aura de compensation, mais les ins´┐Żr´┐Żs sortiront automatiquement de la compensation ! Il faut imp´┐Żrativement sortir de cette histoire kafka´┐Żenne si l’on veut que les d´┐Żpartements continuent ´┐Ż participer ´┐Ż la politique de l’emploi.
Mme Marie-Fran´┐Żoise P´┐Żrol-Dumont a ´┐Żgalement enjoint le Gouvernement de rappeler aux services de l’´┐Żtat dans les d´┐Żpartements et la r´┐Żgion que les conseils g´┐Żn´┐Żraux et les collectivit´┐Żs locales n’´┐Żtaient pas leurs prestataires de services : on a vu un rectorat embaucher des gens pratiquement au noir, des Rmistes en contrat d’avenir sur des postes d’auxiliaires de vie scolaire, poste ´┐Ż comp´┐Żtence d’´┐Żtat, puis demander au d´┐Żpartement de r´┐Żgulariser a posteriori… Ce genre d’abus s’est reproduit dans plusieurs d´┐Żpartements. Une remise en ordre s’impose de toute urgence si l’on veut que les solidarit´┐Żs locales continuent ´┐Ż jouer aux c´┐Żt´┐Żs de l’´┐Żtat.
M. Fran´┐Żois Brottes s’est inqui´┐Żt´┐Ż du retrait des caisses d’allocations familiales de tous les dossiers ´┐Ż contrat temps libre ´┐Ż, ´┐Ż contrat petite enfance ´┐Ż et autres dispositifs d’accompagnement social dans les quartiers en difficult´┐Ż depuis que l’´┐Żtat semble lui avoir coup´┐Ż les vivres. Il ne suffit pas de r´┐Żhabiliter les b´┐Żtiments, encore faut-il maintenir l’accompagnement social. Le ph´┐Żnom´┐Żne prend des proportions assez pr´┐Żoccupantes, avec des diminutions qui peuvent atteindre 50, voire 60 %.
Une circulaire a r´┐Żcemment ´┐Żt´┐Ż adress´┐Że aux pr´┐Żfets pour leur expliquer que l’am´┐Żnagement d’une aire d’accueil des gens du voyage ne signifiait pas forc´┐Żment construire une r´┐Żsidence h´┐Żteli´┐Żre quatre ´┐Żtoiles… Alors que les maires, en quelque sorte ´┐Ż d´┐Żsign´┐Żs volontaires ´┐Ż, sont plut´┐Żt enclins ´┐Ż se montrer coop´┐Żratifs, les services de l’´┐Żtat, DDA, DDE et autres missions ´┐Ż loi sur l’eau ´┐Ż ne cessent de les harceler en les enjoignant de r´┐Żaliser toutes sortes d’am´┐Żnagements pr´┐Żalablement ´┐Ż la construction de ces aires. ´┐Ż moins de les installer au cœur du village, ces tracasseries administratives deviennent proprement insupportables pour les maires qui se sentent pris au pi´┐Żge, d’autant que la gestion de ces flux n’est pas toujours simple. Cette affaire appelle un minimum de bon sens, dans l’int´┐Żr´┐Żt tant de l’´┐Żtat que des collectivit´┐Żs.
Enfin, M. Fran´┐Żois Brottes a demand´┐Ż si l’´┐Żtat avait arr´┐Żt´┐Ż une philosophie sur la taille que devaient avoir les ´┐Żtablissements publics fonciers. Les probl´┐Żmatiques du p´┐Żriurbain et de l’urbain ne sont pas forc´┐Żment les m´┐Żmes ; ´┐Ż vouloir constituer des entit´┐Żs par trop importantes, on peut en arriver ´┐Ż bloquer certains projets d’´┐Żtablissements publics fonciers.
M. Pierre Cohen a rappel´┐Ż qu’en novembre 2005, ´┐Ż la suite d’´┐Żmeutes particuli´┐Żrement inqui´┐Żtantes, l’examen du budget de la ville avait ´┐Żt´┐Ż d´┐Żcal´┐Ż d’une dizaine de jours et une rallonge budg´┐Żtaire de 100 millions d’euros avait ´┐Żt´┐Ż d´┐Żcid´┐Że, destin´┐Że pour l’essentiel ´┐Ż compenser les coupes sombres dont avaient ´┐Żt´┐Ż victimes les associations. On pouvait d´┐Żs lors s’attendre ´┐Ż une politique ambitieuse du logement, m´┐Żme si le succ´┐Żs, artificiel, de l’ANRU tient avant tout au fait que celle-ci est le seul et unique guichet auquel il est d´┐Żsormais possible de s’adresser.
Reste qu’´┐Ż c´┐Żt´┐Ż de la reconstruction des murs, il est tout aussi n´┐Żcessaire de recr´┐Żer du lien social en s’appuyant sur les associations. Il est permis de se demander si les 100 millions ont eu de r´┐Żelles retomb´┐Żes sur les associations de terrains ; ´┐Ż l’exception de celles qui, arros´┐Żes par le biais de la r´┐Żussite ´┐Żducative, b´┐Żn´┐Żficient effectivement de financements r´┐Żels, toutes les autres se retrouvent en butte aux pires difficult´┐Żs, au point de devoir licencier. M. Pierre Cohen, qui a constat´┐Ż cette situation dans un secteur qu’il conna´┐Żt particuli´┐Żrement bien, a demand´┐Ż s’il s’agissait l´┐Ż d’une exception ou d’un cas g´┐Żn´┐Żral.
Les CUCS sont venus remplacer les contrats de ville et il a fallu plusieurs mois pour en comprendre le fonctionnement. On pouvait esp´┐Żrer que les trois niveaux correspondent ´┐Ż la logique g´┐Żographique unanimement reconnue d’une politique de la ville : un premier niveau correspondant aux quartiers prioritaires en grande difficult´┐Ż b´┐Żn´┐Żficiant de moyens sp´┐Żcifiques, un deuxi´┐Żme correspondant ´┐Ż des zones appelant des abondements particuliers et un troisi´┐Żme p´┐Żrim´┐Żtre beaucoup plus large, ne n´┐Żcessitant que des actions d’accompagnement ou de pr´┐Żvention de la d´┐Żlinquance, par exemple lorsqu’il s’agit de reconstruire des logements ailleurs que dans les quartiers en grande difficult´┐Ż o´┐Ż on les d´┐Żtruit. Or l’exp´┐Żrience d’un GIP ´┐Ż politique de la ville ´┐Ż dans l’agglom´┐Żration toulousaine am´┐Żne ´┐Ż craindre une remise en cause de ce troisi´┐Żme niveau, les CUCS ne semblant plus concerner que les seules zones ultraprioritaires. L´┐Ż encore, ne faut-il y voir que le r´┐Żsultat d’une politique purement locale, hautement condamnable ?
Mme Annick Lepetit a elle aussi regrett´┐Ż les bagarres auxquelles donnaient lieu les chiffres du logement en demandant pourquoi il n’existait pas dans le bleu budg´┐Żtaire un r´┐Żcapitulatif des constructions de logements par cat´┐Żgorie sociale – PLS, PLAI, etc. – afin de rendre les discussions plus ais´┐Żes et couper court aux divergences d’interpr´┐Żtation. On sait par exemple que les besoins qui ressortent le plus souvent des listes des demandeurs de logements sociaux n’entrent pas dans les crit´┐Żres des logements PLS, les plus construits.
Le taux d’effort des m´┐Żnages est quant ´┐Ż lui d´┐Żtermin´┐Ż par des indicateurs pr´┐Żcis. Il est permis de s’´┐Żtonner que le budget 2007 ne fasse aucunement mention d’un accroissement de ce taux d’effort alors que l’actualisation de l’APL ne d´┐Żpasse pas 1,8 % alors que les loyers et charges augmentent de 2,7 ´┐Ż 5 %.
En r´┐Żponse aux diff´┐Żrents orateurs, Mme Catherine Vautrin, ministre d´┐Żl´┐Żgu´┐Że ´┐Ż la coh´┐Żsion sociale et ´┐Ż la parit´┐Ż, a apport´┐Ż les pr´┐Żcisions suivantes :
La nouvelle Agence nationale pour la coh´┐Żsion sociale et l’´┐Żgalit´┐Ż des chances pr´┐Żsente trois avantages importants : la notion de guichet unique, qui ´┐Żvite aux associations de monter deux ou trois dossiers pour percevoir 100 euros, et de voir les premiers financeurs demander d´┐Żj´┐Ż des ´┐Żvaluations au moment o´┐Ż les derniers n’ont pas encore rendu leur r´┐Żponse ; une efficacit´┐Ż accrue de la politique de la ville gr´┐Żce ´┐Ż une gestion et un suivi simplifi´┐Żs, via un agent comptable central, et des circuits de financement plus courts ; une meilleure lisibilit´┐Ż pour les associations utilisatrices, les contrats urbains de coh´┐Żsion g´┐Żr´┐Żs par l’agence ´┐Żtant sign´┐Żs par le maire et le pr´┐Żfet, repr´┐Żsentant de l’´┐Żtat, dans le cadre de conventions pluriannuelles clairement li´┐Żes.
Les CUCS ont fait l’objet d’une analyse par la D´┐Żl´┐Żgation interminist´┐Żrielle ´┐Ż la ville (DIV), qui a ainsi r´┐Żalis´┐Ż une v´┐Żritable photographie de l’´┐Żtat des quartiers arr´┐Żtant la g´┐Żographie prioritaire de chacune des villes articul´┐Żes suivant trois priorit´┐Żs, o´┐Ż le niveau I, celui des quartiers en tr´┐Żs grande difficult´┐Ż, appara´┐Żt souvent assez proche du niveau I de l’ANRU. Il s’agit l´┐Ż d’un outil d’aide ´┐Ż la d´┐Żcision ; il appartient ensuite aux ´┐Żlus d’en discuter avec les repr´┐Żsentants de l’´┐Żtat pour mettre en place le CUCS et d’en d´┐Żterminer ensemble les priorit´┐Żs. Des enveloppes r´┐Żgionales ont ´┐Żt´┐Ż notifi´┐Żes fin octobre aux pr´┐Żfets de r´┐Żgion ; la signature des contrats est pr´┐Żvue pour la fin de l’ann´┐Że. D’ores et d´┐Żj´┐Ż, des appels ´┐Ż projets ont ´┐Żt´┐Ż lanc´┐Żs par l’´┐Żtat et les collectivit´┐Żs afin d’´┐Żviter toute rupture dans les financements des associations.
Le Gouvernement a ´┐Żvidemment eu de nombreux ´┐Żchos des retraits des CAF. Une r´┐Żunion avec le cabinet de M. Philippe Bas est pr´┐Żvue la semaine suivante dans la mesure o´┐Ż la mise en place des contrats urbains ne peut se concevoir sans les actions d’accompagnement. Cette question ne pourra ´┐Żtre ´┐Żlud´┐Że lors de la discussion de la convention d’objectifs de la CAF.
La r´┐Żgle en mati´┐Żre de reconstitution de l’offre locative dans le cadre du PNRU est connue de tous : un logement social reconstruit pour un logement social d´┐Żmoli. Pour autant, il n’existe aucune obligation de reconstituer la m´┐Żme offre ; non seulement il est possible, et m´┐Żme indispensable pour restaurer une certaine mixit´┐Ż, de proposer plusieurs types de logement social, mais la reconstruction doit correspondre aux besoins de la population et donc s’effectuer sur l’ensemble de la ville, hors des quartiers sensibles. Il est ´┐Ż noter que l’´┐Żcart entre les d´┐Żmolitions et les reconstructions commence ´┐Ż se r´┐Żduire ; il n’est pas seulement li´┐Ż au d´┐Żcalage entre les deux op´┐Żrations ; il peut s’agir de d´┐Żmolitions sans reconstruction ´┐Ż un pour un, particuli´┐Żrement dans des quartiers ´┐Ż tr´┐Żs fort taux de vacance o´┐Ż les op´┐Żrateurs, en toute logique, ne souhaitent pas voir reconstruire la m´┐Żme offre. L’objectif est de reconstruire au maximum avant la d´┐Żmolition pour ´┐Żviter des ph´┐Żnom´┐Żnes de d´┐Żcalage qui peuvent effectivement poser de s´┐Żrieux probl´┐Żmes aux commissions de relogement, particuli´┐Żrement en ´┐Żle-de-France. Le matin m´┐Żme au S´┐Żnat, la ministre s’est engag´┐Że au nom du Gouvernement ´┐Ż r´┐Żaliser une analyse des op´┐Żrations de relogement de l’ensemble des programmes ANRU afin d’assurer un r´┐Żel suivi. Ces op´┐Żrations de relogement sont du reste une occasion privil´┐Żgi´┐Że de discuter avec les familles de leur parcours r´┐Żsidentiel et d’´┐Żvoquer divers sujets – la charte d’insertion, par exemple.
Il n’y a aucune raison de craindre que l’ANRU ne perde ses qualit´┐Żs de structure de proximit´┐Ż. La gestion de nombreux dossiers ne repr´┐Żsente pas de difficult´┐Żs particuli´┐Żres dans la mesure o´┐Ż l’organisation de l’ANRU s’appuie sur des services d´┐Żconcentr´┐Żs : le pr´┐Żfet du d´┐Żpartement, d´┐Żl´┐Żgu´┐Ż territorial de l’ANRU, et les services de l’´┐Żtat, charg´┐Żs de l’instruction. Il n’en est pas moins utile de renforcer les structures d’ing´┐Żnierie des bailleurs, des porteurs de projets et des acteurs locaux. L’ANRU pr´┐Żvoit du reste des accompagnements avec la Caisse des d´┐Żp´┐Żts afin d’aider les villes qui ne disposeraient pas de structures suffisantes pour conduire les projets ´┐Ż leur terme.
Le minist´┐Żre a ´┐Żvidemment eu connaissance des retards de paiement de l’ANRU, qui tiennent essentiellement aux d´┐Żlais d’instruction des paiements au niveau des DDE, puis de l’Agence, pour ce qui touche aux d´┐Żmolitions, les services de l’´┐Żtat ayant d´┐Ż ´┐Ż inventer ´┐Ż cette op´┐Żration, qu’ils n’avaient jusqu’alors jamais eu l’occasion de g´┐Żrer, en termes comptables. Les proc´┐Żdures de paiement ont ´┐Żt´┐Ż simplifi´┐Żes en mettant en place une instruction all´┐Żg´┐Że des demandes en attente, qui permettra le paiement, d’ici ´┐Ż fin 2006, d’une somme estim´┐Że ´┐Ż 150 millions d’euros, et, pour l’avenir, une proc´┐Żdure de paiement acc´┐Żl´┐Żr´┐Że reposant sur un syst´┐Żme d’avances de 15 % payables d´┐Żs la confirmation de l’intention du ma´┐Żtre d’ouvrage de s’engager dans l’op´┐Żration pr´┐Żvue par la convention, suivis de versement d’acomptes jusqu’´┐Ż hauteur de 70 % sur simple pr´┐Żsentation d’attestations d’avancement physique, le solde ´┐Żtant ´┐Żvidemment d´┐Żbloqu´┐Ż sur pr´┐Żsentation des justificatifs.
La d´┐Żconcentration portera essentiellement sur la mise en œuvre des projets de r´┐Żnovation urbaine. L’ANRU ´┐Żtudie notamment la possibilit´┐Ż de d´┐Żl´┐Żguer la gestion des conventions, ce qui permettrait, l´┐Ż encore, d’acc´┐Żl´┐Żrer les proc´┐Żdures.
Au-del´┐Ż des querelles de chiffres, le nombre de mises en chantier para´┐Żt significatif dans la mesure o´┐Ż elles r´┐Żpondent concr´┐Żtement aux besoins de logements. Les 410 000 logements mis en chantier en 2005 correspondent ´┐Ż un niveau exceptionnel, jamais atteint depuis 1980. Le tableau retra´┐Żant la r´┐Żpartition d´┐Żtaill´┐Że des logements sociaux peut parfaitement ´┐Żtre communiqu´┐Ż : l’objectif pour 2006 reste de 8 000 logements PLAI et 54 000 PLUS, pratiquement conforme aux pr´┐Żvisions initiales, et le nombre de PLS r´┐Żalis´┐Żs de 28 000 alors que l’objectif ´┐Żtait de 27 000. ´┐Ż ce total de 90 000 logements viennent s’ajouter 5 000 logements correspondant au reliquat des PLS Fonci´┐Żre.
Il est ´┐Ż noter que l’ANRU b´┐Żn´┐Żficiera de 356 millions d’euros de cr´┐Żdits de paiement dans le cadre de la r´┐Żnovation urbaine, auxquels il convient d’ajouter 100 millions d’euros en provenance des SACI, en cours de versement, et 100 millions d’euros provenant des dividendes de la Caisse des d´┐Żp´┐Żts : d’o´┐Ż le total annonc´┐Ż de 556 millions d’euros.
Si le volume d’aides aux bailleurs sociaux est rest´┐Ż inchang´┐Ż entre 2005 et 2006, cela n’a rien ´┐Ż voir avec la dette dans la mesure o´┐Ż les cr´┐Żdits de paiements sont en phase avec les autorisations d’engagement. La cons´┐Żquence de la non-contractualisation de la subvention ´┐Żquivaut certes ´┐Ż une baisse, relativement minime, de 1,8 % ´┐Ż chaque op´┐Żration ´┐Ż euro constant, mais celle-ci est largement compens´┐Że par d’autres mesures dont b´┐Żn´┐Żficient les op´┐Żrations des bailleurs sociaux depuis 2005 : exon´┐Żration de la taxe fonci´┐Żre sur les propri´┐Żt´┐Żs b´┐Żties durant vingt-cinq ans au lieu de quinze, baisse de 0,05 % du taux des pr´┐Żts au 1er janvier apr´┐Żs une baisse de 0,15 % au 1er novembre 2005, allongement de la dur´┐Że des pr´┐Żts de 35 ´┐Ż 40 ans, nouvelle baisse de 0,2 % du taux des pr´┐Żts annonc´┐Że au congr´┐Żs HLM.
S’agissant du livret A, la Commission europ´┐Żenne a effectivement mis en demeure la France sur le sujet des droits sp´┐Żciaux octroy´┐Żs en la mati´┐Żre ´┐Ż La Poste, aux caisses d’´┐Żpargne et au Cr´┐Żdit mutuel, pr´┐Żalablement ´┐Ż une d´┐Żcision sur la base de l’article 86 du Trait´┐Ż instituant la Communaut´┐Ż europ´┐Żenne. Dans la r´┐Żponse qu’il lui a adress´┐Że fin septembre, le Gouvernement a d´┐Żfendu l’architecture actuelle des circuits du livret A et du livret bleu, consid´┐Żrant que ce mode de distribution ne faussait pas la concurrence entre les r´┐Żseaux bancaires compte tenu de la faible importance du livret A par rapport ´┐Ż l’ensemble des placements. Au surplus, l’existence de droits sp´┐Żciaux de distribution du livret A r´┐Żpond ´┐Ż des consid´┐Żrations d’int´┐Żr´┐Żt g´┐Żn´┐Żral, en l’esp´┐Żce le financement du logement social et l’accessibilit´┐Ż bancaire du plus grand nombre. La Commission n’a pas encore fait conna´┐Żtre la suite qu’elle entend r´┐Żserver ´┐Ż cet argumentaire.
Le programme de mobilisation des terrains susceptibles d’´┐Żtre c´┐Żd´┐Żs par l’´┐Żtat en faveur de la r´┐Żalisation de logements sociaux porte sur sept cents sites identifi´┐Żs ; la r´┐Żalisation en juillet 2006 de plus de 25 000 logements ´┐Żtait d´┐Żj´┐Ż programm´┐Że sur 280 de ces sites, soit 4 millions de m´┐Żtre carr´┐Żs ´┐Ż r´┐Żaliser dans les trois ans. La programmation s’enrichit au fur et ´┐Ż mesure de l’approfondissement du travail de recensement ; lorsque les cessions interviennent dans des communes concern´┐Żes par l’article 55 de la loi SRU, l’´┐Żtat exige que la proportion de logements sociaux construits sur ces terrains repr´┐Żsente entre 50 et 100 % des r´┐Żalisations pr´┐Żvues. D’une fa´┐Żon g´┐Żn´┐Żrale, la r´┐Żpartition pr´┐Żcise entre logements sociaux et logements classiques n’est connue qu’´┐Ż un stade plus avanc´┐Ż de la r´┐Żalisation ; mais d’ores et d´┐Żj´┐Ż, sur les op´┐Żrations d´┐Żj´┐Ż r´┐Żalis´┐Żes, la proportion de logements sociaux varie consid´┐Żrablement selon les sites ; une moyenne g´┐Żn´┐Żrale tourne autour de 35 % et le Gouvernement entend la remonter.
Le seuil de versement de l’APL est effectivement rest´┐Ż ´┐Ż 24 euros. Les aides personnelles au logement ont ´┐Żt´┐Ż revaloris´┐Żes de 1,8 % pour les loyers ´┐Ż compter du 1er septembre 2005 et une nouvelle actualisation ´┐Ż hauteur de 1,8 % aura lieu le 1er janvier 2007, incluant cette fois les charges. Ces revalorisations repr´┐Żsenteront pour 2007 un co´┐Żt budg´┐Żtaire de 127 millions d’euros alors m´┐Żme qu’a ´┐Żt´┐Ż engag´┐Że une politique de mod´┐Żration des loyers : depuis le 1er janvier, le nouvel indice a syst´┐Żmatiquement ´┐Żvolu´┐Ż ´┐Ż un rythme inf´┐Żrieur ´┐Ż celui de l’ICC.
La pr´┐Żoccupation de Mme Marie-Fran´┐Żoise P´┐Żrol-Dumont ´┐Ż propos de l’affection d’une part de la TIPP au financement du RMI et de la non-prise en compte des contrats d’avenir est parfaitement l´┐Żgitime, mais totalement hors du cadre de ce budget. Les r´┐Żponses concr´┐Żtes devront ´┐Żtre ´┐Żtudi´┐Żes en concertation avec le ministre charg´┐Ż des collectivit´┐Żs locales.
Le probl´┐Żme de la r´┐Żalisation d’aires d’accueil pour les gens du voyage est suffisamment difficile pour que, au-del´┐Ż de la simple approche budg´┐Żtaire, l’´┐Żtat ait ´┐Ż cœur d’accompagner les collectivit´┐Żs dans un esprit de facilitation. L’attention des DDE devra effectivement ´┐Żtre appel´┐Że sur ce point.
S’agissant des ´┐Żtablissements publics fonciers, la loi offre deux possibilit´┐Żs : l’EPF d’´┐Żtat ou l’EPF d’agglom´┐Żration. Des cr´┐Żations viennent d’avoir lieu ou sont en cours. En ´┐Żle-de-France, le consensus a ´┐Żt´┐Ż difficile, mais a permis de d´┐Żboucher sur un dispositif coh´┐Żrent avec un EPF r´┐Żgional et trois EPF d´┐Żpartementaux. Il n’est pas encore possible, faute de disposer du recul suffisant, de pr´┐Żconiser une recette particuli´┐Żrement int´┐Żressante en la mati´┐Żre.
La rallonge budg´┐Żtaire de 181 millions d´┐Żcid´┐Że en novembre 2005 a ´┐Żt´┐Ż r´┐Żpartie ´┐Ż hauteur de 5 millions sur le budget de l’´┐Żducation nationale, 15 millions sur le budget jeunesse et sports, 5 millions sur l’offre d’activit´┐Żs sportives, 3,5 millions sur les parcours d’animation au sport, 6,5 millions sur la structuration des r´┐Żseaux associatifs. Les 80 millions suppl´┐Żmentaires pour le FIV ont ´┐Żt´┐Ż g´┐Żr´┐Żs par le minist´┐Żre de la coh´┐Żsion sociale : 53 millions sont all´┐Żs directement ´┐Ż des financements de proximit´┐Ż et 20 millions ont ´┐Żt´┐Ż r´┐Żpartis entre les d´┐Żpartements ayant des pr´┐Żfets d´┐Żl´┐Żgu´┐Żs ´┐Ż l’´┐Żgalit´┐Ż des chances. Il a ´┐Żt´┐Ż demand´┐Ż ´┐Ż la d´┐Żl´┐Żgation interminist´┐Żrielle ´┐Ż la ville de publier ´┐Ż la fin de l’ann´┐Że l’affectation pr´┐Żcise de l’ensemble de ces cr´┐Żdits de fa´┐Żon ´┐Ż ce que chacun ait connaissance de l’utilisation de cet argent public. C’est ´┐Żgalement dans le m´┐Żme esprit que l’´┐Żvaluation des contrats de coh´┐Żsion sociale b´┐Żn´┐Żficiera d’une part plus importante. Les auteurs des divers rapports sur la politique de la ville se sont toujours accord´┐Żs sur la n´┐Żcessit´┐Ż d’une ´┐Żvaluation : aussi les nouveaux CUCS feront-ils l’objet d’une double ´┐Żvaluation, sur les aspects op´┐Żrationnels, factuels, et sur les r´┐Żsultats proprement dits.
S’agissant enfin du taux d’effort des b´┐Żn´┐Żficiaires d’aides ´┐Ż la personne, il convient de rappeler que les chiffres indiqu´┐Żs pour 2007 correspondent ´┐Ż des pr´┐Żvisions. Des signes de d´┐Żtente des loyers sont d´┐Żj´┐Ż perceptibles dans certaines agglom´┐Żrations ; le nouvel indice de r´┐Żvision des loyers montre en outre un fort effet de mod´┐Żration.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, ayant ´┐Żt´┐Ż inform´┐Ż que la direction g´┐Żn´┐Żrale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction aurait modifi´┐Ż les conditions de d´┐Żlivrance des agr´┐Żments en ne les conditionnant plus qu’´┐Ż la pr´┐Żsentation d’un plan de financement ´┐Żquilibr´┐Ż, s’est enquis de savoir les cons´┐Żquences que cette modification pourrait avoir sur l’´┐Żtablissement des donn´┐Żes statistiques du minist´┐Żre.
La ministre d´┐Żl´┐Żgu´┐Że s’est engag´┐Że ´┐Ż r´┐Żpondre par ´┐Żcrit ´┐Ż cette question.
M. Pierre Cohen, estimant choquant que la discussion du projet de loi sur la pr´┐Żvention de la d´┐Żlinquance se d´┐Żroule sous l’´┐Żgide du seul ministre de l’int´┐Żrieur, a demand´┐Ż si la ministre comptait y prendre une part active.
La ministre d´┐Żl´┐Żgu´┐Że a r´┐Żpondu que tout ce qui touchait ´┐Ż la politique de la ville concernait au premier chef le ministre charg´┐Ż de la coh´┐Żsion sociale qui suivra ce d´┐Żbat avec le plus grand int´┐Żr´┐Żt. R´┐Żpondant ´┐Ż Mme Annick Lepetit, la ministre d´┐Żl´┐Żgu´┐Że a indiqu´┐Ż que les chiffres annonc´┐Żs pour 2007 en mati´┐Żre de taux d’effort des m´┐Żnages constituaient des pr´┐Żvisions. En outre, des signes de d´┐Żtente du co´┐Żt des loyers se manifestent d´┐Żj´┐Ż dans certaines agglom´┐Żrations et le nouvel indice de r´┐Żf´┐Żrence des loyers montre un fort effet de mod´┐Żration.
Le pr´┐Żsident Patrick Ollier a remerci´┐Ż la ministre d´┐Żl´┐Żgu´┐Że pour la qualit´┐Ż et la pr´┐Żcision, reconnues par tous les intervenants, de ses r´┐Żponses.
Apr´┐Żs le d´┐Żpart de la ministre, la commission a examin´┐Ż pour avis les cr´┐Żdits des programmes ´┐Ż aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement ; d´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż, de la mission ´┐Ż ville et logement ´┐Ż pour 2007.
M. Jean-Pierre Abelin, rapporteur pour avis, a exprim´┐Ż un avis favorable sur les cr´┐Żdits des programmes ´┐Ż aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement ; d´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż de la mission ´┐Ż Ville et Logement ´┐Ż sous r´┐Żserve de l’adoption d’un amendement qu’il a pr´┐Żsent´┐Ż, visant ´┐Ż financer la suppression du seuil de 24 euros en de´┐Ż´┐Ż duquel les aides au logement ne sont pas vers´┐Żs, estimant que la d´┐Żpense correspondante ´┐Żtait d’environ 34 millions d’euros. Cet amendement pr´┐Żl´┐Żve 12 millions d’euros sur les cr´┐Żdits du programme ´┐Ż Equit´┐Ż sociale et territoriale et soutien ´┐Ż et 22 millions d’euros sur les cr´┐Żdits du programme ´┐Ż D´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż. Il vise surtout ´┐Ż attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que le seuil exclut du b´┐Żn´┐Żfice de l’aide pr´┐Żs de 120 000 personnes.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec s’est f´┐Żlicit´┐Ż de ce que la majorit´┐Ż maintienne la pression sur cette question d´┐Żj´┐Ż ´┐Żvoqu´┐Że en vain lors du d´┐Żbat de la loi n´┐Ż 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Le Pr´┐Żsident Patrick Ollier a fait observer que c’´┐Żtait l´┐Ż la marque des pr´┐Żoccupations sociales de la majorit´┐Ż.
La Commission a ensuite adopt´┐Ż cet amendement ´┐Ż l’unanimit´┐Ż.
M. Luc Chatel a pr´┐Żsent´┐Ż un amendement renvoyant ´┐Ż un d´┐Żcret l’institution d’un m´┐Żcanisme de garantie des emprunts consentis en faveur des titulaires d’un contrat de travail autre qu’un contrat ´┐Ż dur´┐Że ind´┐Żtermin´┐Że. Il a expliqu´┐Ż qu’il s’agissait d’un dispositif ayant ´┐Żt´┐Ż adopt´┐Ż par l’Assembl´┐Że nationale, en deuxi´┐Żme lecture, au cours de la discussion de la loi n´┐Ż 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, puis supprim´┐Ż lors de la Commission mixte paritaire.
Le Pr´┐Żsident Patrick Ollier a attir´┐Ż l’attention de la Commission sur le risque que cet amendement soit jug´┐Ż irrecevable, dans la mesure o´┐Ż il constituait un cavalier budg´┐Żtaire.
M. Fran´┐Żois Brottes a fait part de son soutien de principe, tout en consid´┐Żrant qu’une disposition de cette nature aurait m´┐Żrit´┐Ż plut´┐Żt de relever d’une volont´┐Ż politique spontan´┐Że du Gouvernement.
M. Jean-Pierre Abelin, rapporteur pour avis, a ´┐Żmis un avis favorable, en souhaitant que l’amendement puisse permettre d’obtenir du Gouvernement des ´┐Żl´┐Żments d’information sur la mani´┐Żre de traiter le probl´┐Żme soulev´┐Ż, s’agissant notamment des travaux men´┐Żs par le groupe de travail mis en place sur le sujet.
Le Pr´┐Żsident Patrick Ollier a souhait´┐Ż ´┐Żgalement que l’adoption de l’amendement par la Commission, au-del´┐Ż de la question de la recevabilit´┐Ż, puisse fonctionner comme un signal.
◊
◊ ◊
La Commission l’a adopt´┐Ż ´┐Ż l’unanimit´┐Ż, puis, conform´┐Żment aux conclusions du rapporteur pour avis, a ´┐Żmis un avis favorable ´┐Ż l’adoption des cr´┐Żdits des programmes ´┐Ż aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement ; d´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement ´┐Ż de la mission ´┐Ż Ville et logement ´┐Ż pour l’ann´┐Że 2007.
AMENDEMENTS ADOPT´┐ŻS PAR LA COMMISSION
Article 34
´┐Żtat B
Mission "Ville et logement"
Amendement n´┐Ż II - 165 pr´┐Żsent´┐Ż par M. Jean-Pierre Abelin, rapporteur pour avis :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les cr´┐Żdits de paiement (en euros) :
|
Programmes |
+ |
- |
R´┐Żnovation urbaine dont titre 2 |
0 |
0 |
Equit´┐Ż sociale et territoriale et soutien dont titre 2 |
0 |
12.000.000 |
Aide ´┐Ż l’acc´┐Żs au logement dont titre 2 |
34.000.000 |
0 |
D´┐Żveloppement et am´┐Żlioration de l’offre de logement dont titre 2 d´┐Żpenses de personnel |
0 |
22.000.000 20.000.000 |
|
TOTAUX |
34.000.000 |
34.000.000 |
|
SOLDE |
0 | |
Article additionnel apr´┐Żs l’article 62
Amendement pr´┐Żsent´┐Ż par M. Jean-Pierre Abelin, rapporteur pour avis et M. Luc Chatel :
Apr´┐Żs l’article L. 313-6 du Code mon´┐Żtaire et financier, il est ins´┐Żr´┐Ż une sous-section 4 ainsi r´┐Żdig´┐Że :
´┐Ż Sous-section 4 : Garantie des emprunts consentis en faveur des titulaires d’un contrat de travail autre qu’un contrat ´┐Ż dur´┐Że ind´┐Żtermin´┐Że.
´┐Ż Art.- L. 313-6-1.- I – Il est institu´┐Ż un m´┐Żcanisme de garantie des emprunts immobiliers contract´┐Żs par les ´┐Żtablissements financiers avec des titulaires d’un contrat de travail autre qu’un contrat ´┐Ż dur´┐Że ind´┐Żtermin´┐Że.
´┐Ż II – Un d´┐Żcret pris apr´┐Żs concertation avec les repr´┐Żsentants des ´┐Żtablissements de cr´┐Żdit fixe l’organisation, les conditions d’acc´┐Żs et les ressources du fonds de garantie mis en place ´┐Ż cet effet.
´┐Ż III – Les pr´┐Żsentes dispositions seront ´┐Żgalement applicables aux d´┐Żpartements et territoires d’Outre-Mer. ´┐Ż